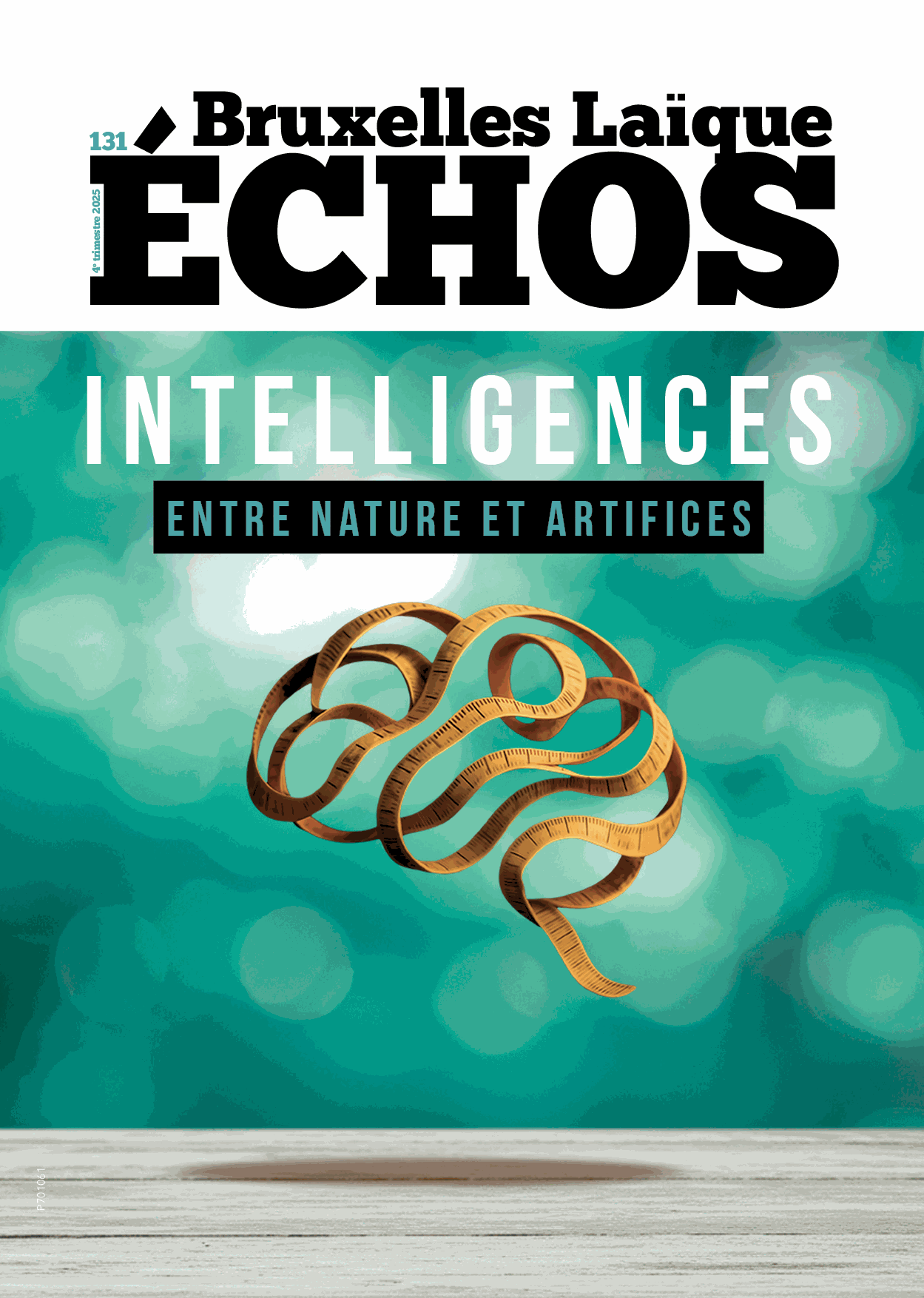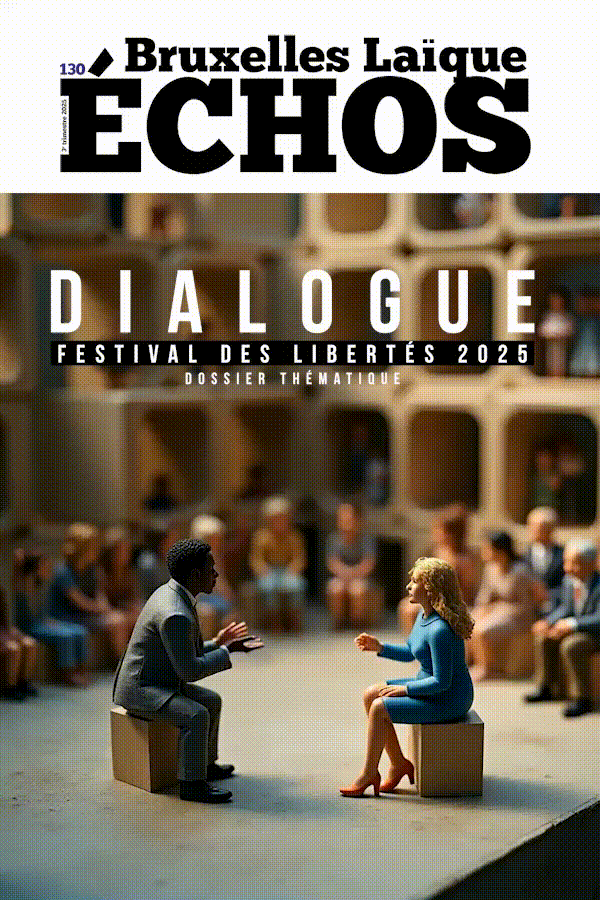Bruxelles Laïque Echos est le trimestriel sociopolitique de Bruxelles Laïque asbl et propose des dossiers thématiques abordés sous le prisme du libre-examen.
Essence de l’humanisme, objet d’instrumentalisation, prétexte d’hiérarchisation, garantie de qualité, finalité éducative, source de classification, certificat social, support de mesure, vecteur d’affirmation, objet d’instrumentalisation, objectif idéalisé, alibi d’exclusion, condition d’inclusion, guide d’artifices, mode d’emploi(s)… Aujourd’hui, la notion d’intelligence doit composer tant de son omniprésence que de sa polysémie; au point d’en devenir otage de conflits partisans,
vecteur de jugements d’opinions. Décrire l’intelligence réclame son usage au pluriel, sa géolocalisation, son domaine référentiel, son terrain d’expression… L’intelligence se mesure-t-elle objectivement ? Sur base de quels critères, de quelles valeurs ? Comment penser les politiques
d’émancipation et développer le libre-examen, sans faire la morale ni cantonner l’intelligence à des codes majoritaires, voire excluants ? Que penser des formes d’intelligences non-humaines ? Qu’il s’agisse de l’intelligence animale et organique, ou encore du développement de l’intelligence artificielle, notre condition nous impose des limites dont il convient de prendre acte. Sans cette humilité, nos réflexions éthiques risquent de faire fausse route.
À l’heure où les extrêmes gagnent du terrain, où les institutions vacillent, où les luttes s’intensifient, le dialogue n’est pas un luxe. C’est une nécessité démocratique, une pratique de résistance, une voie d’émancipation.
Ce numéro du Bruxelles Laïque Echos présente la thématique du Festival des Libertés 2025. Il explore les multiples visages du dialogue : politique, diplomatique, social, culturel, féministe, miliant. Il interroge ses promesses, ses pièges, ses usages et ses détournements. Il donne la parole à celles et ceux qui, chaque jour, inventent des espaces de parole libre, de confrontation constructive, de reconnaissance mutuelle.