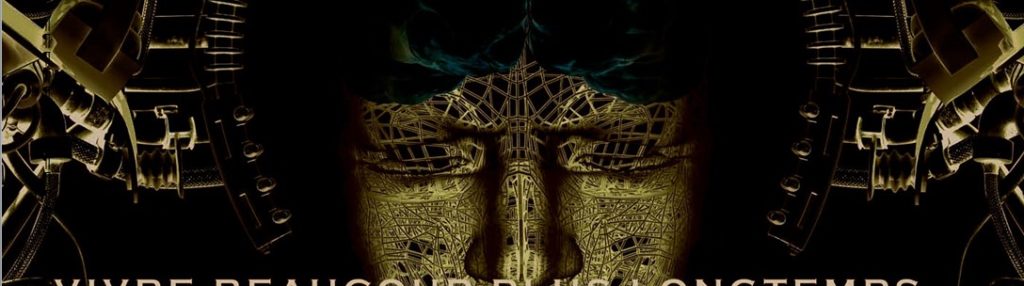S’il est des livres qui deviennent invisibles dans notre pile de livres à lire, il en est d’autres que l’on n’oubliera pas. Par un détail, le moment où nous les avons achetés, l’auteur ou l’autrice que l’on adore, de ce qu’on attend du contenu, ou même, parfois, par la couleur de sa couverture. Ici, c’est un peu tout ça à la fois.
On aurait tort de réduire Ascendant beauf à une pique contre le snobisme culturel. Le nouvel essai de Rose Lamy déplie, avec précision et colère contenue, un mécanisme de mise à distance sociale qui façonne nos appartenances, nos goûts, jusqu’à notre horizon politique. C’est un livre qui ne nous flatte pas : il nous bouscule. Et c’est tant mieux.
Rose Lamy : de la critique médiatique au scalpel social
On connaît Rose Lamy pour son travail de veille sur le sexisme dans les médias lancé via le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre (créé en 2019)[i], aujourd’hui suivi par plus de 250 000 personnes. Deux essais sont venus consolider son parcours : Défaire le discours sexiste dans les médias (JC Lattès, 2021), puis En bons pères de famille (JC Lattès, 2023). Ascendant beauf ouvre un nouveau chantier : le mépris social qui s’exprime par la disqualification de la figure du « beauf », formule commode pour dire « les autres », souvent les classes populaires – parfois aussi celles et ceux qui, sans pedigree culturel reconnu par les classes dites dominantes –, ne maîtrisent pas les codes attendus par la « bonne société ».
Mais Rose Lamy n’avance pas en sociologue académique mais en vulgarisatrice méthodique : elle découpe les discours, établit des familles d’arguments et démonte les évidences. Si sa trajectoire personnelle nourrit cette enquête, l’écriture demeure résolument tournée vers le lecteur : comment parle-t-on des goûts des autres ? Qui décide ce qui « vaut » ? Et qu’est-ce que ce jugement produit, très concrètement, dans la vie des gens ?
Situer Ascendant beauf dans l’œuvre : continuité et déplacement
Rose Lamy poursuit le travail engagé dans ses précédents ouvrages : déminer un langage qui naturalise les hiérarchies et qui essentialise les individus. Au niveau des thématiques abordées, il y a déplacement parce que le centre de gravité n’est plus le sexisme médiatique, mais le classisme ordinaire tel qu’il se fabrique dans la conversation politique et dans le commentaire culturel de tout un chacun.
Dans En bons pères de famille, l’expression juridique[ii] servait d’écran : une norme qui était transformée en une forme de « neutralité ». Ici, « beauf » joue le même rôle : un stigmate qui dit la domination au nom du “bon goût”. L’autrice assume l’angle : on ne naît pas « beauf », on le devient dans le regard de ceux qui peuvent se permettre de ne pas l’être. D’entrée de jeu, la thèse est énoncée sans détour : la catégorie “beauf” n’est pas descriptive, elle est performative : elle fabrique ce qu’elle prétend nommer.
Le « beauf », une catégorie discursive : histoire, usages, effets
On attribue souvent à Cabu une mise en forme moderne du « beauf » (le beau-frère), caricature d’un « français moyen » à l’horizon et aux idées étroites. L’usage du terme a glissé du portrait satirique à une étiquette d’infériorisation culturelle[iii]. Le mot « beauf » est donc devenu une arme symbolique, sa cible varie selon l’époque, mais sa fonction reste stable : dire qui n’appartient pas au monde « légitime ».
L’autrice nous montre que l’étiquette ne désigne jamais des individus isolés, mais un groupe fantasmé : on colle « beauf » a des pratiques (écouter du rap ou de la variété française, aimer la télé-réalité, fréquenter des chaînes de restaurants populaires), des lieux (zonages périurbains, déserts médicaux et culturels) et des manières (langage, accent, vêtements). Elle insiste sur le coût social de cette catégorisation : être tenu à distance de la légitimité, c’est être tenu à distance des ressources telles que les réseaux, la confiance en soi, le sentiment d’« avoir droit à ».
Un des nombreux points forts du livre est là : relier le stigmate culturel au destin social. Le « beauf » n’est pas une trouvaille amusée, c’est un opérateur de tri, un filtre d’accès à la reconnaissance – l’autrice relie explicitement les géographies de l’isolement[iv] et la manière dont on parle des goûts des gens. Le lien paraît abrupt ? Le livre nous le montre : c’est loin d’être question d’esthétique, c’est une économie morale où certains goûts valent plus que d’autres, ouvrent des portes, autorisent des appartenances.
Auto-socioanalyse : le récit comme méthode
Rose Lamy entremêle récit et analyse : souvenirs de famille, premières expériences au travail, rencontres avec la honte d’appartenir à une certaine classe d’un côté, mais aussi passages d’archives, extraits d’articles, livres de sociologie de l’autre. On n’est ni dans l’autofiction, ni dans l’essai purement théorique : l’enquête est située. C’est un choix fort : l’intime au service du politique – non pas comme légitimation, mais comme ressort heuristique. Que se passe-t-il quand on apprend les « bons codes » ? Qu’y perd-on ? Qui s’en réjouit ?
D’autres ont accompli ce déplacement : faire de sa trajectoire un observatoire. Mais ici, Rose Lamy tient la ligne sans complaisance : elle s’attrape en flagrant délit de condescendance et en fait matière d’analyse. Ascendant beauf est ainsi traversé par une forme de contradiction : on n’en sort pas en s’innocentant, dit-elle en substance, mais en cartographiant nos angles morts. Finis, les regards autant explicatifs que condescendants envers sa propre classe initiale, comme on peut les lire dans certains livres tels que ceux d’Edouard Louis ou Didier Eribon, avec tout le respect que nous avons pour leur travail. Ici, on se regarde dans le miroir et on s’observe comme faisant partie du monde qui nous entoure.
Le camp des “nôtres” ou quand la gauche se trompe de cible
Le livre est le plus tranchant quand il sort du confort d’une dénonciation des élites culturelles pour interroger son propre camp. L’autrice nous explique comment la gauche a parfois épousé une posture de distinction : on parle « du peuple » mais on lui prescrit ce qu’il doit aimer, comment il doit parler, ce qu’il doit faire de ses colères. Ce mépris qui se déguise en pédagogie produit du ressentiment et abîme la confiance.
Elle ne fait pas mystère de sa position : elle vient de là, elle sait ce que coûte la tentative de transfuge : apprendre d’autres codes, donner des gages, perdre l’accent, laisser au vestiaire tel goût musical, se défaire de la honte. Mais elle refuse l’alternative infantilisante : céder au cynisme (on s’accommoderait de la hiérarchie des goûts) ou moraliser (imposer aux « nôtres » un kit de bonnes pratiques culturelles). Rose Lamy plaide pour une politique d’alliances qui passe par la prise au sérieux des attachements populaires, pas pour leur sacralisation.
Le goût comme frontière : culture, capital, dignité
On ne sortira pas indemne d’un livre qui rend La distinction (Pierre Bourdieu) lisible au plus grand nombre. Rose Lamy fait sauter les oppositions paresseuses (haut/bas, populaire/légitime) en suivant le trajet d’objets très concrets, qu’on éprouve toutes et tous : une chanson ringarde qu’on adore, une émission « honteuse » qu’on regarde vraiment, un restaurant qui rassure. Elle ne se moque pas : elle observe ce que ces attachements font à nos vies.
Il y a ici un désaccord assumé avec un progressisme qui confond trop vite émancipation et conversion au « bon goût ». L’autrice n’idéalise pas les pratiques populaires. Elle rappelle qu’elles peuvent porter des formes de domination (sexistes, homophobes par exemple) – et qu’il ne s’agit pas d’en faire un sanctuaire. Mais la solution ne saurait être une quelconque forme de pathologisation : le jugement esthétique ne vaut pas diagnostic moral.
Politique : la fabrique du désalignement
Au fur et à mesure du livre, la démonstration déborde la sociologie du goût. Elle touche à l’urne. Le livre ne prétend pas expliquer à lui seul le désalignement entre gauche et classes populaires, mais montre un rouage : une partie du camp progressiste a cessé de parler “avec” pour parler “sur”. À l’arrivée, méfiance, disqualification réciproque, abstention ou vote de rejet : c’est notamment par le mépris que la gauche porte sur les classes populaires que le vote vers des partis populistes, notamment d’extrême droite, a tant progressé dans l’hexagone. C’est un facteur qui compte, même si on n’oublie pas les autres facteurs tels que les conditions socio-économiques ou l’impact de la concentration des médias entre les mains de grands industriels proches de l’extrême droite.
Mais Rose Lamy ne s’abandonne pas au diagnostic noir. Elle avance des gestes de réparation symbolique : s’astreindre à nommer les mépris, cesser d’instrumentaliser des figures populaires, ouvrir des espaces de dispute sans humiliation. L’ambition n’est pas la conciliation mielleuse, mais la conflictualité civilisée : on ne se ressemble pas, on ne s’aimera pas toujours, mais on peut décider de ne pas se ridiculiser.
Pédagogie sans condescendance
Découpe fine des arguments, art du contre-exemple, mélange des registres : Rose Lamy a le sens du pédagogique sans être infantilisante. Elle ne fige pas son lecteur dans une adresse professorale ; elle éclaire, puis elle doute, puis elle avance. La composition est resserrée (176 pages) ; le rythme, nerveux ; les chapitres se succèdent au rythme de chansons populaires des 50 dernières années tel un réel ancrage culturel qui situe la réflexion. Si l’on a lu ses premiers livres, on reconnaît les marqueurs de style, mais l’analyse sociale y est plus dense.
Un livre utile, pour faire « mieux »
L’essai agit comme un révélateur : il décentre la critique. Plutôt que de faire la leçon, il fait l’inventaire de nos propres réflexes de distinction. Le livre est court, mais on y apprend une chose essentielle, situer : regarder d’où l’on parle, à qui l’on parle, et ce que l’on fabrique en parlant. La visée n’est pas la réconciliation, mais la décence : ne pas écraser l’Autre.
On mesure aussi ce que la gauche a perdu en se réfugiant dans les temples du bon goût : des alliés potentiels, des histoires, des gestes. Rose Lamy propose un réarmement symbolique : reconnaître ce qui tient les gens debout, sans confondre attachement et adhésion aveugle. C’est une position exigeante : elle s’oblige autant qu’elle nous oblige.
Notre critique est positive, la lecture s’impose. Ascendant beauf donne des outils de désencombrement : des mots pour repérer le mépris, s’en déprendre, ne pas l’armer par inadvertance.
On le referme moins sûr de soi, et c’est une bonne nouvelle. Parce qu’entre la tentation d’avoir raison et le travail de faire société, Rose Lamy choisit le second. On peut discuter ses angles morts. On a, surtout, envie de s’en servir.
| Forces et faiblesses (en toute subjectivité) La clarté d’un problème politique : Ascendant beauf ne se contente pas de dénoncer : il décrit un mécanisme, ses ingrédients, ses effets. Le livre met à nu la logique de la distinction lorsqu’elle se fait instrument de police sociale. On ressort avec des mots pour le dire et des garde-fous pour ne pas reproduire ce qu’on critique. L’éthique de la contradiction : l’autrice s’inclut dans le diagnostic. Ça compte : on ne parle pas “du haut de”, on se compromet. Cette mise en risque donne confiance : on peut lire, s’agacer, se reconnaître, sans tout surplomber par une posture de supériorité morale. L’accessibilité sans renoncement : ni jargonneux, ni simpliste, l’essai tient la ligne. Sur un sujet miné par les contresens, Rose Lamy désamorce l’hystérisation : elle raconte, elle situe, elle nomme. Le livre assume la focale discursive : c’est sa force ; c’est parfois sa limite. Vu la qualité de la vulgarisation, on aurait aimé davantage d’éléments de théorie pour pouvoir, si on en a l’envie, aller un peu plus loin. |
| Vous pourrez écouter Rose Lamy lors du Débat « L’Autre a toujours tort (ou l’enfer du dialogue) », le 14/10 à 18h30 au Foyer du Théâtre National lors du Festival des libertés. |
[i] https://www.instagram.com/preparez_vous_pour_la_bagarre/
[ii] Qui a heureusement disparue du code civil belge.
[iii] Plus d’infos ici : https://www.radiofrance.fr/franceculture/d-ou-vient-la-figure-du-beauf-8793538
[iv] En sociologie, la géographie de l’isolement désigne la répartition spatiale des individus ou groupes sociaux qui, du fait de leur marginalisation (pauvreté, minorité ethnique, âge, handicap, etc.), se retrouvent concentrés dans des espaces séparés ou relégués, produisant une ségrégation sociale et un isolement relationnel.