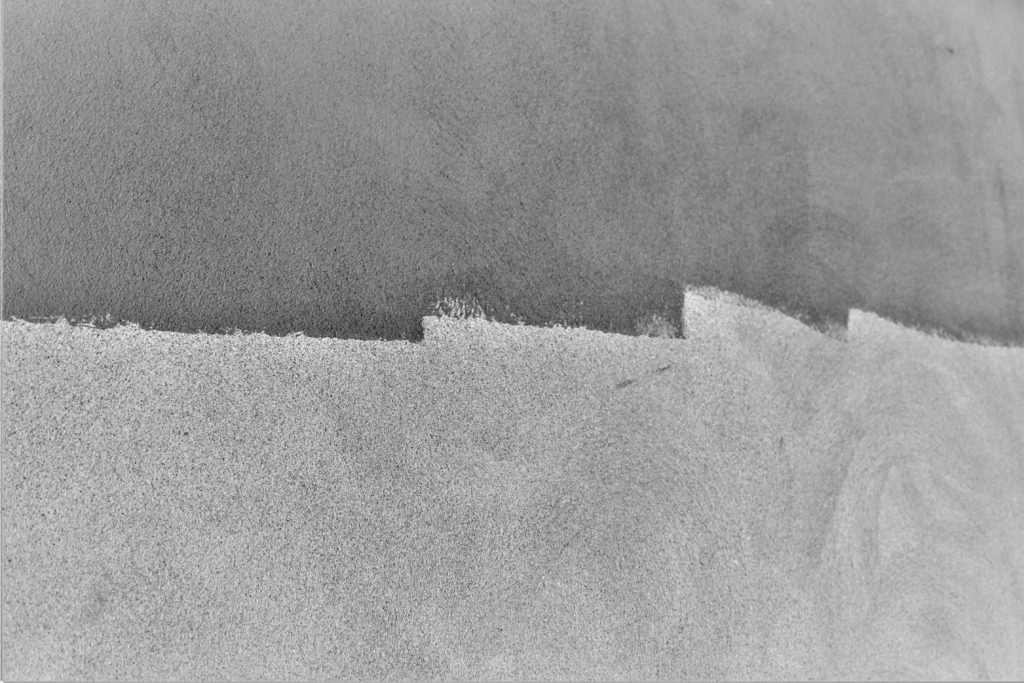Il y a seulement quelques années, j’espérais encore avoir une lune de miel avec les technologies numériques. Ces technologies devaient nous libérer, nous permettre de vivre un rêve éveillé. Aujourd’hui, cet espoir m’apparaît comme une illusion.
Il sera question, dans ce texte, de tenter d’analyser et de comprendre comment s’est formée la rupture entre la croyance en l’utopie numérique et le web 2.0, dit social – et pourquoi il importe aujourd’hui de prendre acte de cette rupture. En effet, si j’étais animé par une éthique hacker et une volonté d’apporter le numérique dans un maximum de foyers afin de permettre de réaliser une forme d’utopie sociale, le constat, après plus d’une décennie d’implantation et d’animation d’Espaces Publics Numériques est assez amer : la rencontre entre les hackers et les usagers ne semble pas avoir eu lieu comme nous l’espérions. Pire, il y a l’éventualité d’avoir participé à l’établissement du Big Data en amenant des usagers qui n’étaient pas encore dans la boucle de captation, de digestion et de production des données de ces entreprises. Et nous ne parlons pas de l’impact écologique d’un secteur « dont la consommation augmente de 5 à 7% par an et qui, par conséquent, pourrait solliciter 20% de l’électricité mondiale en 2025 »[1]. Quant aux réseaux sociaux, ces zones de mise en scène de l’individu et fenêtres vers le monde se sont avérées être des bulles de l’individualisation et du communautarisme, nous enfermant plus dans nos préjugés que nous projetant vers l’altérité[2]. De cette ère du « moi »[3] a émergé une forme d’exploitation de l’individu qui a positionné le citoyen dans un statut de soumission quasi-féodale par rapport aux technologies numériques.
Avec la marchandisation et l’exploitation de nouvelles dimensions de l’activité humaine par l’industrie numérique, l’humanité est entrée dans l’ère du capitalisme de la surveillance : nos comportements en ligne nous échappent et le contrôle social s’est massivement automatisé. Nos relations sociales sont devenues des productions symboliques récoltées par le Big Data, dans une forme de rétroaction à finalité consumériste. Ainsi, comme l’explique Cédric Durand : « La capture des données nourrit les algorithmes et ceux-ci viennent en retour guider les conduites, les deux se renforçant mutuellement dans une boucle de rétroaction ».[4] Dès lors, la gouvernance algorithmique est tellement forte que l’on peut par moments s’interroger sur qui est le véritable sujet de nos actions. Est-ce bien moi qui ai décidé d’agir de la sorte ou est-ce que je ne fais que produire la décision d’un algorithme ?[5]
Le capitalisme numérique a ainsi pris d’assaut tous les spectres de l’informatique qui pouvaient être rentabilisés, le modèle californien de la Silicon Valley est devenu l’idéologie dominante dans la vision globale du numérique, et la concurrence s’est imposée comme le point cardinal, détruisant les projets de co-construction, d’entraide et même de communs. Le tout en affirmant construire ces technologies sur un principe de démocratie citoyenne, avec par exemple l’affirmation prononcée au milieu des années 2010 par les dirigeants de Google que le numérique va « déconcentrer le pouvoir loin des États et des institutions et le transférer aux individus ».[6]
Selon Cédric Durand, on peut attribuer cette dérive à l’arrivée de Ayn Rand comme icône libertarienne lors de la rédaction de la Magna Carta[7], charte ayant pour but de définir les buts et objectifs du cyberespace, considéré comme une zone de marchés en perpétuelle mutation. L’idée diffusée par cette dernière dans ses romans allégoriques, très influente aux États-Unis, valorise l’image de la Silicon Valley en mettant en scène le concept de disruption. Elle oppose les hommes selon deux figures : d’une part ceux qui sont à la pointe de l’innovation, qu’elle valorise comme des hommes d’esprit, soit des suiveurs, qu’elle mésestime. C’est ainsi que les entrepreneurs de la Silicon Valley « se complaisent dans le miroir que leur tendent les héros randiens ».[8] Les valeurs mises en avant sont « la capacité à prendre des paris, à bouger avant tout le monde, à forger le futur en ne s’appuyant que sur ses propres intuitions ».[9] Cette idéologie est aujourd’hui critiquée par bon nombre d’analystes de la société numérique, dont le journaliste et militant Georges Montbiot, affirmant qu’Ayn Rand « a produit la plus horrible philosophie de l’après-guerre. Selon elle, l’égoïsme est le bien, l’altruisme est le mal, l’empathie et la compassion sont irrationnelles et destructrices. Les pauvres méritent de mourir et les riches ont le droit à un pouvoir sans restriction ».[10] Ainsi, les fondements de l’entreprenariat numérique semblent reposer sur des principes ultra-individualistes, un contournement « créatif » des lois, et l’exploitation des plus faibles.
Pourtant, le numérique ne s’est pas exclusivement inscrit dans cette démarche techno-capitaliste. Il existe ainsi, dès les années 1970, une fraction technophile de hippies (d’habitude émancipés de toute technologie) que sa découverte de l’informatique inspirait à « une vision du monde qui fait cohabiter l’aspiration radicale à l’autonomie individuelle et la mise en partage de la créativité de chacun à l’échelle globale, sans en passer par une quelconque forme de délégation de pouvoir ou de subordination ».[11] Plutôt que de valoriser la création individuelle et l’exploitation de l’outil émergeant, il s’agissait pour ces hippies technophiles de « projeter à l’échelle globale les aspirations communautaires et antiautoritaires de la contre-culture, en donnant aux individus augmentés technologiquement les moyens de s’émanciper des grandes entreprises et du Big Government ».[12]
C’est dans ce contexte qu’émerge le projet écrit en 1983 par Richard Stallman, ancien employé du MIT, allant largement à l’encontre de l’idéologie de start-up prônée par les entrepreneurs de la Silicon Valley. En effet, quand Stallman lance le projet GNU[13] (pour Gnu’s Nut Unix), il revendique le droit de partage libre de logiciels afin, comme il l’écrit, « de pouvoir continuer à utiliser des ordinateurs sans déshonneur ». Il décide alors de « créer un ensemble suffisant de logiciels libres de façon à pouvoir faire ce [qu’il a] à faire sans utiliser de logiciel qui ne soit pas libre ».[14] Son geste est important car il ne met pas uniquement en avant le logiciel libre et l’open source[15], mais propose des valeurs encore défendues aujourd’hui par les critiques du techno-capitalisme, notamment la défense de l’anonymat et la protection des données. En ouvrant le code source, Stallman présuppose non seulement la capacité de tout utilisateur de modifier un programme pour l’améliorer (opérant par-là un acte changeant performativement le statut des utilisateurs), mais met aussi à mal le système économique qui encadre le marché alors émergeant du logiciel[16], friand de brevets et d’autres verrous pour faire du software une marchandise valorisable. C’est pourquoi je considère que s’il n’est pas illégitime de qualifier le hack à travers son aspect illégal ou ludique, c’est surtout la liberté qui en est la valeur cardinale.[17]
Dans les années 1980 et 1990, les communautés de hackers, et plus généralement les informaticiens, vont se disperser au-delà des universités et voir leur nombre se multiplier, faisant de l’informaticien un statut nettement moins exceptionnel que ce qu’il était initialement. Ces nouveaux usagers du numérique vont alors se retrouver en ligne, dans des forums de discussion et de partage (les boards FTP) et en présentiel dans les FabLabs, Hackerspaces et autres Makerspaces. Ces rencontres donneront naissance à une subculture forte de hackers, caractérisée par une idéologie commune et une identité exprimée à travers une série de signes : à même leur vêtement, leur ordinateur, leurs murs et jusque dans leur alimentation.
C’est dans ce contexte et dans cet esprit qu’à 13 ans je découvre l’informatique en utilisant mes premiers ordinateurs. Avec mes amis, je monte, démonte, modifie les composants de mon ordinateur. Quelques années plus tard, lors de nos premières « LAN[18]» ces compétences souples acquises après de nombreux montages et démontages nous permettent de connecter entre eux une dizaine d’ordinateurs pour jouer, échanger et partager des données. Il s’agit de moments de rencontre, de partage, et de convivialité. L’informatique nous permet de nous retrouver et génère des passions communes. Quelques années plus tard, cette expérience se prolonge sur Internet – des moments d’échange et de partage, encore une fois, mais cette fois c’est en ligne que la rencontre a lieu. Pas encore sur des réseaux sociaux mais plutôt sur ce que l’on appelle des Boards FTP.[19] Nous partageons des logiciels que nous expérimentons mais aussi nos avis sur les films, livres, musiques.
Pour un jeune de campagne qui vit la fin des années 1990 comme une porte qui s’ouvre vers le futur, c’est une aubaine. Les frontières sont non seulement écrasées, mais surtout la distance entre la ville et la province s’efface progressivement. « La terre est plate » disait Thomas Friedman[20] en 2006, exprimant cette disparition de la frontière, que nous expérimentions avec enthousiasme. Depuis notre campagne, nous remettions en question l’idée que c’est exclusivement « dans les villes que se créent, se reçoivent et se consomment les propositions artistiques et culturelles… ».[21] Nous étions projetés dans cette création et consommation culturelles et nous pouvions participer au débat avec les citadins et, tout en nous émancipant des médias de masse qu’étaient la télévision et la radio, nous pouvions façonner une culture qui nous était propre. Mais, surtout, cette omniprésence numérique était pour nous un moyen de nous retrouver, de discuter, de créer du lien social. Ce que nous ne savions pas encore, à cette époque, c’est que nous étions en train d’intégrer une culture très particulière et innovante. Issue du bricolage, de la transformation, et de la débrouille, nous devenions sans le savoir des hackers. Nous vivions alors en plein fantasme, en observant le futur depuis les dernières années du 20e siècle. La Silicon Valley exerçait une fascination totale sur nos vies, notre imaginaire politique se façonnait, et nous avions l’impression que la « do-ocratie » et notre idéologie de makers allait nous permettre si pas de sauver le monde, du moins d’en résoudre les problèmes majeurs.
Quelques années plus tard, je deviens animateur multimédia dans un Espace Public Numérique. En tant qu’animateur, ma mission est de résorber la fracture numérique et de permettre à des usagers marginalisés, qui n’arrivent pas à intégrer l’outil informatique à s’insérer dans la numérisation de l’espace public. En tant qu’animateur, j’ai le sentiment de faire quelque chose de bien. Je travaille activement à aider les plus vulnérables à ne pas rester sur la touche et à intégrer le web social. À ce moment, je suis persuadé que le transfert de mes compétences est primordial et que la numérisation est une bonne chose, et j’en ai la preuve : dans les Espaces publics numériques, je retrouve du lien social ! Des adolescents de 12 à 16 ans se retrouvent avec des personnes âgées et partagent leurs connaissances. Léo, 12 ans aide Michel, 58 ans à communiquer avec sa fille, Jeanne qui se trouve a plus de 2000 kilomètres de là. Parfois, ils peuvent même utiliser une webcam pour se parler ! J’observe cet espace avec fierté, le sentiment de participer à la résorption des inégalités sociales tout en travaillant sur des problématiques intergénérationnelles.
Cependant, avec beaucoup d’autres, je comprends vite que nous n’allions pas dans le sens espéré par l’idéologie hack qui nous anime. Il nous est apparu qu’au lieu de libérer les usagers en leur donnant plus de compétences, nous les rendions plus dépendants d’une technologie dont ils n’avaient pas besoin. Pire, alors que la domination des GAFAM grimpait en flèche, nous en devenions les petits soldats en leur apportant de nouvelles cibles et de nouveaux clients. Par ailleurs, nous rencontrions un autre problème, avec l’avancée en deux temps des réseaux sociaux, qui se sont installés facilement dans les foyers au capital culturel et social fort, et plus lentement dans les foyers plus modestes, créant une sorte de dichotomie entre deux mondes aux usages différents. Comme le dit bien Nicolas Auray, « finalement, la démocratisation d’internet s’est faite de façon ségrégative : les derniers arrivés, les milieux populaires, communiquent entre eux, mais pas avec ceux qui sont situés plus haut dans la hiérarchie sociale et scolaire. Il faut de ce point de vue, conclure à une faible transformation des horizons de sociabilité par internet ».[22]
C’est ainsi qu’est apparue la désillusion chez nous, autres travailleurs du secteur numérique : en plus d’avoir participé à l’implantation des technologies numériques chez des personnes qui en étaient jusque-là préservées nous avons échoué dans notre objectif de rapprochement des différentes classes sociales. Les espaces numériques qui sont arrivés massivement dans les années 2000 afin de résoudre le problème de la fracture numérique n’ont pas du tout participé à la résorption d’une quelconque fracture sociale, ils ont simplement participé et catalysé l’installation des produits de la Silicon Valley dans le quotidien de citoyens qui auraient pu en être préservés. Ces espaces ont participé à la surpuissance de ce que l’on appelait encore il y a quelques temps les GAFAM, en facilitant l’exploitation des données du Big Data.
Pensant que les outils numériques avaient vraiment pour vocation de « rapprocher les citoyens », c’est donc avec une grande tristesse que j’ai compris que ce rapprochement social n’aura pas lieu. D’une part à cause des algorithmes, dont la gouvernance produit cet effet de filtrage permanent en nous enfermant dans des castes communautaires, mais aussi à cause du principe de la performance et de l’exploitation qui est le sien. Aveuglés par les messages libertaires déployés par les sociétés du Big Data, qui prétendaient pouvoir apporter plus de démocratie au citoyen, nous avons naïvement ignoré le fait que ces sociétés répondaient à un impératif de compétitivité qui est incompatible avec les idéologies libertaires, ouvertes et inclusives des hackers. Ainsi, comme l’analyse Cédric Durand, « [a]lors que l’individu est renvoyé à une position de consommateur de conversation publique, celle-ci est transformée en un produit de masse dont la visée première consiste à faire de l’audience afin de pouvoir être valorisée par la vente d’espaces publicitaires ».[23]
Certains diront avec raison que ces constats que j’avance sur base de mon expérience dans le secteur numérique sont fortement teintés de pessimisme. Il me semble pourtant que ce pessimisme est seul capable de nous aider à en finir avec ce que j’estime être des illusions. Ce n’est qu’à partir d’un tel travail de deuil qu’il deviendra possible de poser sobrement les questions concernant l’avenir, et notamment celle de savoir comment le Web 3.0[24] pourrait redevenir social, c’est-à-dire avoir des valeurs de partage, d’échange et de rencontre après avoir été si longuement déformé dans sa version 2.0 par des valeurs techno-capitalistes dont le résultat n’aura été que d’accentuer les inégalités sociales.
[1] PITRON, G. L’enfer Numérique, Voyage au bout d’un Like, Les Liens qui Libèrent, 2021, p 45.
[2] Voir à ce propos la notion de bulle de filtrage, telle que l’a théorisé Eli Paser, notamment dans son livre, The Filter Bubble : What The Internet Is Hiding From You, Éditions Penguin, New York, 2012.
[3] Lire à ce propos la très intéressante analyse de l’artiste et penseuse du numérique Olia Lialina, « From my to me » qui explique la transition du discours de l’internaute, de la présentation de sa passion à sa mise en scène individuel à travers les sites internet Geocities. Olia Lialina, « From my to me », Interfacecritique, [en ligne] https://interfacecritique.net/book/olia-lialina-from-my-to-me/
[4] DURAND, C. Technoféodalisme, critique de l’économie numérique, Zones, Paris, 2020.
[5] Voir, à ce propos, le livre blanc publié en 2021 de la société Jaeger qui développe du commerce autonome : https://www.jaggaer.com/app/uploads/dlm_uploads/2021/03/2021_WP_AutonomousProcurementTechnology_FR-2.pdf
[6] Ibid., p. 24.
[7] « Les 23 et 24 août 1994, la PFF organise à Atlanta une conférence intitulée « Cyberspace and the American Dream » qui débouche sur un ouvrage sous-titré A Magna Carta for the Knowledge Age (…) “La « charte » commence par reprendre l’idée, en vogue depuis plusieurs décennies, que l’âge de l’information succéderait à ceux de l’agriculture et de l’industrie. » in DURAND, C. Technoféodalisme, critique de l’économie numérique, Zones, Paris 2020, p. 26.
[8] Ibid., p. 32.
[9] Ibid., p. 33.
[10] MONBIOT, Georges, “How Ayn Rand became the new right’s version of Marx”, The Guardian, 5 mars 2012.
[11] DURAND, C., Technoféodalisme, critique de l’économie numérique, op. cit., p. 24.
[12] Ibid., p. 24.
[13] Créé en 1984 par Richard Stallman, le projet GNU, système d’exploitation informatique qui reprend les fonctionnements d’Unix, est un projet informatique dont l’objectif est de développer le système d’exploitation GNU. Le projet est maintenu par une communauté de hackers organisée en sous-projets. (http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html)
[14] STALLMAN, R. M. (1983), « Original announcement of the GNU Project », http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html,Version française : http://www.dtext.com/hache/manifeste-GNU.html
[15] Open source réfère en effet au caractère non-propriétaire (i.e. librement disponible et modifiable) du code-source des logiciels produits.
[16] Pour plus de précision sur l’histoire de l’informatique et de ses enjeux, voir AURAY, N., « Les configurations de marché du logiciel et le renouvellement du capitalisme », dans : EYMARD-DUVERNAY, F., (éd.) L’économie des conventions, méthodes et résultats, Tome 2. Développements, Paris, La Découverte, pp. 259-272. Dans cet article, l’auteur explique comment le logiciel est progressivement devenu un marché, conjointement à la volonté d’IBM de les commercialiser de manière autonome, et comment cela a son tour ouvert la voix de contestation que sont les logiciels libres.
[17] BARDINI, T. & PROULX, S., « La culture du hack en ligne, une rupture avec les normes de la modernité », Les Cahiers du numérique, 2002/2 (Vol. 3), pp. 35-54. URL : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2002-2-page-35.html
[18] Une LAN, ou Local Area Network, est une forme de réseau local entre plusieurs ordinateurs en vue, entre autre, d’échanger des fichiers ou de faire des jeux en lignes.
[19] Le FTP correspond à un protocole informatique d’échange de fichiers (le File Transfert Protocol) qui était utilisé pour favoriser les échanges de pair à pair sur ces plateformes d’échange. Une Board est un anglicisme qui correspond à un forum de discussion segmenté par thème.
[20] FRIEDMAN, T., La terre est plate. Une brève histoire du xxie siècle, éditions Saint-Simon, 2006.
[21] DELFOSSE C., « La culture à la campagne », Pour, 2011/1 (N° 208), p. 43-48. DOI : 10.3917/pour.208.0043. URL : https://www.cairn.info/revue-pour-2011-1-page-43.htm
[22] AURAY, N., cité dans PASQUIER, D., L’internet des familles modestes. Enquête dans la France rurale Paris, Presses des Mines, coll. « Sciences sociales », 2018, p. 222.
[23] DURAND, C., Technoféodalisme, critique de l’économie numérique, op. cit., p. 86.
[24] Le Web 3.0 fait référence à un internet décentralisé, calqué sur le modèle de la blockchain qui devrait remplacer le web 2.0, ou web social que nous connaissons aujourd’hui.