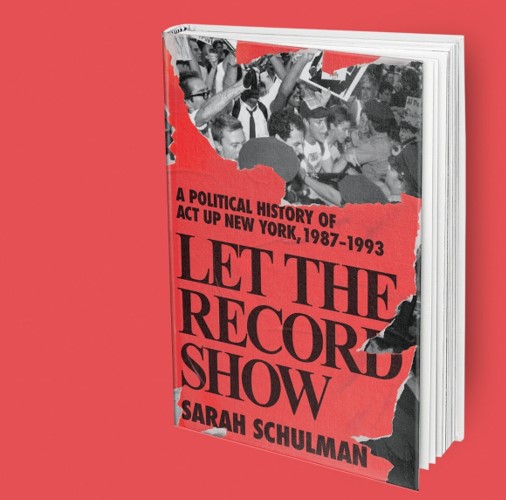Les évènements terroristes récemment survenus en France et en Belgique ont bouleversé nos sociétés et ont logiquement suscité de nombreuses tentatives d’analyses et d’explications. Intellectuels, islamologues et philosophes ont essayé de dégager des pistes de réflexion dans un horizon considérablement obscurci par la douleur, les larmes et la colère.
L’intention était de définir le processus amenant une personne à embrasser corps et âmes le salafisme takfiriste, et déterminer l’interprétation à donner à la violence meurtrière de l’engagement djihadiste. Est- il le produit d’une pathologie de l’islam, une maladie de ce dernier ? Le résultat d’une radicalisation de l’islam ? S’agit-il, au contraire, d’une nouvelle expression de l’extrémisme révolutionnaire, “le radicalisme”, qui ressurgit périodiquement dans l’histoire ? Est-ce simplement une “révolte générationnelle et nihiliste” qui instrumentalise ce que les rayons des supermarchés de la rébellion peuvent offrir actuellement ?
Conscients des dangers réels qu’une telle tentative de compréhension pouvait faire peser sur le “vivre ensemble”, une grande partie des démarches réflexives et analytiques a tout de suite été confrontée à des préoccupations bienveillantes visant à éviter autant que possible des amalgames mortifères. Ce souci légitime de ne pas tomber dans des explications essentialistes clivantes favorisant la stigmatisation de la communauté musulmane prise dans son ensemble a amené, consciemment ou non, une grande partie des chercheurs, mais aussi et surtout du monde politique et associatif, à exclure du champ de la recherche le facteur religieux.
L’EXPLICATION GÉNÉRATIONNELLE ET NIHILISTE
Au lendemain des attentats du 13 novembre, Olivier Roy[1] a défendu, dans les colonnes du journal Le Monde, la thèse selon laquelle le djihadisme ne serait qu’une “révolte générationnelle et nihiliste”, que ces événements étaient la conséquence d’une “islamisation de la radicalité”, reprenant ainsi l’expression de l’anthropologue Alain Bertho. Il s’agirait d’une islamisation d’une radicalité préexistante qui ne fait que revêtir les apparences des causes conjoncturelles. L’hyperviolence qui a frappé la France serait donc moins une question de religion que l’expression “d’une révolte générationnelle.”
Un avis partagé par le sociologue Farhad Khosrokhavar, auteur de Radicalisation, pour lequel l’action des fanatiques se fonde sur “la haine de soi et le sentiment de sa propre insignifiance bientôt transformés en haine de l’autre”. Il s’agit dans le djihadisme d’intérioriser et de retourner le rejet en se faisant “chevaliers de la foi en lutte contre une société mécréante”.
Le philosophe allemand Jürgen Habermas insiste sur la dimension pathologique : “Ces jeunes générations, lorsqu’échouent toutes les tentatives politiques, se radicalisent afin de regagner leur amour-propre. Tel est le mécanisme de cette pathologie sociale. Une dynamique psychologique semblablement désespérée, qui trouve là encore son origine dans ce défaut de reconnaissance, semble aussi faire de petits criminels isolés, issus des populations immigrées européennes, les héros pervers de commandos de tueurs téléguidés.”[2]
Ces différentes théories de “l’islamisation de la radicalité” rencontrent un certain succès. Non seulement elles permettent de ramener la problématique au niveau strict de l’individu, dont l’action ne serait finalement que le produit d’une révolte générationnelle, d’une pathologie sociale ou psychologique visant en quelque sorte à disqualifier les revendications possibles de “l’ennemi”, mais ces postulats permettent également d’éviter le champ conflictuel, crispé et miné d’une problématique dont l’aspect religieux pourrait constituer une des variables à prendre en considération. Elles déplacent en outre la question de l’origine du phénomène, de son rapport avec l’islam et ses communautés vers la société occidentale et son manque de perspectives.
Par ailleurs, cette approche fait l’impasse des velléités réformistes à l’égard de l’islam exprimées actuellement par nombre d’intellectuels musulmans du monde arabe, mais aussi d’Europe.[3]
L’APPROCHE CULTURALISTE
Très largement partagée sur les réseaux sociaux, “l’islamisation de la radicalité” refroidit davantage les spécialistes. Particulièrement Gilles Kepel[4] qui défend la thèse inverse. Pour ce dernier, la matrice explicative est d’abord religieuse, à savoir le salafisme venu d’Arabie saoudite. Il est, selon cette approche, très important de penser aujourd’hui l’émergence du djihadisme dans son lien avec la “salafisation”. Car depuis une bonne dizaine d’années, le discours salafiste a acquis une forme d’hégémonie dans l’islam de France.
Pour Kepel, “radicalisation” comme “islamophobie” constituent des mots-écrans qui obnubilent et troublent la recherche en sciences humaines. Le premier dilue dans la généralité un phénomène dont il interdit de penser la spécificité – fût-ce de manière comparative. Des Brigades rouges et d’Action directe à Daech, de la bande à Baader à la bande à Coulibaly ou Abaaoud, il ne s’agirait que de la même “radicalité”. “Pourquoi étudier le phénomène, l’enquête sur le terrain dans les quartiers déshérités où les marqueurs de la salafisation ont tant progressé depuis trente ans, puisqu’on connaît déjà la réponse ? Cette posture intellectuelle de ‘l’islamisation de la radicalité’, connaît un succès ravageur car elle conforte la doxa médiatico-politicienne dans son ignorance de la réalité sociale et son arrogance intellectuelle – toutes deux suicidaires. Le corollaire de la dilution du jihadisme dans la radicalisation est la peur de ‘l’islamophobie’ : l’analyse critique du domaine islamique est devenue, pour les nouveaux inquisiteurs, haram – ‘péché et interdit’”.[5]
Cette difficulté pour de nombreux chercheurs et intellectuels occidentaux à considérer le facteur religieux autrement qu’un simple facteur social, une illusion qui appartient au passé, et jamais en tant que force politique et mobilisatrice à part entière, n’est-il pas que le reflet de nos sociétés sécularisées devenues incapables de penser le religieux ? Pour l’historien et philosophe Marcel Gauchet, “nous allons tout de suite chercher des causes économiques et sociales. Or celles-ci jouent tout au plus un rôle de déclencheur. C’est bien à un phénomène religieux que nous avons affaire. Tant que nous ne regarderons pas ce fait en face, nous ne comprendrons pas ce qui nous arrive. […] Si le phénomène nous échappe, à nous Européens d’aujourd’hui, c’est que nous sommes sortis de cette religiosité fondamentale”.[6]
Pour Jean Birnbaum, la religion fait aujourd’hui l’objet d’un véritable déni, particulièrement dans les milieux intellectuels et politiques de gauche.
Que les djihadistes se réfèrent à un champ doctrinal établi et séculaire, conférant des justifications théologiques émanant de scientifiques érudits de l’islam, qu’ils soient pour la plupart engagés dans une pratique réglementée, sincère et codifiée de leur religion, que chacun de leurs actes trouvent dans leur discours une justification théologique – discours de Amedy Coulibaly aux otages de l’Hypercacher ; revendication de Said et Chérif Kouachi …– qu’à chaque étape de leur radicalisation, ils mettent en avant la religion comme la force motrice de leur action, l’horizon permanent de leurs gestes… “Aucune importance pour les observateurs bien-pensants, les éléments de langage invitent à dépolitiser les attentats et renvoient à la barbarie ou à l’inhumain : ils demeurent uniquement des jeunes victimes d’exclusion ayant mal tournés, des schizophrènes à tendance suicidaire, des paumés manipulés et nihilistes, des déséquilibrés, des dépressifs fortement alcoolisés au moment des faits…”[7]
Cette “impossibilité de nommer le réel” pour reprendre les termes de Michel Onfray, reflète le discours émanant des plus hautes sphères des États européens, France et Belgique en tête. “Leurs plus hauts représentants ont donné le la, répétant une idée et une seule : les attaques n’ont rien à voir avec la religion (islam). Les hommes qui ont commis ces crimes n’ont rien à voir avec la religion musulmane, affirmait François Hollande [ou Charles Michel]. On ne le répètera jamais assez, ça n’a rien à voir avec l’islam, insistait encore Laurent Fabius.”[8]
L’approche géopolitique ou tiers-mondiste François Burgat[9], quant à lui, renvoie dos à dos ces différents postulats. Si l’approche nihiliste rencontre autant de succès, c’est, selon lui, parce qu’elle redit l’inanité de l’approche culturaliste mais surtout parce que contre l’impasse de la “radicalisation de l’islam”, elle propose de penser une alternative, “l’islamisation de la radicalité”, “à laquelle tous ceux qui cherchent désespérément un antidote aux prises de position bellicistes et liberticides que génère le discours culturaliste dominant s’empressent d’adhérer”. Paradoxalement, il rejoint ici Kepel dans sa critique du concept d’“islamophobie”, comme entrave à la démarche analytique.
Pour Burgat, “l’islamisation de la radicalité” est l’énième expression de notre incapacité à construire une perception rationnelle de cet islam politique dont on s’évertue sous d’innombrables prétextes à dépolitiser, comme le fait l’approche culturaliste, les motivations supposées de ses acteurs. Selon l’approche géopolitique, les motivations des djihadistes s’inscrivent dans une riposte aux politiques belliqueuses de l’occident (Irak, Syrie, Mali, Algérie…).
“Car cette thèse de ‘l’islamisation de la radicalité’ ne s’en prend pas principalement à la lecture culturaliste. Elle condamne surtout, une approche dont nous sommes nombreux à considérer que, bien au contraire, elle constitue l’alpha et l’oméga de toute approche scientifique du phénomène djihadiste. Le discrédit du ‘tiers-mondisme’ consiste ici ni plus ni moins qu’à refuser de corréler – si peu que ce soit – les conduites radicales émergentes en France ou ailleurs avec… selon les termes mêmes de Roy, ‘ la souffrance postcoloniale, l’identification des jeunes à la cause palestinienne, leur rejet des interventions occidentales au Moyen-Orient et leur exclusion d’une France raciste et islamophobe’”.
ACCEPTER LA COMPLEXITÉ
Ce qui choque dans ces querelles d’experts, c’est l’impression que chacun tente d’imposer une vision exclusive d’un phénomène pourtant éminemment complexe. La volonté de compréhension amène souvent à réduire les réalités auxquelles nous sommes confrontés à des explications simplistes et rassurantes, comme s’il était difficilement concevable d’assumer et d’accepter la complexité et la diversité de ces processus.
Quel point commun y-a-t-il entre un jeune de Molenbeek ou d’ailleurs, ayant suivi le parcours classique de décrochage scolaire, petite puis grande délinquance, et de “radicalisation” dans le milieu carcéral ; et d’autre part un étudiant modèle ayant choisi de faire des études de polytechnique et ensuite de médecine avant de devenir l’artificier de la cellule belgo-française et de mourir en kamikaze ?
Quel lien entre des paumés européens devenus terroristes et des acteurs du monde arabe ayant suivi pendant de nombreuses années des formations religieuses, pratiquant au quotidien leur religion en suivant avec sincérité les pas des “pieux prédécesseurs”, avant de s’engager corps et âme dans le djihad ?
PEUT-ON IDENTIFIER UNE MATRICE COMMUNE À CES PHÉNOMÈNES ?
Selon Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedoux, le profil unique du terroriste n’existe pas. Cela peut être n’importe qui. Il remet en question la pertinence de vouloir identifier un portrait unique de terroriste puisqu’on sait, par définition, que le terrorisme se décline de manière plurielle.
“On cherche la clé simple, simpliste, pour comprendre l’esprit du terrorisme, mais l’histoire semble montrer que cette logique est vouée à l’échec. Le terrorisme est un mode opératoire, un moyen pour arriver à une fin. Donc, n’importe quel profil peut se prêter à cela. Certains plus que d’autres : ceux qui sont rejetés, ceux qui sont aliénés, ceux qui s’auto-excluent, ceux qui se radicalisent eux-mêmes, et nous pouvons prolonger la liste des causes possibles. Par contre, dresser une liste qui aboutirait à identifier un jeune musulman arabe, de Bruxelles, Paris ou ailleurs, rejeté par la société comme le profil d’un candidat au terrorisme, c’est faire fausse route. Et, surtout, c’est discriminatoire.”
Il n’y a pas si longtemps, les orientalistes, les anthropologues, les sociologues s’inscrivaient dans une démarche d’enrichissement du savoir à travers la complémentarité de leurs approches et observations. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui dans le monde des islamologues où nous observons une réelle concurrence entre chercheurs, une course à la meilleure explication, des rivalités médiatiques et des guerres d’égos. Outre la crispation de l’actualité sur ces questions, on peut expliquer cette évolution par les systèmes de financement de la recherche qui rendent celle-ci de plus en plus intéressée et les intellectuels de plus en plus voraces à dessein de décrocher le pactole des deniers publics ou privés. Le rôle des médias de masse, leur tendance aux raccourcis et leur attrait pour les polémiques sensationnalistes ne sont pas à négliger non plus. Autant d’éléments qui participent aux distorsions compliquant encore la compréhension d’un phénomène si complexe.
1 Professeur à l’Institut européen universitaire de Florence et directeur du programme Religio West.
2 Jürgen Habermas : “Le djihadisme, une forme moderne de réaction au déracinement ”, Le Monde, 21/11/2015
3 Des intellectuels de confession musulmane appellent à une “révolution” dans l’islam”, Le Figaro, 13/01/2015
4 Politologue, spécialiste de l’islam et du monde arabe contemporain. Il est professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris et membre de l’Institut universitaire de France.
5 Gilles Kepel, “‘Radicalisation’ et ‘islamophobie’ : le roi est nu”, Libération, 14/03/2016.
6 Marcel Gauchet, “Le fondamentalisme islamique est le signe paradoxal de la sortie du religieux”, Le Monde, 21/11/2015.
7 Jean Birnbaum, Un silence religieux ; la gauche face au djihadisme, Seuil, 2016.
8 Michel Onfray, Penser l’islam, Grasset, 2016.
9 Politologue, directeur de recherche à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) à Aix-en-Provence.
10 Directeur adjoint et doyen académique du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP) et professeur à l’Institut des hautes études internationales et du développement à Genève et à Sciences-Po Paris.