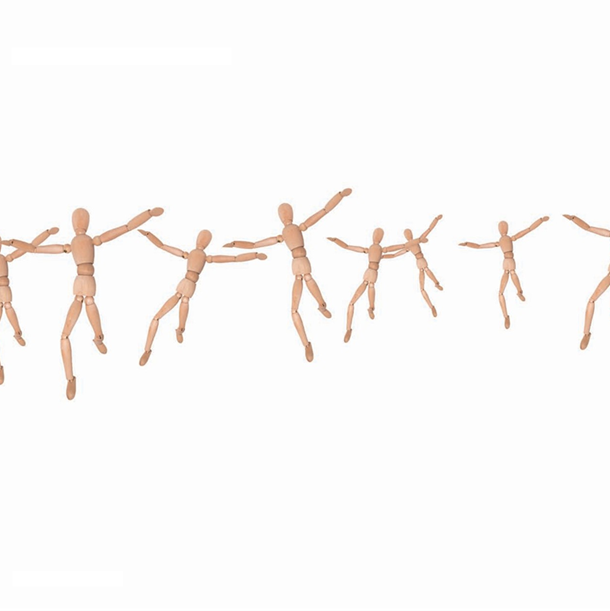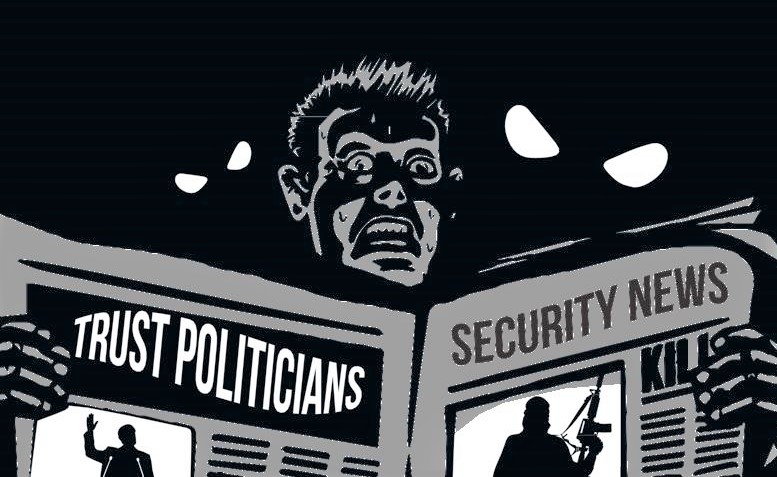Le 11 juillet 2024, soit un mois après les élections régionales, les deux formateurs détaillaient les grandes lignes du futur accord relatif à la Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour cette dernière entité, la question de l’enseignement est forcément centrale. D’abord dans les chiffres : le budget alloué à l’Éducation, la Recherche et la Formation représente plus de 10 milliards, soit 73% du budget total de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2024. Mais, surtout, car l’enseignement reste au cœur du devenir d’une cité. Il constitue en effet cet espace qui doit former des « citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ».[1] Or, c’est également un espace émancipateur, qui doit « assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale ».[2] La question de l’enseignement fait donc, à raison, l’objet d’une attention politique constante dans la gestion d’une cité. La structure du paysage scolaire n’y échappe donc pas, d’autant qu’elle se révèle particulièrement complexe en Belgique. Tentative d’explication.
Pour comprendre le paysage scolaire actuel en Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut savoir d’où l’on vient. Si l’école doit a priori être un lieu de convergence et de solidarité au nom de l’intérêt supérieur des enfants, force est malheureusement de constater que chez nous, elle est un terrain de discorde depuis que la Belgique est née. En effet, le concept de « liberté » qui est un élément central de notre texte fondateur (liberté de parole, liberté de la presse, liberté de pensée…) s’est dès le départ imposé à l’enseignement. Ainsi, notre Constitution belge proclame en 1831 que « l’enseignement est libre ». Cette liberté de l’enseignement a très tôt fait l’objet d’interprétations différentes entre catholiques et libéraux ; les premiers estimant que cette liberté était celle de l’initiative privée et donc totale à tous points de vue, les seconds attribuant à l’État l’obligation d’organiser l’enseignement et que liberté d’enseignement signifiait liberté pédagogique.
L’Église, qui détenait depuis toujours le monopole de l’éducation, s’est donc vue contestée dans ce rôle par les forces progressistes et libérales qui défendent un enseignement public neutre. On voit ici l’enjeu politique que constitue déjà l’enseignement et qui permettra à ces deux systèmes d’évoluer côte à côte, « c’est ainsi que des établissements le plus souvent organisés par l’Église et que l’on appelle « libres » côtoient ceux qui, dépendant des pouvoirs publics, sont qualifiés d’enseignement « officiel » ».[1]
Issu de la première véritable négociation entre catholiques et laïques, le Pacte scolaire de 1959 a mis certains de ces désaccords au frigo en mettant fin à la seconde « Guerre scolaire », même si la plupart des observateurs s’accordent pour dire que les catholiques ont obtenu davantage de concessions. Suite à la révision constitutionnelle de 1988 qui transfère la compétence de l’Enseignement du fédéral aux Communautés, l’article 24 de la Constitution (anciennement 17) est modifié en intégrant le contenu du Pacte scolaire et en en garantissant constitutionnellement les clauses. Les libertés de l’enseignement et du choix de l’école sont donc « consacrées », de même que la gratuité scolaire, le droit et l’obligation des Communautés d’organiser un enseignement neutre, ainsi que celui de bénéficier d’une formation morale ou religieuse. Sur le plan financier, les différents réseaux obtiennent un traitement égal, à l’exception de situations inégales déterminées par des différences objectives. Malgré cette paix scolaire, de nombreux débats actuels ne manquent pas de rappeler toutes les failles de ce pacte scolaire : ceux autour du cours de philosophie et citoyenneté, la question du financement des réseaux confessionnels privés et de leurs bâtiments privés, la dispersion des moyens, la concurrence entre réseaux, ou encore le dévoiement – voire l’instrumentalisation – de cette fameuse « liberté d’enseignement ».
Le paysage scolaire
Le paysage scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles se caractérise notamment par le nombre de « réseaux » qui le constitue. Traditionnellement, on parle de trois réseaux : le premier est le « réseau officiel », qui accueille environ 15% des élèves. Il est organisé par un Pouvoir organisateur (PO)unique : Wallonie-Bruxelles Enseignement et est financé à travers un mécanisme de dotation. Le second est le « réseau officiel subventionné » qui accueille environ 35% des élèves. Il s’agit en grande partie de l’enseignement des communes et des provinces, qui en constituent les PO. Par exemple, le PO de la Ville de Bruxelles comprend plusieurs écoles communales. Ces deux réseaux, c’est-à-dire l’officiel et l’officiel subventionné, forment ensemble l’enseignement public et regroupent 50% des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils sont des services publics (organiques) et en respectent toutes les conditions. Il s’agit donc d’un enseignement neutre et non confessionnel.
Enfin, le 3e réseau est le réseau dit « libre », organisé de manière privée par des ASBL ou des fondations (diocèses, congrégations religieuses, etc.) et regroupe le reste des élèves (excepté par exemple l’enseignement à domicile). Il s’agit en grande partie de l’enseignement confessionnel, essentiellement catholique, mais qui peut aussi être inspiré d’une autre confession (protestante, israélite, islamique, orthodoxe…). Dans ce réseau existe une partie non confessionnelle constituée principalement des écoles à pédagogie active.
Pour schématiser, on s’accorde sur le fait que le paysage scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles repose sur 3 réseaux en fonction des types de PO : le réseau officiel, le réseau officiel subventionné et le réseau libre organisé de manière privée. Ces trois réseaux se regroupent en 2 types d’enseignement : l’enseignement public et l’enseignement libre. Ce dernier comprend en son sein une fédération de PO d’écoles non confessionnelles.
Même résumée, l’ossature scolaire parait extrêmement complexe. Mais ce ne serait qu’un moindre mal si elle n’engendrait pas ce qu’on appelle un « quasi-marché scolaire », facteur d’inégalités scolaires. Pour comprendre ce phénomène, il faut partir de la différence de résultats chez les élèves. En soi, tous les pays du monde connaissent des différences de résultats au sein de leur population scolaire. Mais en Fédération Wallonie-Bruxelles, les études prouvent désormais de manière certaine que la performance des enfants est liée à l’origine socio-économique et au niveau de diplomation des parents. En d’autres termes, si l’enfant nait dans une famille pauvre ou faiblement diplômée, il ne bénéficiera sans doute pas de l’ascenseur social. Ce constat est accentué chez nous, alors qu’il ne l’est par exemple pas au Canada ou en Norvège. Pour expliquer ce phénomène, la ségrégation scolaire offre une piste sérieuse. On en parle lorsque des élèves différents sont scolarisés dans des écoles différentes. La ségrégation peut alors être socio-économique (réelle et forte en FWB) et regrouper les enfants défavorisés dans les mêmes écoles, ou liée à la réussite scolaire (réelle et très forte en FWB) et concentrer les enfants plus faibles dans les mêmes écoles. On observe même que ces deux formes de ségrégation sont liées entre elles puisque les écoles accueillant des publics modestes ont tendance à regrouper des élèves de plus faible niveau. Évidemment, les raisons sont multiples. Il peut s’agir du climat de classe, de difficultés structurelles (recrutement des professeurs, état du matériel…), orientation précoce, culture du redoublement… Enfin, il semble que l’organisation de notre enseignement y joue un rôle particulier, en ce compris l’existence des réseaux et de ce quasi-marché scolaire. Pour prouver cela, il suffit de regarder à la loupe les chiffres des indicateurs de l’enseignement[2] : on observe en effet que les élèves à faible indice socio-économique sont surreprésentés dans le secondaire ordinaire en alternance et le 3e degré technique de qualification, et que les élèves de milieu favorisé le sont dans le 3e degré général. Parallèlement à ces chiffres, l’Appel Pour une Ecole Démocratique (APED)[3] relève la répartition des élèves de 15 ans par quartile socio-économique (en %) selon les réseaux. Il est étonnant de constater que le quartile 4 (les élèves les plus favorisés) représente 31% des élèves du réseau libre privé, alors qu’il atteint péniblement 18% dans l’officiel. À l’inverse, le quartile 1 (les élèves les moins favorisés) représente 19% dans le libre privé, contre 32% dans l’officiel. En d’autres termes, tout en reconnaissant que les facteurs de ségrégation sont multiples et complexes, le lien entre ségrégation scolaire, inégalités scolaires et existence des réseaux devient évident.
Ce lien n’existerait pas sans possibilité de mettre son enfant où l’on veut, car il est alimenté en partie par ce quasi-marché scolaire, lui-même fruit de la polarisation des réseaux, de la liberté de choix des parents et de la liberté de recrutement. Attention, il s’agit ici de pointer les lacunes d’une architecture institutionnelle, et aucunement de pointer le choix ou le comportement des parents qui, à raison, cherchent une bonne école pour leurs enfants. Néanmoins, il faut reconnaitre que ce quasi-marché scolaire porte en lui une concurrence qui n’a aucun point commun avec ce que devrait être un enseignement de qualité centré sur l’intérêt des enfants. Un simple exemple : le refinancement des bâtiments scolaires, soutenu par le gouvernement précédent pour faire face à la vétusté du parc immobilier a vu les réseaux se concurrencer pour obtenir le plus de financement, oubliant que les bâtiments les plus délabrés méritaient d’être rénovés en premier (ce qu’a contesté le réseau libre privé afin d’obtenir coûte que coûte sa part de financement), mais aussi que l’argent public doit avant tout servir à rénover en priorité des bâtiments publics et non des bâtiments privés.
Et avec tout cela, nous n’avons même pas évoqué les faux frais d’inscription que pratiquent certaines écoles du réseau libre privé, incitant subtilement les parents à payer plusieurs centaines d’euros par an et par enfant ; avec comble du cynisme, des réductions possibles pour le second enfant. Comment voulez-vous ainsi ouvrir la porte aux familles de toute condition quand le simple fait de mettre votre enfant à l’école, outre tous les frais classiques, nécessite un budget de 500 à 1000 euros ? Comment imaginer que ces écoles ne pratiquent pas de la ségrégation scolaire, alimentant ainsi les inégalités scolaires ? Comment enfin imaginer que les familles les plus modestes puissent épouser nos fondements selon lesquels « tous les Belges sont égaux devant la loi », ou que la Communauté française remplisse la mission prioritaire d’assurer « à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. » ?
Le Centre d’Action Laïque plaide depuis toujours pour en enseignement unique, neutre, public et gratuit, le seul à même d’offrir à tous les mêmes chances. Si l’on veut que l’école devienne un véritable outil d’émancipation intellectuelle et sociale, il faut qu’elle soit accessible à tous, quels que soient les moyens financiers ou les convictions privées de chacun. C’est pourquoi le CAL apporte son soutien actif à l’enseignement officiel et à un projet de réseau unifié porteur de ces valeurs, en ce compris une grille horaire totalement neutre comprenant 2 heures de philosophie et citoyenneté pour tous les élèves.
Au vu de ces éléments, il nous parait opportun de revenir sur la conférence de presse du 11 juillet 2024. À un moment, un des deux formateurs reprend mot pour mot le slogan d’une pétition du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, en annonçant « qu’un enfant égale un enfant ». Les annonces qui s’ensuivent sur les grandes mesures de l’enseignement ressemblent étrangement aux revendications historiques de l’enseignement catholique, comme l’augmentation des subventions. Or, comble d’un pacte inégal, ce refinancement se fera au détriment de l’enseignement public organisé par WBE… De même, la fusion annoncée des réseaux ne concerne que les réseaux officiels, ce qui impliquera nécessairement des efforts uniquement de la part de ces derniers.
Au final, ces annonces au sujet de l’organisation de notre paysage scolaire s’apparentent à un nouveau « pacte », qui voit une nouvelle fois l’enseignement libre privé gagner sur toute la ligne. Comme si notre enseignement fonctionnait par nature avec des gagnants et des perdants.
[1] Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
[2] Ibid.
[3] Patricia Keimeul, Histoire de l’enseignement, CEDIL.
[4] http://enseignement.be/index.php?page=28740&navi=5002
[5] https://www.skolo.org/2025/03/22/segregation-scolaire-quel-est-le-probleme-et-comment-sen-liberer/