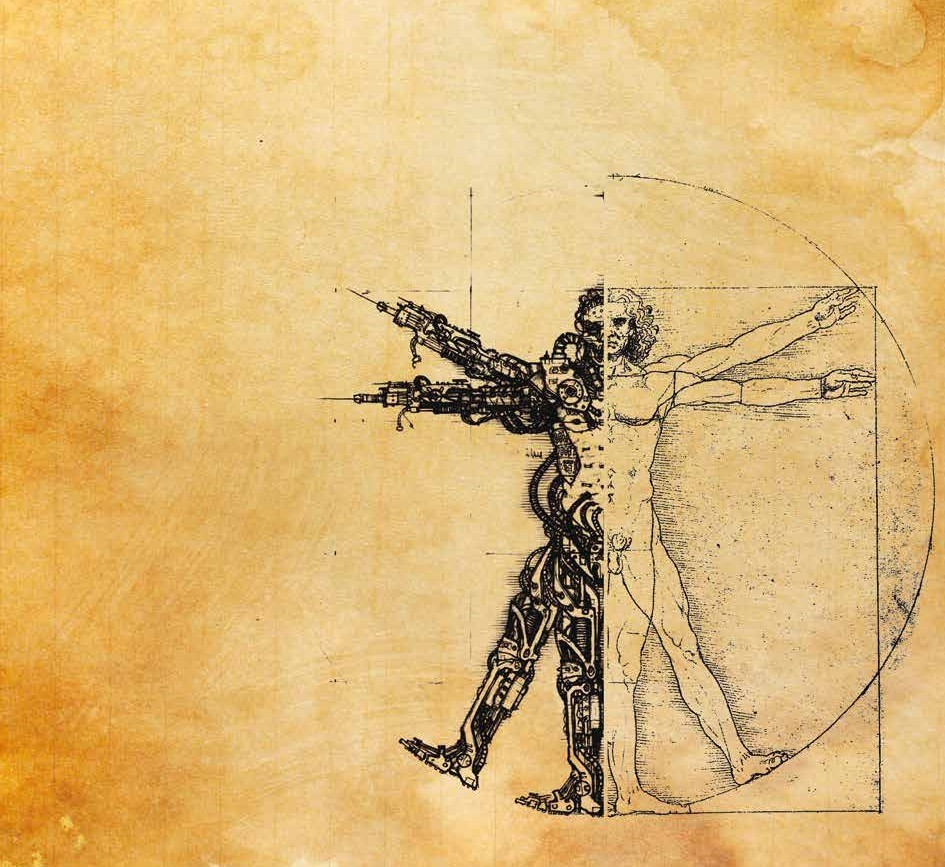Les outils du management humain sont partout. Débarqués de la sphère marchande, ils envahissent aujourd’hui les sphères sociales les plus diverses, du secteur non-marchand jusqu’aux multiples “life coachs” qui nous guident vers toujours plus d’ “excellence”. Il est tentant d’y voir une forme de repli rationaliste face aux incertitudes d’une société post-moderne en crise. Et cette hypothèse n’est sans doute pas sans fondements. Pourtant, y voir un phénomène simplement sociologique nous empêcherait de questionner les ressorts politiques de ce mouvement gestionnaire, tant sur la forme des outils que sur leur finalité.
L’IDÉOLOGIE MANAGÉRIALE
À la fin du XIXe siècle, Frederic Winslow Taylor se penchait sur la productivité des usines américaines avec l’intention nette d’élaborer une théorie scientifique de l’organisation du travail. Le mythe du “one best way” était né. Plus de cent ans plus tard, force est de constater que le monde du travail reste imprégné de cet énoncé gestionnaire. Il n’est bien évidemment pas insensé de chercher une organisation plus rationnelle du travail. En revanche, le phénomène d’ “implémentation1” des outils du management à pratiquement tous les degrés de la société relève de ce que nous pourrions appeler l’idéologie managériale. Cette managérialisation peut être définie comme “l’usage généralisé des techniques d’orientation des conduites, permettant d’atteindre des objectifs normatifs et politiques”.[2]
Le management actuel dans le monde du travail ne repose plus sur la solution unique. L’heure est à l’adaptation, il s’agit de connaître ses collaborateurs et de leur proposer des modes de travail adaptés à leur personnalité et à la particularité du projet. Par exemple, pour mobiliser une équipe dans un but d’efficacité à court terme, en cas de difficulté passagère, vous concentrerez vos efforts sur des collaborateurs compétents et en besoin de reconnaissance en adoptant une posture de meneur. En revanche, si votre objectif est d’attribuer des responsabilités opérationnelles à des collaborateurs constructifs en besoin d’identification au groupe, vous choisirez de vous montrer coopératif.[3] La gestion humaine est aujourd’hui une affaire complexe, mais rassurez-vous, pour chaque problème, il y a une solution !
Si l’heure est à l’adaptation, elle est également à l’autonomie des collaborateurs. En effet, le management participatif, par projet ou d’empowerment, vise très précisément cette compétence. Mais il ne s’agit pas de se méprendre sur la finalité de ces méthodes de gestion humaine : “l’autonomie et la créativité exigées à présent des salariés ne suppriment pas pour autant l’encadrement du travail et son contrôle (…) les salariés restent toujours tributaires des contraintes prescrites par les procédures de certification de qualité et de la pression de la demande”.[4]
QUID DU NON-MARCHAND ?
Si ce modèle de gestion humaine n’est pas récent dans les grandes entreprises à but lucratif, le secteur non-marchand semble pris également dans cette dynamique. La coopération au développement est le premier secteur non-marchand a avoir intégré des outils de gestion de projets venus du monde marchand. Mais ils sont suivis de près par le secteur de la santé, de l’insertion socioprofessionnelle et l’action sociale publique. Cette managérialsiation de l’action sociale repose sur une volonté nette de rationalisation des dépenses publiques. Depuis quelques années déjà, on voit se développer l’idée que l’action sociale serait un coût trop important pour l’Etat et que ce dernier doit pouvoir opérer un contrôle plus important sur les organisations qu’il subsidie. Ainsi, les outils du monde marchand, par leur souci intrinsèque du profit, seraient nécessairement le moyen le plus rationnel de garantir l’efficacité de l’action sociale. On peut donc se voir décliner, avec le développement de l’Etat social actif, quelques logiques contemporaines proprement managériales (voir définition plus haut) qui traversent le champ du travail social en général :
- La territorialisation repose sur l’idée que chaque localité est en proie à des difficultés spécifiques. Cette logique impose donc l’élaboration de diagnostics par l’identification des précarités particulières à la zone géographique et la construction de plans d’action à court, voire à moyen terme. Les plans de cohésion sociale en sont l’exemple paradigmatique. On passe donc très nettement de la logique d’assurance universelle à celle de la discrimination positive.
- L’hyperspécialisation des services d’accompagnement sociaux sont une manifestation de la volonté publique de proposer une solution adaptée à chaque situation individuelle. C’est cette logique qui explique, par exemple, que les services d’hébergement de l’Aide à la jeunesse se déclinent sous plus de quinze formes différentes selon leurs projets (accueil d’urgence, autonomisation, doubles diagnostics, observation et orientation…) et que bien des enfants restent sur liste d’attente, faute de place dans un service adéquat.
- La contractualisation et l’activation se déploient particulièrement dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle. Cette conditionnalité de l’aide assurantielle questionne plus profondément la place que nous réservons aux plus démunis : comment notre société gère-t-elle les pauvres ? Quel contre-don exige-t-on de ceux que nous assistons ? D’une part, elle laisse entrevoir un climat de suspicion vis-à-vis des bénéficiaires de l’aide sociale, qui seraient des “profiteurs passifs et assistés”. D’autre part, elle élimine formidablement la question des responsabilités collectives, c’est-à-dire des responsabilités de la société en tant que fabrique de la précarité.
- Il en va de même pour la tendance à l’individualisation, teintée de psychologisation. Elle repose sur une prédominance de la cause individuelle dans la conception de la désaffiliation. Après tout, quand on veut, on peut. L’étendard de ce phénomène est sans doute celui de l’égalité des chances. Sous l’apparat d’une égalité moderne, l’égalité des chances ne questionne en rien les inégalités. En effet, “le présupposé individualiste de l’égalité des chances (…) promet de transformer la situation de certains individus, tout en laissant inchangées les structures sociales”.[5] Nous voilà donc tous sur la même ligne de départ, mais il y aura tout de même des gagnants et des perdants.
Dans toutes ces logiques, on peut voir un dénominateur commun, celui de responsabiliser l’individu à un degré qui entrave la subjectivation collective, c’est-à-dire la possibilité de s’identifier à une condition sociale. Et les luttes sociales de s’enliser dans une perte de sens favorisant la démobilisation.
A un niveau plus personnel également, les ressources gestionnaires ne manquent pas : introduire “savoir dire non” dans un moteur de recherche Internet vous assure plus d’un million de résultats et recommandations des plus pragmatiques. Il s’agit de se poser en entrepreneur de soi et de mener à bien ses projets pour garantir sa position de “winner”. Et de mesurer combien les conceptions et le vocabulaire marchands ont infiltré nos vies personnelles.
Nous voilà donc cernés par les modèles comportementaux dont les prétendues variations adaptatives peinent à cacher l’uniformité de leur finalité normative.
LES LIMITES DE L’HUMAIN MODÉLISÉ
L’organisation scientifique du travail – ou de sa vie privée – prend aujourd’hui des formes diverses, mais elle reste cloisonnée dans des cadres logiques qui font peu de cas de facteurs humains plus aléatoires tels que l’improvisation, la rêverie, les accidents, le jeu, l’intuition, l’humour…
Et pour cause, ces spécificités personnelles mais surtout imprévisibles ont été analysées par nombre d’auteurs qui, s’ils ont parfois rendu une théorie cohérente, n’ont pu le faire qu’au prix d’une complexité de raisonnement peu compatible avec l’intention schématisante des modèles managériaux. Ce qu’on peut appeler les “comportements d’humeur” appartiennent par définition au domaine de l’imprévu. Mais ils sont également porteurs de possibles, de création et d’innovation. Tenter de modéliser ce potentiel serait par définition le faucher en plein vol. Nous sommes ici dans un dilemme proche de celui du fameux chat de Schrödinger.[6] Impossibilité qui met en lumière l’étroitesse de vue de la gestion moderne des ressources humaines.
Le mythe du “one best way” plane sur les organisations humaines depuis la pensée taylorienne. Une pensée dont les limites ont été démontrées à de nombreuses reprises et qui continue pourtant à dominer le monde de l’entreprise et au-delà.
LA MANAGÉRIALISATION, INSTRUMENT DE REPRODUCTION SOCIALE
Ce constat pourrait se révéler sans conséquences si les courants managérialistes ne revendiquaient pas leur neutralité et donc leur fiabilité. Et aussi, s’ils ne s’érigeaient pas au rang de dogme indiscutable. Or, si l’on s’y attarde quelque peu, on constate aisément que l’idéologie managériale est tout sauf neutre. Elle repose en effet sur des paradigmes qui relèvent d’une “certaine conception de l’économie et du développement économique”[7] : objectivisme, fonctionnalisme, utilitarisme… Ces paradigmes eux-mêmes entendent étayer avec force le modèle néolibéral dominant. Leur atout majeur est certainement de constituer une idéologie qui ne dit pas son nom, et de construire des catégories de pensées qui façonnent nos représentations de ce qui est efficace, de ce qui est raisonnable et rationnel, et donc de ce qui est bon pour nous.
L’idéologie managériale et son infiltration dans (presque) toutes les sphères de notre vie pose donc la question de sa fonction sociale et politique. Sous le slogan “Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions”, on devine aisément les contorsions morales nécessaires à maintenir la productivité, l’efficience et la rentabilité économiques exigées par les outils du management. D’une part, cet arsenal représente un formidable dispositif de reproduction du système économique et social moderne. D’autre part, sa fonction idéologique se pose nécessairement en pensée massive, entravant le questionnement du système qu’il reproduit.
Il semble donc essentiel, face à ce phénomène, de nommer le caractère idéologique de la managérialisation, afin de repositionner ces outils prétendument neutres comme des choix politiques et de se poser la question de savoir quelles valeurs nous souhaitons voir émerger dans notre société contemporaine.
[1] Implémentation : Commercialisation, lancement, Implantation, mise en œuvre, utilisation effective. Source : http://fr.wiktionary.org/
[2] Mehdi Arrignon, “La managérialisation de l’Etat social actif : une perspective comparée (France, Pays-Bas, Espagne)”, Congrès AFSP, 2011
[3] https://www.youtube.com/watch?v=-V_NpfvzGbQ
[4] Mateo Alaluf, “Le retour du puritanisme au travail”, www.econospheres.be, mis en ligne le 24 mars 2012.
[5] Alain Bihr, La novlangue néolibérale. La rhétorique du fétichisme capitaliste, Lausanne, Page Deux, 2007
[6] La théorie du chat de Shrödinger est à l’origine une critique de la mesure dans la physique quantique : un chat est enfermé dans une boîte avec un dispositif qui tue l’animal dès qu’il détecte la désintégration d’un atome d’un corps radioactif. Or, pour savoir si le chat est mort ou vivant, il faut ouvrir la boîte…et donc tuer le chat. Plus d’informations : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chat_de_Schr%C3%B6dinger
[7] Vincent de Gaulejac, “La part maudite du management : l’idéologie gestionnaire”, Empan, n°61, p.30-35