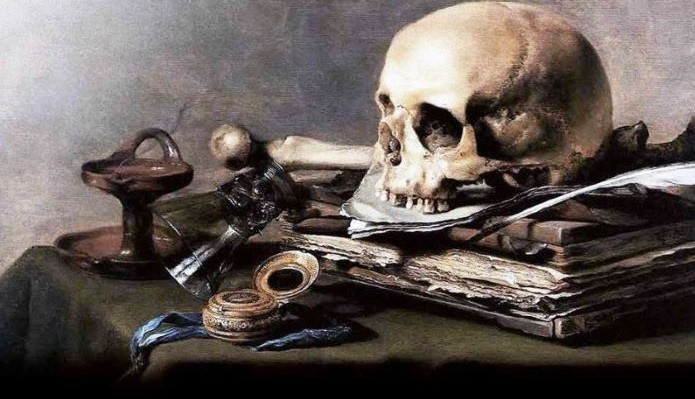Crédit photo : Sylvain Crasset
Vieira de Mello [i]était capable de dialoguer avec tous, y compris avec des interlocuteurs considérés comme infréquentables comme avec les Khmers rouges, et Slobodan Milosevic. Sa méthode reposait sur une conviction : même les pires acteurs méritent d’être écoutés, car refuser le dialogue revient à s’enfermer dans la logique de la guerre. « Il tentait de changer la logique de la guerre en lui substituant une logique qui naîtrait d’une dynamique de transformation, de dialogue, de recomposition ». (Extrait)
C’est dans le cadre à la fois somptueux et chaleureux du lobby du bar de l’hôtel The Hoxton, à Bruxelles, avec ses fauteuils en cuir, ses tables basses, ce mélange de conversations qui s’entrecroisent dans plusieurs langues, un endroit feutré, cosmopolite et chamarré, que l’ambassadeur honoraire Raoul Delcorde a accepté notre invitation avec la politesse discrète de ceux qui ont passé leur vie à représenter leur pays à l’étranger. Sa voix, posée et singulière, reste constante, sans éclats, ses mots, eux, sortent toujours avec justesse. Très vite, la couleur de notre échange est donnée : « Si nous restons uniquement dans le rapport de force, la diplomatie s’arrête. »
Ambassadeur honoraire pour la Belgique en Suède, en Pologne et au Canada, professeur et auteur, Raoul Delcorde incarne une figure rare : celle du diplomate devenu pédagogue, qui continue de croire à la vertu du dialogue alors même que le monde semble se refermer sur ses fractures et fait face à la (re)montée des régimes autoritaires et aux partis d’extrême droite. De l’Asie centrale à Washington, des négociations onusiennes aux crises du Moyen-Orient, son parcours illustre l’ampleur et la diversité des terrains diplomatiques qu’il a traversés. Partout, il a cherché à défendre une conviction simple pourtant si évidente : le dialogue, même imparfait, ne resterait-il pas la seule alternative durable à la confrontation ?
Son regard clair s’anime quand il parle de ses étudiants [ii]et de sa passion à transmettre, ou lorsqu’il évoque son Manuel de la négociation diplomatique internationale, qui fait désormais référence. Enseignant à la fois la patience et l’humilité, il insiste : « Le diplomate ne vient pas imposer ses idées, il vient créer une forme d’empathie avec celui qui lui fait face. » Une définition qui éclaire autant son parcours que la philosophie qu’il transmet.
De ses débuts au Pakistan, où il rencontra les résistants afghans à la fin des années 80, jusqu’aux tensions commerciales entre Européens et Américains à Washington, ses missions ont été autant de laboratoires où s’est forgée sa vision du monde. Fort d’un parcours mené entre terrains de crise et négociations feutrées, il voit dans le dialogue bien plus qu’un principe théorique mais une nécessité concrète, le dialogue est devenu son fil rouge, un outil incontournable qui permet de transformer les rapports de force en espaces de compréhension. Et, dans un monde saturé par le bruit et les fractures, il continue de défendre la conviction que les mots, quand ils sont justes et sincères, peuvent encore ouvrir des portes que la violence condamne.
Le dialogue dans sa carrière
Lorsqu’il évoque ses débuts, Raoul Delcorde dépose un sourire comme si nous y étions (comme un voyage dans le passé) et que tout était encore présent, malgré les années. Nous sommes à la fin des années 80. Jeune diplomate en poste au Pakistan, il observe depuis Islamabad l’ombre portée par la guerre en Afghanistan. À ce moment-là, l’Afghanistan voit le retrait de l’armée soviétique, et les Moudjahidines, figures de la résistance, se regroupent aux frontières. “Je n’ai pas rencontré Massoud, précise-t-il, mais d’autres grandes figures.” La scène qu’il décrit est révélatrice de ce qui le marquera pour la suite : un diplomate occidental fraîchement formé, face à des résistants afghans aux codes et aux récits si différents de l’approche occidentale, et pourtant une rencontre rendue possible par la langue. Il avait antérieurement appris le persan, proche du dari (la langue nationale de l’Afghanistan), ce qui lui ouvrit la porte d’un dialogue authentique. “Si vous faites l’effort de parler la langue de vos interlocuteurs, l’accès est plus facile”, dit-il. Ce principe s’imposait déjà comme une évidence, le dialogue ne commencerait-il par la reconnaissance de l’autre, jusque dans sa langue ?
Quelques années plus tard, le décor a changé, nous poursuivons notre voyage dans le passé à Washington, fin des années 90, au cœur de la présidence Clinton. Raoul Delcorde est alors ministre-conseiller, chargé des affaires économiques. L’Union européenne se heurte aux États-Unis sur les OGM, le bœuf aux hormones ou d’autres différends commerciaux. “L’ambassadeur m’a envoyé rencontrer l’USTR, une petite agence mais très puissante”, raconte-t-il. Pas pour négocier officiellement, ce n’était pas son mandat, mais pour tenter d’expliquer et de faire comprendre, sans tomber dans la posture paternaliste. Il faisait face à des interlocuteurs étasuniens souvent binaires, prêts à diviser le monde entre alliés et adversaires, il s’agissait de nuancer, de montrer que l’Europe n’était pas contre par principe, mais qu’elle défendait d’autres critères, d’autres sensibilités, avec une approche différente. Dans un premier temps l’accueil fut froid, presque hermétique mais à force d’échanges patients, quelques ouvertures se révélaient possibles.
Ces deux souvenirs, l’un sur une frontière instable d’Asie, l’autre au cœur de la première puissance mondiale, forment un motif, une ligne conductrice. Fort de ces expériences, Raoul Delcorde en retire une conviction qui ne l’a jamais quittée : le dialogue ne résulte pas seulement d’un rapport de force ni d’un exercice relevant de la persuasion, mais d’un travail d’empathie. Il ne s’agit pas de convaincre à tout prix, mais de créer un espace où l’autre se sent reconnu, écouté, respecté. Une leçon de diplomatie qui, pour lui, dépasse les contextes et les époques.
Sa philosophie du dialogue
Quand on l’interroge sur la différence entre le débat politique tel qu’on le connaît et le dialogue diplomatique, Raoul Delcorde prend le temps de répondre. Le mot temps est d’ailleurs cardinal dans sa conception. “Le débat politique repose sur l’assertivité, la défense d’un point de vue, parfois avec une dose de confrontation assumée. Le diplomate, lui, n’est pas là pour imposer. Il est là pour écouter, reformuler, faire émerger une compréhension mutuelle, même partielle.” L’empathie n’est pas une qualité accessoire pour lui, elle est au cœur même de la façon de concevoir le dialogue, comme une méthode. Ainsi que l’écoute attentive, presque patiente dirais-je, qui se faisant, devient un outil de travail. Il répète souvent à ses étudiants que le dialogue n’est pas la victoire d’un point de vue sur un autre, mais l’exploration d’un chemin commun.
Il y a chez lui cette nostalgie discrète pour une époque où la diplomatie se pratiquait loin du tumulte numérique. Il évoque par exemple les négociations qui mirent fin à la guerre du Vietnam. “Kissinger venait en secret à Paris, parfois sans prévenir même les autorités françaises, et rencontrait Le Duc Tho dans une villa à Neuilly. Cela a duré des années, mais cela a fini par aboutir.” Dans sa voix, on sent le respect pour cette diplomatie de l’ombre, fondée sur la confidentialité, la confiance et presque le secret. “Aujourd’hui, dit-il, le secret est devenu suspect. Mais sans espace protégé, sans confiance, il est très difficile de négocier quoi que ce soit.” À l’heure des tweets présidentiels et des postures publiques, il s’inquiète de la perte de cette profondeur silencieuse.
Cette vision du dialogue prend racine dans une éthique précise fondée sur le respect, la tolérance et la compréhension du monde de l’autre. “Le compromis, ce n’est pas la compromission”, insiste-t-il. L’art de la négociation repose sur la capacité à reconnaître des points incontestables chez l’autre, à céder sur des détails pour davantage préserver l’essentiel. Ce qu’il transmet à ses étudiants, c’est que l’enjeu n’est pas de gagner une bataille d’arguments, mais de préserver une relation, même en cas de désaccord, ce qui fait échos face aux tensions que l’on connait aujourd’hui.
Enseignant (entre autres) la négociation diplomatique internationale, Raoul Delcorde aime rappeler que ce métier commence souvent par l’échec. Il cite Kissinger encore, qui a mis près de cinq ans à aboutir à un accord avec le Vietnam. “Un désaccord ne doit pas conduire à l’hostilité, mais à la recherche d’un compromis”, répète-t-il. Le dialogue, selon lui, ne serait pas un exercice d’éloquence, mais plutôt un acte de patience. Un art du lien, en somme. Et il continue de défendre cette conviction, cours après cours, génération après génération.
Regard sur le monde actuel
Lorsque nous évoquons la situation internationale, son ton se fait plus mesuré, presque soucieux, faisant disparaitre ce sourire déposé, dont nous parlions au début de ce portrait. Le multilatéralisme, auquel il a consacré une partie de sa carrière, est aujourd’hui en crise profonde. “Le Conseil de sécurité de l’ONU n’est plus le cockpit du monde”, dit-il. Les vetos s’y neutralisent, les agendas s’y bloquent, et les grandes décisions en matière de sécurité ne s’y prennent plus. L’ONU, fondée sur le principe qu’un État vaut une voix, se trouve concurrencée par de nouvelles institutions d’influence comme les BRICS, plus informelles et moins contraintes par les valeurs universelles qu’incarnait la conférence de San Francisco en 1945 (qui aboutit d’ailleurs à la création de l’ONU). À ses yeux, nous sommes revenus à un monde de rapports de force, où Trump, Poutine, Xi Jinping et d’autres dirigeants imposent leurs logiques bilatérales au détriment du collectif. Même l’Union européenne, censée incarner une forme de multilatéralisme interne, peine à trouver une voix commune. Les divisions entre États membres, accentuées par la montée de l’extrême droite, révèlent la fragilité du projet européen quand il s’agit de parler d’une seule voix face aux grandes puissances.
Faudrait-il alors céder au cynisme et admettre que le dialogue n’aurait plus sa place et légitimité ? Raoul Delcorde refuse cette thèse, lui qui connaît si bien les limites de la diplomatie : elle n’a pas empêché l’invasion de l’Ukraine, ni les massacres en cours à Gaza. Mais il y voit une raison de plus pour la maintenir. Et comme il le dit “Toute guerre se termine par une négociation”. Même une négociation imparfaite, reprise après des échecs, vaut mieux que l’enlisement du conflit. Le rapport de force ne peut être une fin en soi ; il n’ouvre aucune perspective de paix durable. Le dialogue, au contraire, représente ce temps long de la patience et de la persévérance qui, tôt ou tard, redevient inévitable et finit par payer. Dans sa voix, on peut deviner une conviction qui s’est forgée au fil des années qui dirait que la diplomatie n’est pas la garantie de la paix, mais que sans diplomatie, aucune paix n’est possible.
Cette conviction est alimentée aussi par des exemples qui l’inspirent. Il cite avec admiration Sergio Vieira de Mello, diplomate brésilien et haut-fonctionnaire de l’ONU, mort à Bagdad en 2003 dans l’attentat qui détruisit les bureaux onusiens. ” Il incarnait la foi dans une humanité commune transcendant les États et leurs intérêts fondamentaux. ” dit Delcorde. Vieira de Mello était capable de dialoguer avec tous, y compris avec des interlocuteurs considérés comme infréquentables comme avec les Khmers rouges, et Slobodan Milosevic. Sa méthode reposait sur une conviction : même les pires acteurs méritent d’être écoutés, car refuser le dialogue revient à s’enfermer dans la logique de la guerre. « Il tentait de changer la logique de la guerre en lui substituant une logique qui naîtrait d’une dynamique de transformation, de dialogue, de recomposition » comme disait son épouse Carolina Larriera à son propos. En parlant de lui, Raoul Delcorde laisse percevoir une situation idéale, celle d’une diplomatie qui ne renonce jamais.
À l’heure où les murs s’érigent, où les frontières se ferment et où les discours se crispent, il continue de croire aux ponts. C’est une conviction presque obstinée, qu’il défend sans éclats de voix, avec le calme de ceux qui savent que le temps joue toujours en faveur de la parole. Dans un monde où domine le bruit, sa patience rime avec résistance.
Somme toute, les guerres et les tensions s’enchaînent, les rapports de force dominent, les régimes autoritaires et l’extrême droite s’étendent de plus en plus, opacifiant l’importance du dialogue dans nos sociétés. De son parcours, il garde une certitude : même dans les pires contextes, le dialogue finit toujours par s’imposer comme la seule issue possible. Ici, il ne s’agit pas de l’illusion d’une personne pacifiste mais de la conviction lucide d’un diplomate : malgré la brutalité du monde, les mots gardent la force d’ouvrir un espace de dialogue.
[i] Ancien haut-commissaire au Nations-Unies
[ii] Raoul Delcorde enseigne comme Professeur invité à l’UCLouvain et à l’université Senghor d’Alexandrie. Il est également doublement académicien en tant que membre titulaire de l’Académie royale de Belgique ( Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques) et membre associé de l’Académie des sciences d’outre-mer ( France).