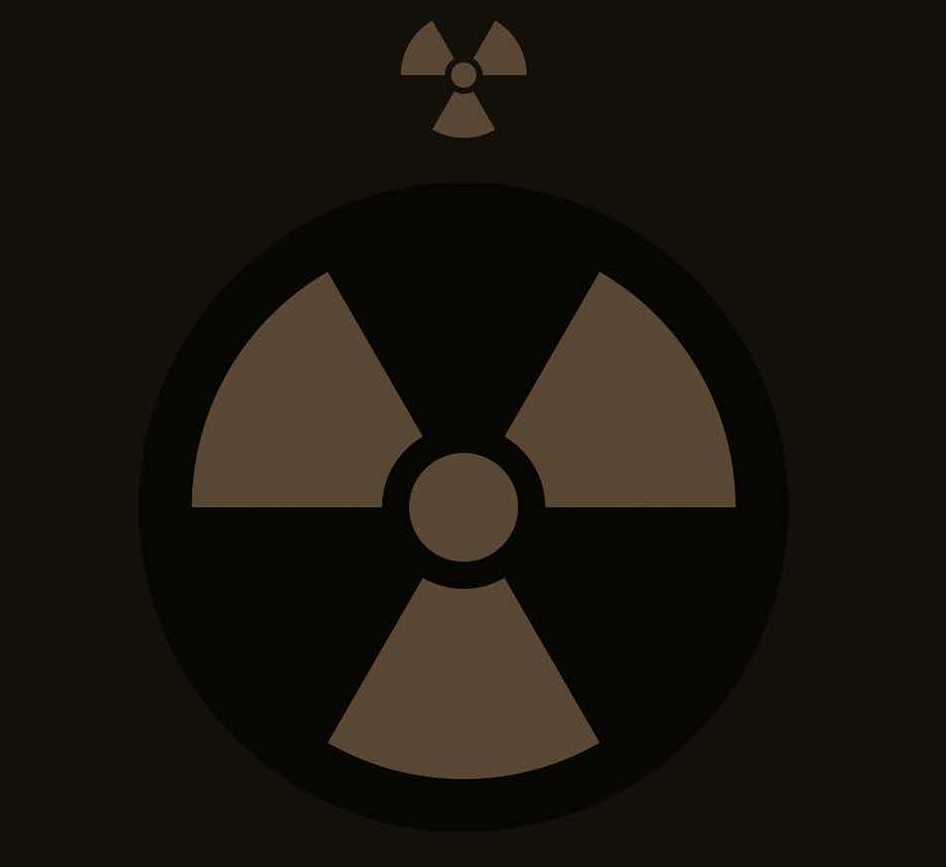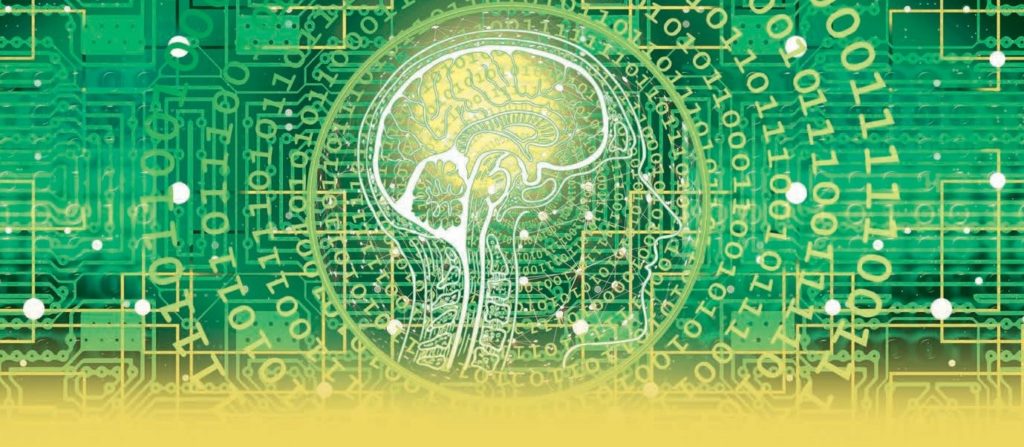Je me suis autoproclamé collapsologue dès que j’ai su que ça existait. En fait, c’est faux, je ne fais que vulgariser ce que dit la collapsologie. Mais j’ai commencé avant elle. Alors je ne sais pas trop d’où je parle… Il faut que je vous raconte tout ça. Et maintenant, je ne sais plus si je dois m’en féliciter ou en pleurer. Faut-il abattre la collapsologie ou la défendre ? Je vais prendre le temps de vous exposer mes doutes avant de conclure sur le capitalisme.
MON PARCOURS DE COLLAPSOLOGUE
1997, j’ai vingt ans. Je suis en première année de faculté de Sciences Économiques et je me demande comment marche le monde. Je m’intéresse à la question du pétrole, je lis des blogs, des revues, des livres. Je n’en reviens pas de ce que je lis, je croise mes sources et je pousse mes investigations. Mes copains aussi trouvent mon hobby bizarre. Ce que je trouve étrange pour ma part, c’est de ne pas s’y intéresser.
Ce qui était un hobby, une forme d’enquête militante sur l’avenir de l’humanité à partir de données scientifiques, devient au fil des années une angoisse : je comprends qu’il ne s’agit pas d’une théorie complotiste. Les experts conseillant les multinationales de l’énergie et les gouvernements savent que notre modèle de civilisation n’est pas tenable et que plus tard nous en changerons, plus violente sera la chute. L’élite de Davos connaît ces données.
Pourquoi ne font-ils rien ? Une société cherchant politiquement à minimiser son utilisation du pétrole serait contrainte d’abandonner les voitures individuelles, les transports aériens, les zones pavillonnaires, la mode, le made in china, les carrières dans le tertiaire… Un tel programme politique n’arrangerait pas cette élite mais n’aurait aucun soutien populaire non plus.
2007, j’ai trente ans et je suis en première année de la coopérative d’éducation populaire Le Pavé que je viens de cofonder avec cinq autres personnes dont Franck Lepage qui joue les premières d’un spectacle, nommé Inculture(s). Cette forme, à cheval entre la conférence et le récit vécu, pourrait me permettre de restituer ce qui me hante : l’effondrement, dans les années à venir, de notre mode de vie. La première de la conférence gesticulée que j’intitule “Faim de pétrole” sera jouée à l’automne 2008 dans un bar coopératif renais.
Suivent une quarantaine de dates où j’assume difficilement les effets de mon discours sur mes auditoires : une partie est plus ou moins traumatisée par ce qu’elle entend, une partie cherche à m’expliquer que la science va nous sauver et une partie cherche à invalider mes hypothèses, ou mes données, ou mes références, ou moi directement.
Alors, petit à petit, je vais enlever certains éléments montrant l’interconnexion entre les crises économiques, écologiques et sociales. Et je vais rajouter des morceaux : une autocritique de la posture militante sacerdotale, pour désamorcer une partie de ce que ma conférence provoque et, surtout, des pistes de “solution”, qui n’en sont pas, pour conclure positivement, sur la résilience et l’action directe non-violente. Je vais jouer cette nouvelle version, intitulée “Le plein d’Énergie” une centaine de fois.
2015, j’assiste à une conférence sur la collapsologie à l’université d’été des décroissants. Un ingénieur suisse dit tout ce que je n’ose pas dire, ce que je n’ose plus dire, trop seul pour assumer de porter ce message. J’ai alors le sentiment de trouver ma famille idéologique, après une traversée de vingt ans dans le désert.
LES ANGLES MORTS DE LA COLLAPSOLOGIE
Le paradigme de la collapsologie m’a séduit parce qu’il me semblait pragmatique et humaniste. Pragmatique parce qu’il renonce à sauver la Terre telle qu’elle était, accepte de composer avec tous les acteurs institutionnels et réfléchit à partir de notre modèle industriel. Humaniste parce qu’il invite à transformer nos politiques publiques afin de concentrer nos efforts sur les populations les plus exposées aux conséquences d’un effondrement de société, c’est-à-dire, pour faire court, les classes populaires.
Mais, pour des raisons qui m’échappent encore, les effets de ce paradigme sur l’imaginaire politique des personnes qui s’y trouvent confrontées ne sont ni pragmatiques ni humanistes. Peut-être que je suis trop attentif au verre à moitié vide, mais peut-être aussi que le ver est dans le fruit.
Alors, comme vous connaissez sans doute déjà les thèses collapsologiques, je choisis d’exposer ici mes doutes sur la collapsologie plutôt que de défendre l’intérêt de cette thèse. C’est-à-dire que je vois se diffuser, sous couvert de réflexions collapsologiques, des positionnements douteux : essentialistes, anti-sociaux, anti-urbains, et court-termistes, l’ensemble conduisant à privilégier des pratiques individuelles et spirituelles aux pratiques collectives et politiques. Alors, si je peux me permettre, cela mérite d’être clarifié.
Court-termiste parce que les annonces tant sur l’état de la Terre que sur la raréfaction des ressources naturelles explicitent que le point de rupture est pour bientôt, ou même qu’il est déjà trop tard.
La collapsologie pousse à se croire malin en faisant dès maintenant sécession de la société. C’est chacun pour soi, avec ses potes. Chercher des solutions viables dès demain, c’est renoncer au temps plus long du politique, c’est faire l’autruche face à toutes les sortes d’inégalités.
Derrière la recherche d’alternatives concrètes à petite échelle, je vois se renforcer un individualisme crasse et bien-pensant, reconnaissant la compétition sociale comme réalité indépassable. Qu’y peuvent-ils s’ils font partie de cette élite qui sait, et donc, qui pourra probablement mieux s’en sortir ?
Il y a là une confusion temporelle : quoi qu’il se passe au XXIe siècle et même si l’humanité devait disparaître avant la fin du siècle, l’environnement humain restera industriel : l’Europe ne voyagera pas à cheval d’ici dix ans et nous allons réparer nos bagnoles, comme le fait l’Afrique depuis longtemps déjà, pendant encore quelques dizaines d’années. Et sans doute la tentation va grandir que d’empêcher les pauvres de continuer à polluer.
Essentialiste parce qu’en mettant sur la table un effondrement de civilisation, nous sommes obnubilés par les besoins dits primaires : se nourrir, se vêtir, se loger, se chauffer. La réponse à ces besoins renvoie à des métiers, des compétences, des univers masculins, à part les vêtements, où les compétences sont plutôt enfantines et asiatiques. Ce biais, lié au problème de genre, pousse à invisibiliser d’autres besoins essentiels d’un groupe humain : prendre soin des enfants, des malades, des vieux, des fous, ou encore l’hygiène (ne pas fabriquer la lessive, mais s’en servir…), l’éducation des enfants, l’attention aux voisins et l’accueil des autres… Qui va faire tout ça pendant que Monsieur permaculte et coupe du bois ?
“Et oui, mais c’est comme ça, il va falloir s’appuyer sur les tendances naturelles des hommes et des femmes pour s’en sortir”ai-je le sentiment de lire dans les têtes, parce que ça ne se dit pas tout haut. La collapsologie comme espoir d’une émancipation dans le monde d’après est tout de suite moins visible pour une femme. Et donc pour un homme. Le patriarcat va-t-il trouver là un nouveau mythe fondateur ?
Anti-social parce que l’univers des solutions tourne autour de l’éco-lieu résilient, c’est-à-dire à l’échelle de l’entre-soi. Ce mode de pensée orienté solution caractérise les ingénieurs qui nous ont foutus dans ce merdier : il court-circuite l’analyse.
Si ces habitats groupés d’ingénieurs blonds repentis et d’universitaires dépités et mal rasés sont effectivement la solution, alors cette solution consiste à vouloir vivre entre blancs éduqués au milieu d’une population qui meurt de famine et de maladies. C’est illusoire. Cette vision est aussi stupide que celle des milliardaires pensant s’en sortir en construisant des complexes de luxe sur des îles désertes ou des abris anti-nucléaires à quarante mètres sous leur villa.
Le néo-libéralisme a-t-il un nouvel allié infiltré à gauche, délégitimant, au nom du réalisme politique et de l’urgence écologique, la défense des services publics, d’une protection sociale efficace et de liens de qualité avec les autres communautés les entourant ?
Antiurbains parce que ces écolieux où madame s’épanouit dans la maternité pendant que monsieur retrouve sa masculinité sont évidemment situés dans le monde rural, qu’ils appellent la nature sacrée, souvent avec des dénominations primitives, comme la pachamama. Ce qui me semble sacré, c’est plutôt la méfiance des classes populaires et des étrangers, symboles des populations urbaines. Ces gens sont trop nombreux, trop ignares, pas assez organisés et trop victimes des rapports de domination qui pèsent sur eux pour que nous puissions imaginer quoi que ce soit qui les inclue. Ces gens vivent hors-sol et le revendiquent par leur consumérisme assumé, alors que nous, au moins, on culpabilise, alors tant pis pour eux.
Je pense que s’il y a des pénuries de nourriture, ce sont évidemment d’abord les villes qui seront ravitaillées. Et, à part la nourriture hors-période de famine, c’est sans doute dans les villes qu’il sera possible de s’approvisionner. La xénophobie qui caractérise les survivalistes enrôlera aussi à gauche grâce à la collapsologie.
C’est pourtant du côté des liens de réciprocité à réinventer entre les villes et les campagnes qu’il faudrait creuser.
LA COLLAPSOLOGIE AU SERVICE DU CAPITALISME ?
Je ne dis pas ici que tous les éco-lieux sont les graines du fascisme vert à venir, on ne se connaît pas encore assez pour ça mais, plutôt qu’en tant que blancs éduqués, nous avons le devoir éthique de ne pas mélanger positionnement politique, choix de vie individuels et développement personnel.
On peut être végétarien, faire du yoga, et être sincèrement de gauche, c’est-à- dire ne pas mépriser le peuple et chercher à faire avec lui et non sans lui ou à sa place, certes. Mais la collapsologie est également un écran de projection de nos angoisses et de nos fantasmes, et elle convoque de premier abord et pour beaucoup un imaginaire bio-libéral.
Pour ma part, je reviens aux formes d’engagement et aux idées que je prônais, et que je prône toujours, hors de l’univers de la collapsologie. Alors, à quoi bon faire ce détour ? Eh bien, je ne l’ai pas choisi, il s’est imposé à moi, à travers des questions philosophiques, certes pas bien neuves : qu’est-ce que je fous là ? Que faire de ma vie ? Et de celle des autres ? Qu’est-ce qui est important, dans le fond ?
Et ça ne m’étonne pas que, dans un univers idéologique néo-libéral, les réponses de premier abord à ces grandes questions philosophiques soient individuelles et spirituelles plutôt que collectives et politiques.
Comme c’est intéressant pour un militant humaniste et progressiste d’éprouver ses convictions politiques en se posant frontalement ces questions de soi à soi dans un avenir si incertain ! La collapsologie, en posant crûment ces questions, a le mérite de dévoiler clairement ces influences néo-libérales sur nos imaginaires politiques. Pour mieux les combattre ou pour mieux les accepter ?