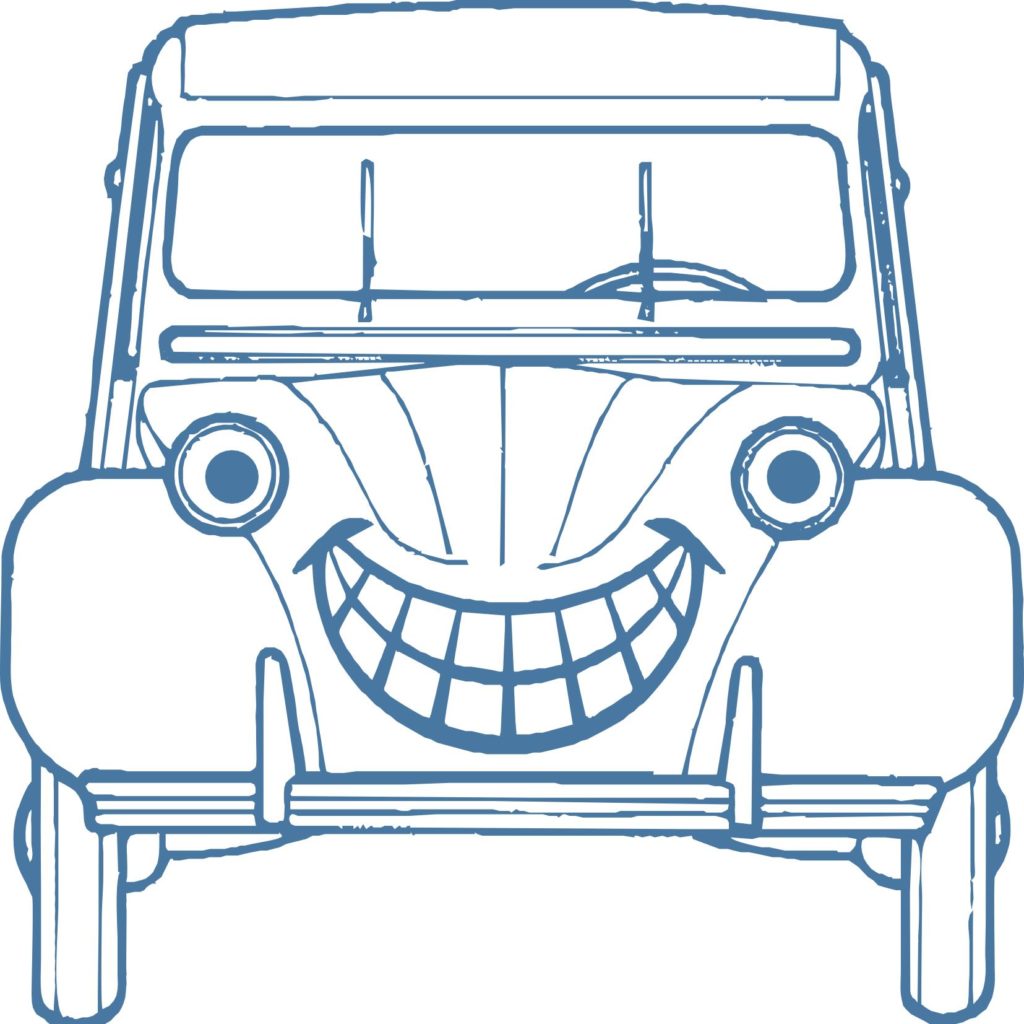18 ans, ça se fête ? Pas forcément. Lorsqu’on est MENA (mineur étranger non-accompagné), qu’on est venu seul en Belgique dans l’espoir d’une vie meilleure, à 18 ans, la vie bascule : plus d’accès aux aides, plus de tuteur, plus de projet pédagogique ni scolaire. Du jour au lendemain, on se retrouve seul, face aux démarches, aux responsabilités, aux choix quotidiens, aux choix de vie. Rencontre avec Mombi[1] dans les bureaux de l’association Maison Babel (cf encadré), autour d’un verre de thé, pour comprendre ce que vit un jeune violemment propulsé dans l’âge adulte parce que “étranger”.
JG (Julia Galaski) : Que veut dire pour toi “être jeune”, “devenir adulte” ?
M (Mombi) [réfléchit en souriant, un verre de thé à la main] : En tant qu’adulte, on connaît et on comprend certaines choses qu’on ne comprend pas encore quand on est jeune. On devient adulte en étudiant les gens. En tant qu’enfant, on apprend à vivre avec les parents, on les observe. Plus tard, on apprend à vivre avec d’autres gens, à écouter les adultes, puis à s’exprimer, à faire sortir les choses.
Quand on ne connaît pas, on demande.
En parlant, en partageant avec d’autres, on grandit, on apprend.
JG : Ces termes ont-ils la même signification ici et dans ton/tes pays d’origine ?
M : Ici, on devient adulte à 18 ans. En Afrique, en Côte d’Ivoire d’où je viens, ce n’est pas pareil. Je n’ai pas été à l’école.
Ici, l’école c’est tout. Il faut savoir écrire. En Côte d’Ivoire, on apprend dans la rue quand on n’a pas les moyens d’aller à l’école, on apprend à utiliser son cerveau. J’ai rencontré beaucoup de gens avec ma mère. Elle m’a appris le respect, comment vivre avec d’autres. Pas forcé ment en discutant avec eux, mais en les écoutant. Le voyage forme aussi, ça fait vieillir. J’ai beaucoup appris aux côtés de ma mère, et puis en partant à l’aventure.
JG : Y a-t-il des choses qui t’ont étonné, en tant que jeune, en arrivant en Belgique ? Des choses que tu as aimées, moins aimées ?
M : Il y a une chose que je n’ai pas comprise, ici, c’est que certains jeunes ne respectent pas leurs parents. Ils disent “putain” devant eux, par exemple. Chez nous, on se construit chez soi, dans le respect, avant de se construire à l’extérieur.
Ce que j’ai aimé en arrivant, c’est que je suis allé à l’école pour la première fois. Et puis j’aime le foot. C’est là que j’ai appris comment vivre avec d’autres gens en Belgique. Pourtant, certaines personnes venant d’autres pays te découragent. Et il est vrai que souvent, les gens ici qui t’apprennent les lois et les règles du pays, ne les respectent pas eux-mêmes.
JG : Tu as un exemple ?
M : Un jour, à l’école, en cours d’intégration, une prof avait perdu son téléphone. Elle nous a suspectés de l’avoir pris, elle a appelé une autre prof et une éducatrice et ils ont décidé de nous fouiller. Oui, je sais que c’est illégal. Et une assis tante sociale a demandé si elle était sûre de ne pas l’avoir sur elle, mais elle a dit que non. On a été fouillés. Ils n’ont rien trouvé. Le lendemain, elle avait à nouveau son téléphone. On lui a demandé où elle l’avait trouvé, elle a dit : “Ça ne vous regarde pas”. Sa collègue nous a dit après qu’elle l’avait retrouvé dans sa voiture. Je n’ai plus voulu étudier dans son cours. Elle aurait dû nous dire qu’elle l’avait retrouvé et elle aurait dû s’excuser. Mais elle ne l’a pas fait.
Il y a des gens qui connaissent les règles, qui les respectent, qui vont bien agir dans une situation comme ça, et d’autres non. Il y a des Blancs racistes, mais tous ne le sont pas. Il y a des Noirs racistes aussi. La question, ici comme ailleurs, c’est comment vivre dans le respect.
Dans le Centre Fedasil, nous étions 400- 500 personnes, des familles, des adultes, des jeunes comme moi. Dès mon deuxième jour, un homme m’a dit “Si tu es gentil avec nous, on sera gentil avec toi. Si tu ne l’es pas, on ne le sera pas non plus”. C’est bizarre comme phrase. Il imaginait quoi ? Je suis quelqu’un de tranquille. Mais certaines choses m’ont obligé de parler.
Quand je suis arrivé, on faisait beaucoup d’activités avec les assistants qui nous expliquaient comment vivre à Bruxelles, comment sortir, prendre les transports. J’ai beaucoup appris avec eux. Mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup d’injustice. Je respecte tout le monde, je respecte les règles. Mais quand d’autres ne les respectent pas, il faut en parler pour que ça change. Mais même lorsqu’on parle, ça continue.
Un jour, je suis rentré du foot et le resto du centre allait fermer. Un ami était parti en ville avec mon badge et tu as besoin de ton badge pour manger. Il y avait un nouvel employé depuis deux mois, avec une mauvaise réputation et il a refusé de me donner à manger. Deux éducateurs qui me connaissaient bien n’ont rien dit. Puis, un autre homme est arrivé sans badge, et l’employé l’a laissé passer. Ils avaient la même nationalité et il a été servi. Je me suis levé. J’ai poussé une chaise, j’ai dit que c’était raciste. Les éducateurs sont intervenus, je leur ai dit “Vous étiez là : je n’ai pas protesté quand il a refusé de me servir, mais maintenant qu’il a donné à manger à l’autre, vous auriez dû dire quelque chose.” J’ai demandé à parler au directeur, pour savoir si c’était de lui que provenait ce règlement. Mon assistante sociale a dit qu’il n’était pas disponible pour le moment. J’ai attendu pendant une semaine, pour voir si on reviendrait vers moi. Puis je l’ai rappelée, elle a dit qu’il reviendrait vers moi quand il sera dispo.
Quelqu’un est venu me voir beaucoup plus tard pour me dire qu’ils en avaient parlé en réunion, que le directeur était très fâché, que ça n’allait plus se répéter. Je leur ai dit “Je sais que j’ai raison, il ne faut rien m’expliquer, mais j’ai envie de parler directement avec le directeur, pas avec vous”. Mais ce n’était pas possible.
Il y a eu une bagarre, quelques temps après, entre mon ami et son voisin de chambre. Ça faisait des semaines que mon ami prévenait tout le monde que la situation était difficile dans la chambre, mais personne n’a rien fait. Et en cas de bagarre on est transféré dans un autre centre. En rentrant du travail, le lendemain, j’ai appris qu’il avait été transféré. Personne n’a su me dire pourquoi.
Quand on vit au centre, ce sont les amis qui te donnent le sourire. Seul, c’est difficile. Je savais que le transfert n’était pas juste. Je leur ai dit que si personne ne m’expliquait cette décision, je finirais par être transféré moi aussi. J’ai encore demandé un rendez-vous au directeur. Mais on m’a envoyé quelqu’un d’autre. Quand j’ai enfin parlé au directeur, je lui ai dit que ma confiance était brisée. Une employée m’a dit que le transfert n’avait pas été juste, mais elle ne travaille plus là-bas. Elle est partie.
JG : Y a-t-il des lieux où tu te sens en confiance, où tu te sens chez toi, des personnes à qui tu fais confiance ?
M : Je fais confiance à Audrey [une travailleuse de Maison Babel présente lors de l’entretien et qui le connaît depuis plus de 3 ans]. Et à mon ami BG. Il faut se connaître depuis longtemps pour faire confiance. Je ne peux rien leur donner et ils ne peuvent rien me donner, mais quand on est ensemble on peut quand même s’aider parfois.
Dans la vie, il faut que des choses t’arrivent, il faut passer par certaines difficultés pour apprendre à mieux connaître les gens, pour savoir qui peut te conseiller, pour apprendre à te faire confiance aussi.
Je me sens chez moi aussi sur le terrain de foot. Et chez mon ami BG. C’est là que je suis entouré d’amis. C’est comme ma famille. Au CEFA,[2] je travaille la soudure, j’aime beaucoup aussi. On fait un peu de tout, de la mécanique et de la peinture également. Quand on parle avec des gens, ça fait sortir les choses du corps.
Les conseils des gens m’ont aidé. Ma mère aussi me donnait des conseils.
Et je me sens bien quand j’écoute de la musique. Du reggae, Alpha Blondy, Bob Marley… Quand je suis découragé, quand je baisse les bras, ça me motive.
Quand j’écoute Alpha Blondy surtout, j’ai l’impression que j’y suis, je le vois au fait.
JG : Tu t’intéresses à la politique ? Si tu avais la possibilité de changer quelque chose, ici ou ailleurs, ce serait quoi ?
M : La politique dans le monde m’intéresse, oui. Mais je n’aime pas ça. [Son téléphone sonne, il l’éteint sans le sortir de son jean]. Si ça ne va pas aujourd’hui dans le monde, c’est à cause de la politique. En Afrique, à chaque élection, il faut du sang. Je ne comprends pas ça, ces guerres entre ethnies. Le Président dit qu’il va faire quelque chose, mais il ne fait rien. Il y a des discours, mais ils ne sont pas suivis d’actes. On s’entretue à cause de rien. Et quand on voit ce que fait Macron au Mali, la Françafrique, ça ne va pas non plus. C’est pareil pour d’autres présidents africains, au Sénégal, en Guinée… ces pays n’ont pas été colonisés par la France, mais ils ferment aussi leurs frontières avec le Mali. Ce qui intéresse les dirigeants, ce sont leurs propres intérêts, pas ceux du peuple. Il n’y a pas de solidarité.
Si je pouvais changer quelque chose, j’enlèverais tous les présidents africains et aussi la France et tous les autres pays colonisateurs qui sont encore en Afrique, je créerais une Union africaine sans frontières.
JG : On dit que quand on est jeune, on a beaucoup de rêves. C’est quoi ton rêve à toi ?
M : [Il réfléchit, se redresse] J’aimerais pouvoir tout faire pour qu’en Afrique les enfants dont les parents n’ont pas les moyens de les mettre à l’école ou à l’école coranique, aient la vie plus facile, pour qu’ils puissent apprendre un métier. Il y a des enfants de six, sept, huit, dix ans, qu’on appelle les “microbes”, qui se promènent dans la rue avec un couteau à la main. Ils sont mal entourés et quand on a pris le mauvais chemin, c’est difficile d’être conseillé. Sans parents, c’est très difficile. Il y a des gens plus âgés derrière eux qui les poussent à devenir des bandits, il n’y a personne pour conseiller les petits frères.
JG : Est-ce que selon toi les jeunes ici sont assez écoutés ? Comment se faire entendre ?
M : Pas vraiment. Ici, à l’école, quand les jeunes veulent parler, c’est le prof qui parle, qui étudie les jeunes. Il faudrait organiser une journée où les jeunes, ceux qui viennent d’ailleurs, peuvent parler de politique et de leur vie quotidienne. Un jour par an, où tout le monde les écoute. Il y a beaucoup à apprendre en les écoutant. Dans le centre Fedasil où j’étais, on était là pour différentes raisons, mais pour apprendre. [il réfléchit] Les Belges aussi ont vécu des choses.
Beaucoup de migrants viennent en Europe et ne savent pas comment faire après. Si les gens ici savaient comment on est venu, dans quelles conditions, beaucoup seraient révoltés. Ça pourrait faire changer les choses, de l’entendre.
Certains jeunes préfèrent ne pas dire aux parents ce qu’ils ont vécu, mais ils peuvent parler aux gens de l’extérieur. Ils peuvent faire comprendre beaucoup de choses, sur les jeunes et aussi sur les migrants qui viennent en Europe.
JG : Une personne que tu admires, que tu écoutes, qui est un exemple pour toi ?
M : Ma mère. [Grand sourire] Pourquoi ? Je ne peux rien dire de plus. Ma mère. C’est tout. C’est grâce à elle que je suis ici. C’est elle. Certaines personnes sont toujours là quand on a besoin d’elles. Audrey aussi.
JG : Y a-t-il un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui te lisent ?
M : La première chose, c’est de rester positif. La deuxième, c’est le respect. Peu importe l’âge. Quand tout le monde se respecte, tout va déjà beaucoup mieux.
Il y avait un jeune dans notre équipe de foot dont tout le monde se plaignait, mais il s’en foutait, il continuait. Un jour, j’ai fait une passe et il a dit “C’est con de jouer là-bas, dans cette direction”. Je lui ai dit “Je ne sais pas si tu parles comme ça à d’autres, mais avec moi c’est la dernière fois”. J’ai appelé le coach et on a parlé ensemble. Je lui ai dit “Je n’ai pas de problème avec toi, je te respecte, mais respecte-moi”. Si tu ne dis rien, tu ne donnes pas la possibilité à l’autre d’arrêter. Personne ne lui a jamais dit d’arrêter. Il faut dire les choses pour que les choses changent, dans le respect et en restant positif.
Quand on arrive ici, notre vie n’est plus la même que chez nous. Il faut qu’on puisse apprendre le français avec les Belges, pas juste entre nous, pour pouvoir progresser. Il ne faut pas nous diviser, il faut qu’on puisse se rencontrer. Je l’ai vu sur le terrain de foot. Quand je suis venu m’entraîner, personne ne m’a montré que j’étais noir, ou autre, ils m’aimaient tous. J’ai appris avec les autres joueurs, le respect entre nous, envers le coach. Le respect au travail aussi. Et puis si tu as une idée, tu la proposes. [Il rit] C’est comme si ma mère était en train de me parler, là.
RENCONTRE AVEC AUDREY, MARYSE ET MAROUSSIA DE LA MAISON BABEL
JG : Quel a été le constat de départ, la raison d’être de Maison Babel ?
MB : Les personnes à l’origine du projet avaient un grand intérêt pour la question et/ou une expérience de terrain ou de vécu en tant que MENA. Le constat de départ était le même : l’accueil des MENA s’arrête à 18 ans, ils perdent leur tuteur, ils sortent de l’accueil Fedasil, toutes les aides tombent en même temps, il n’y a plus de logement avec un projet pédagogique, les écoles ne sont plus obligées de les accueillir… rien n’est prévu pour assurer la transition, alors que c’est un âge charnière où ils sont en pleine construction. Notre projet répond à deux demandes : celle du logement, pour faciliter leur accompagnement vers l’autonomie, et celle d’une permanence sociale qui s’adresse aussi à ceux qui ont déjà quitté leur structure d’accueil, mais qui rencontrent encore des difficultés (accès au logement, accompagnement médico-psycho-social, soutien scolaire, recherche de stage et de travail…).
JG : Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ? Comment les surmonter ?
MB : Le projet a pu débuter grâce au soutien du CPAS de Forest qui a mis un premier logement à disposition. A l’époque, toute l’équipe était encore bénévole. Aujourd’hui, les emplois restent précaires. C’est que le projet ne rentre pas dans les clous ; le droit à l’accueil et les politiques de jeunesse basculent à l’âge de 18 ans, la transition n’est pensée ni pour l’un ni pour l’autre. Pour certains projets à venir, ça peut faire sens de les adapter pour accéder à un agrément. Pour les projets existants, la nécessité sur le terrain est trop importante pour en changer l’essence juste pour répondre à certains critères administratifs. La question de l’autonomisation, qui suit la phase d’accueil, devrait être gérée elle aussi au niveau fédéral. Et puis il y a la question de l’accès au logement qui se pose partout. En attendant un changement au niveau politique, nous investissons dans le travail de réseau, pour partager bonnes pratiques et difficultés et pour aider les jeunes à construire leur propre réseau, autour de leurs besoins.
JG : En quoi votre travail a-t-il changé votre regard sur ce que c’est que “être jeune”, “devenir adulte”, en Belgique, aujourd’hui ?
MB : À leur âge, nous n’avions pas autant de responsabilités ni de choix à faire. Les jeunes se retrouvent face à des questions comme : doivent-ils investir dans leur propre projet d’avenir ici, ou aider leur famille restée au pays, payer les dettes ? On se rend compte de la manière dont nous avons été socialisés, dont nous avons appris les codes, depuis notre plus jeune âge, en famille, à l’école… En même temps, malgré leur isolement, leur manque de repères, ils nous apprennent tellement, sur le monde, sur d’autres réalités, sur leurs vécus. On parle souvent de vulnérabilité, mais ils ont une grande force aussi qui nous renvoie à nous-mêmes. Leur regard sur ce qu’on fait nous aide à questionner nos projets, c’est un vrai échange. Ils s’entraident aussi, des anciens reviennent traduire pour les plus jeunes. Il y a quelque chose d’important qui se passe dans cet échange, dans ce partage. Nous, on a moins senti ce passage à la majorité, on a juste fêté nos 18 ans.
[1] Mombi a souhaité signer par son prénom.
[2] Centre d’éducation et de formation en alternance