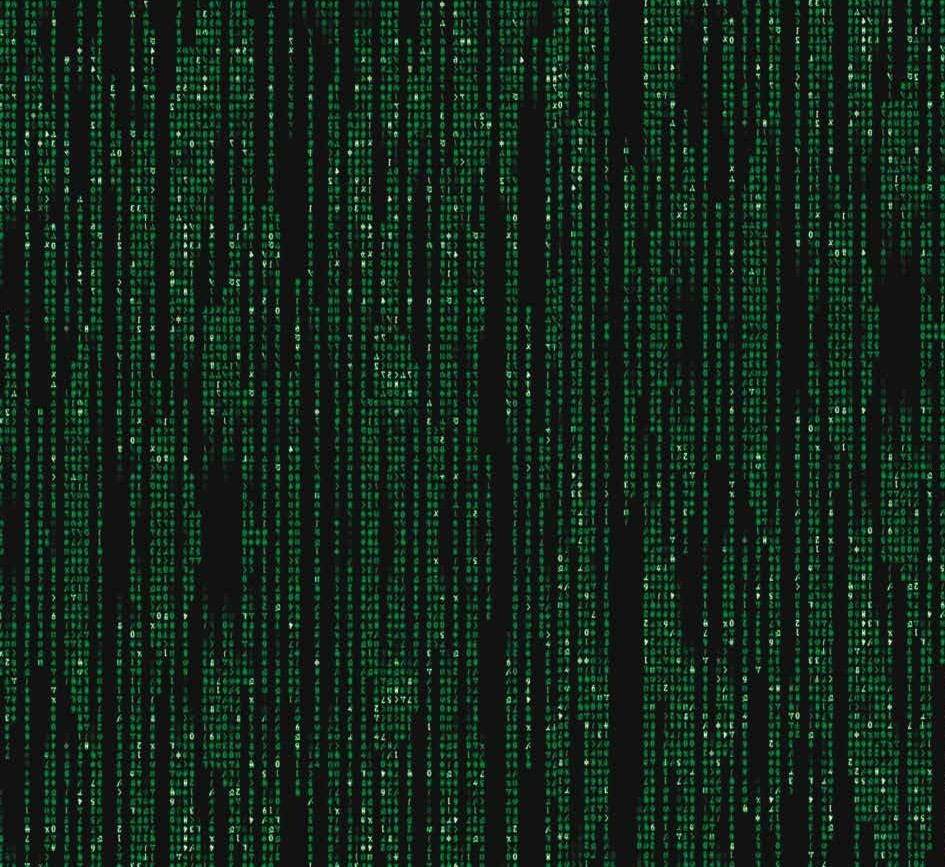Les expériences de pensées ont toujours fait partie de la méthode philosophique libre-exaministe. Depuis le début des années 2000, en parallèle du développement des sciences sociales expérimentales, des philosophes se sont intéressés à cette approche afin de tester certaines hypothèses (épistémiques) sur nos modes de connaissance de l’univers moral, particulièrement les hypothèses émotivistes, héritées des penseurs des Lumières écossaises, comme David Hume et Adam Smith et de leurs épigones contemporains.[1]
Cette analyse propose de s’intéresser particulièrement au “dumbfounding”, traduit en français par “éthique de la stupéfaction”, c’est-à-dire à ces expériences de pensée mettant en scène des tabous générant de fortes émotions soutenant des attitudes et des jugements moraux bien appuyés, pour lesquels les agents sont souvent incapables de fournir une explication rationnelle. Sans vouloir nécessairement défendre une thèse émotiviste, cette analyse propose au lectorat de faire ses propres expériences de pensée et de questionner son propre rapport aux tabous et à la moralité.
L’intérêt de parler du dumbfouding tient en ce que l’administration du droit dans nos sociétés libérales s’appuie largement sur le principe (de John Stuart Mill) dit du “(no) harm principle”, mais rien dans le droit ne questionne les zones grises résultant de la surenchère (libérale) autour de l’autonomie, comme le mal que l’on peut s’infliger à soi-même.
La question est de savoir si, en tant que dépositaires des droits humains qui sont les nôtres, nous ne sommes pas responsables vis-à-vis d’une conception de la dignité humaine qui dépasse les individus, laquelle prescrirait ainsi, pour des raisons morales valables, certains interdits.
En elle-même, la stupéfaction se situe dans l’interstice entre les normes sociales et morales, ce que Machiavel appelait les mœurs, et le droit tel qu’il est pratiqué et administré dans une société donnée, dans notre cas, une société dite libérale. Un exemple classique consiste à demander à des sujets s’ils approuvent la pratique consistant à nettoyer les toilettes avec le drapeau national américain… on ne fait de mal à personne, MAIS… La stupéfaction intervient dans cet espace de non-dit, elle fait en quelque sorte partie intégrante du phénomène même de l’existence et de la reproduction des tabous dans les sociétés humaines.
S’il est hasardeux d’essayer de déterminer si, en tant que dépositaires de la dignité du statut d’humain et des droits et libertés politiques qui en sont les corollaires, nous n’avons pas certains devoirs, nous pouvons tout de même nous questionner sur la notion de sujet et sur le fait de savoir si le droit permet, ou non, d’abdiquer notre dignité humaine. Sans prétendre apporter une réponse, la question se pose : y aurait-il un décalage entre nos lois (libérales) et nos réactions viscérales (notre “gut feeling”) à propos de la moralité et de la dignité humaine ? Aborder la question des tabous permet peut-être de nous aider à faire la part des choses et à progresser dans la recherche d’une réponse à cette question.
LE “DUMBFOUNDING”
Les expériences de pensée de type “dumbfounding” démontrent ce que Durkheim disait dans Définition du crime et fonction du châtiment (1893) : “[…] nous ne réprouvons pas un acte parce qu’il est criminel, mais il est criminel parce que nous le réprouvons”.[2]
Celles-ci trouvent aujourd’hui écho dans la thèse de “l’intuitivisme social”, développée par le psychologue américain Jonathan Haidt.[3] Suivant ce raisonnement, bien souvent, les justifications que nous donnons aux tabous et aux interdits, incluant dans l’administration du droit, sont des raisonnements ad hoc et nos attitudes et jugements moraux d’approbation ou de désapprobation sont d’abord une affaire de réactions viscérales.
Rien ne vaut un exemple. Puisque ce numéro ne cherche pas à se défiler devant les tabous liés à la sexualité – mais aussi liés à la drogue, lesquels nous abordons plus loin – débutons par l’exemple paradigmatique de l’inceste consentant. Imaginez des faux-jumeaux, garçon-fille, Marc et Julie. Ils ont toujours eu une relation très proche, notamment du fait d’avoir été toujours ainsi représentés dans les discours qui les ont bercés. Et un jour, en tant que jeunes adultes, pour parfaire encore davantage le lien unique qu’ils ont entre eux, ils décident de coucher ensemble. Ils avaient tout prévu en utilisant une méthode de contraception (malgré sa vasectomie, Marc portait également un préservatif) et jurent de n’en parler jamais à personne. Bref, ils prévoient afin qu’il n’y ait pas de conséquences négatives, aucun tort (harm) causé à personne. Puis, ils le font. Tout se passe comme prévu. Aucune conséquence négative. Au contraire, dans l’histoire, leur relation s’est vue bonifiée et ils savent désormais apprécier totalement les personnes qui font l’objet de l’amour de l’autre. Ils conviennent de ne pas le refaire et se trouvent satisfaits de l’expérience.
Difficile de ne pas éprouver une forte réaction viscérale et d’approuver — du moins spontanément — ce genre de comportement. Or, c’est également très difficile de justifier rationnellement notre jugement et par conséquent de le traduire dans le langage du droit. Cela dit, dans plusieurs études, les sujets – même questionnés de manière insistante – maintiennent leur jugement malgré l’incapacité à traduire leur désapprobation dans le langage de la raison pratique (éthique) ou du droit. Certains philosophes, notamment Jesse Prinz, soutiennent que cela démontre que si, de manière générale, lorsque nous n’avons pas de raisons rationnelles valides d’entretenir une croyance, nous devrions l’abandonner, mais que nos attitudes morales ne sont pas soumises à cette obligation pour que nous les conservions.[4]
Autre exemple. Depuis quelques années, vous avez des voisins qui ont un chien. Un soir, vous entendez un crissement de pneus à l’extérieur, vous sortez et vous apercevez la famille qui pleure son chien, happé mortellement par une voiture. Le weekend suivant, vous discutez avec votre voisin comme à l’habitude et il vous raconte que la famille a mangé le cadavre du chien. Ils ont fait un repas pour l’honorer une dernière fois. Ainsi, il vivra en eux pour toujours. Du même souffle, il vous dit que l’idée de l’enterrer bêtement leur est répugnante, digne d’une pratique archaïque et que d’ailleurs, aucun membre de la famille ne souhaite être enterré dans un cercueil à sa mort… “on n’enfouit pas les êtres qu’on aime comme des déchets” poursuit-il, la larme à l’œil. Sous le coup de la stupéfaction, vous restez probablement figé. Mais le dilemme éthique se pose alors à vous : est-ce légal ? Si oui, est-ce moralement pertinent ? Est-ce moral de faire ça ? Comment réagir ? Que faire ?
Bref, ces exemples montrent bien le décalage entre nos réactions viscérales à propos de la moralité, l’administration libérale du droit (no harm principle) et l’idée que nous nous faisons de la dignité humaine, ou pour le dire selon la formule classique, d’une vie qui vaut la peine d’être vécue. La démarche est à faire individuellement…
STUPÉFACTION ET STUPÉFIANTS
Les tabous sur la sexualité ont été grandement documentés et repris par les philosophes moraux, comme nous venons de le voir dans la section précédente. Dans cette section, nous proposons de nous éloigner du traitement académique de la stupéfaction pour explorer de manière plus libre son rapport avec l’autre grand tabou de nos sociétés : les stupéfiants.
L’étymologie du mot stupéfaction vient de “stupeo”, en latin, stupeur, ce qui engourdit, et de “factio”, faire. Stupéfaction veut dire donc “ce qui crée la stupeur, ce qui engourdit”.
De son côté, “stupéfiant” a les mêmes origines étymologiques et se décline en deux versions. La première, le nom commun “stupéfiant” vient de la pharmacologie, pour désigner les médicaments à base d’opiacés, dont l’usage principal est justement d’engourdir le système nerveux, de faire cesser la douleur. La seconde, en tant qu’adjectif, signifie quelque chose ou une situation qui crée la surprise, l’étonnement, qui nous laisse bouche bée.
Pas étonnant donc que l’on soit stupéfait, particulièrement là où, pour la première fois, l’on voit une personne totalement “engourdie”, sous l’effet de la consommation de stupéfiants, ou sous l’effet de l’abus d’alcool.
C’est justement cette stupéfaction ressentie qui rend ces abus si répréhensibles aux yeux de la société. Il semble y avoir à tout le moins un rapprochement à faire avec l’altération de la conscience, la perte d’autonomie, du moins momentanée, et l’administration du droit à l’égard des drogues, lequel est paradoxal dans une société régie par le principe du “no harm” et, qui plus est, néo-libérale, où la glorification du profit rapide et du côté prétendument amoral de l’économie dite de marché sont érigés en système. Énorme paradoxe entre la conception libérale atomisée de l’individu et le fait que la morale soit, du moins en partie, une affaire de sentiments partagés collectivement[5] – le mot sympathie signifie d’ailleurs l’harmonie des “pathos”, qui peut se traduire par l’harmonie des émotions que nous ressentons à la vue (ou à la connaissance) de la souffrance d’autrui ; comme la symphonie est l’harmonie entre les sons. Bref, sans entrer dans un débat méta-éthique, épistémique, ou sémantique qui nous éloignerait trop de notre propos, on voit clairement émerger, à travers la question des tabous pris par l’angle de la stupéfaction, les tensions qui existent entre émotivisme d’un côté et rationalisme de l’autre. Cela a donné naissance à un problème désormais classique en philosophie, le fameux “Das Adam Smith Problem”.[6]
Sur un autre plan, la recherche de vérité qui anime les humains s’accompagne d’une recherche de plénitude, de surpassement de soi, et crée cet espace où l’altération de la conscience que l’on retrouve chez Baudelaire, dans Les Paradis Artificiels, mais qui se garde (pour des raisons morales ?) d’en faire l’éloge. Au contraire, à la fin de la section sur “Le Hachisch”, il cite un “remarquable philosophe peu connu”, Auguste Barbereau : “Je ne comprends pas pourquoi l’homme rationnel et spirituel se sert de moyens artificiels pour arriver à la béatitude poétique, puisque l’enthousiasme et la volonté suffisent pour l’élever à une existence supranaturelle. Les grands poètes, philosophes, les prophètes sont des êtres qui par le pur libre exercice de la volonté parviennent à un état où ils sont à la fois cause et effet, sujet et objet, magnétiseur et somnambule”…puis il termine en ajoutant “Je pense exactement comme lui”. Autrement dit, la stupéfaction que l’on peut rencontrer lorsque l’on altère sa conscience et que l’on a l’impression d’accéder à des états de conscience “supérieurs” est vaine, puisqu’elle est artificielle, superficielle.
Reste à savoir si Baudelaire a dit cela pour se couvrir, justement car c’était d’autant plus tabou à son époque de faire l’apologie du vin et du hachisch…
Le problème de la drogue comme artifice est également observé dans le monde animal : “les animaux rendus hardis parce qu’ils se sont développés dans un monde sensoriel dont les saillances les ont euphorisés aiment le risque de vivre. Mais parfois, en cherchant la nouveauté, ils rencontrent la drogue et, rendus fous de plaisir sous l’effet du leurre chimique, ils délaissent les stimulations physiologiques, devenues banales pour eux”.[7]
La question est de savoir si l’humain sait faire la part des choses entre moraliser son côté animal et tempérer son optimisme envers sa capacité de s’émanciper de sa condition physiologique, hétérogène par définition, pour habiter le monde de l’autonomie pure, notamment en considérant la difficulté d’ancrer celle-ci dans la psychologie des motivations humaines – ce qui est le plus grand problème de la philosophie (éthique) rationaliste de Kant…
En quelques mots, la relation entre stupéfaction et stupéfiants est complexe et l’appréciation de notre condition humaine, incluant notre recherche de connaissance et de vérité, se trouve semée d’embûches, notamment car la stupéfaction s’inscrit dans un interstice de non-dit, d’absence de ressenti et de justifications qui participe de l’existence même et de la reproduction des tabous. Il serait intéressant d’imaginer des expériences de pensée de type “dumbfounding” qui porteraient sur la consommation de stupéfiants, pour interroger notre rapport à l’engourdissement et, surtout, à nos réactions viscérales face au cri silencieux exprimant la souffrance de ceux qui font un usage pathologique des opiacés – qui est un véritable fléau social dans plusieurs régions du monde. C’est à se demander si notre stupéfaction vient du fait que l’on puisse abdiquer notre raison à ce point, ou plutôt du vertige résultant du fait que nous nous sentons impuissants face au cri silencieux que lesdits “usagers” nous adressent.
Ce qui est certain, c’est que notre mouvement laïque continuera de soutenir les initiatives de dépénalisation des drogues, de réductions des risques et, globalement, toutes initiatives visant à respecter l’autonomie des individus et à démoraliser la conception de l’intérêt commun qui sous-tend la criminalisation des drogues.
[1] Voir notamment Jesse Prinz. (2007). The Emotional Construction of Morals. Oxford: Oxford University Press.
[2] http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/definition_du_crime/definition_du_crime.html
[3] Jonathan Haidt. (2001). “The emotional dog and its rational tail”.http://www.fitelson.org/confirmation/reasoning_adler-rips.pdf#page=1036
[4] Jesse Prinz, op. cit., p. 28-32.
[5] “la biologie de l’homme seul est vraiment le produit de l’illusion individualiste du XIXe siècle. On ne peut qu’être- avec, et la souffrance de l’autre nous altère… quand on la perçoit”, Boris Cyrulnik, L’Ensorcellement du Monde, Odile Jacob (Paris), 1997, p. 186.
[6]http://theme.univparis1.fr/M1/hpe/d04.htm#:~:text=Dossier%204%20%3A%20Das%20Adam%20Smith,et%20la%20Richesse%20des%20nations
[7} Boris Cyrulnik, op. cit., p. 187.