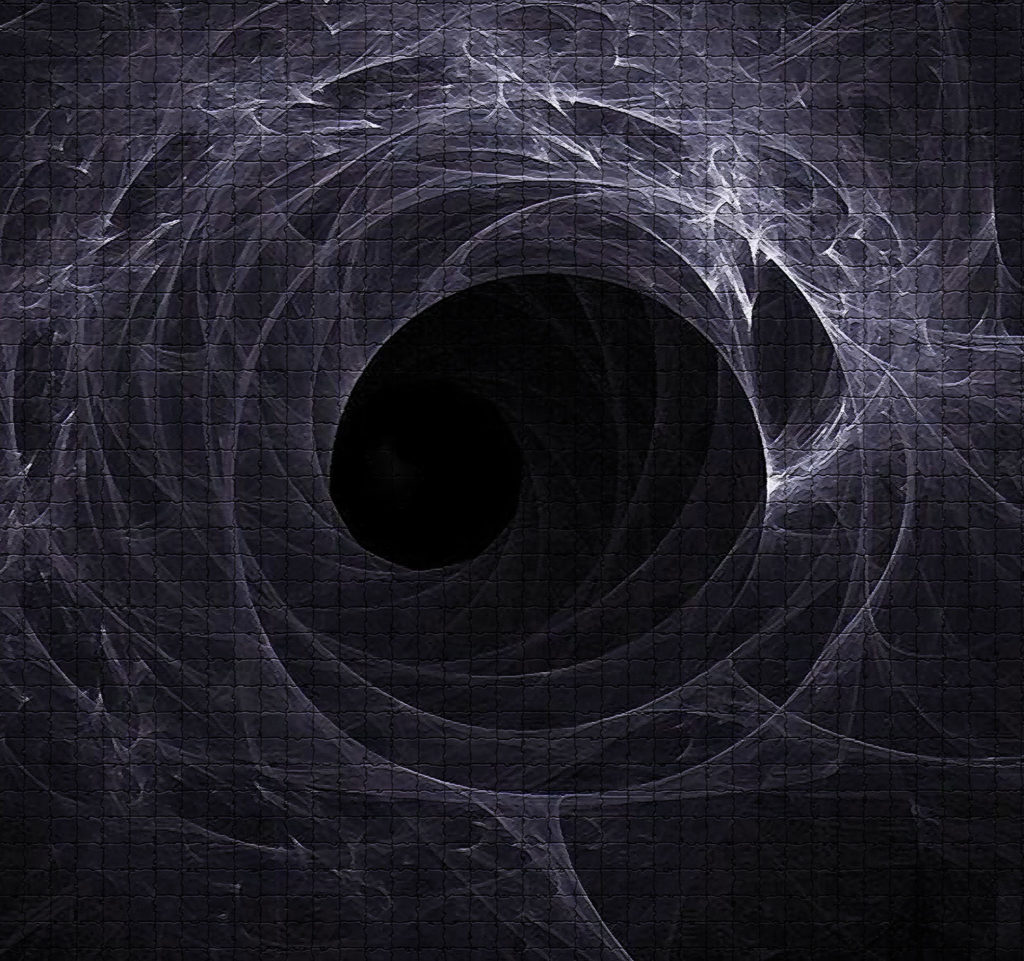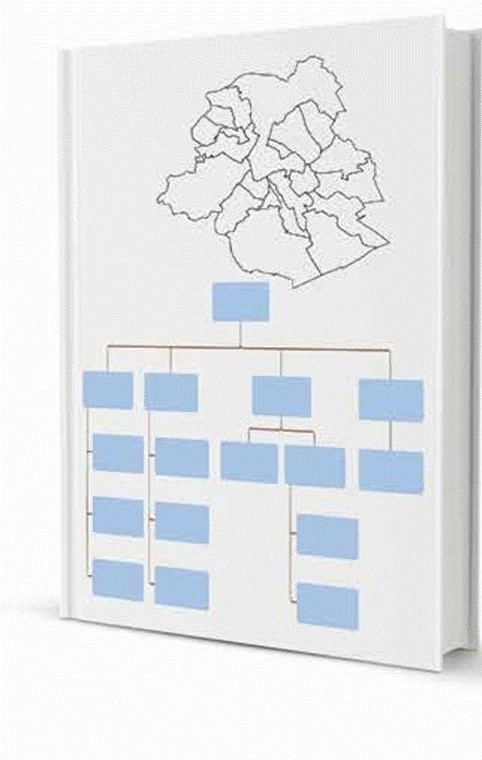C’est lors d’une soirée amicale qui débuta somme toute comme tant d’autres que mon vieux pote Fabien me prit en grippe. “C’est de saison”, me suis-je entendu penser.
Consultant de profession depuis cinq ans, Fabien jouit d’une voiture de société tant chérie qu’Audi l’aurait façonnée en son honneur, se fagote de costumes cintrés qu’il ne tombe jamais tant ils ont le don de réfléchir sa nouvelle condition et se persuade chaque jour d’en savoir encore plus sur le monde qui nous entoure.
Il a fait ses classes à l’ICHEC, rebaptisée il y a peu “Brussels management school”, [1] ça fait plus smart, l’école du parfait manager. Tellement parfait qu’il ne lui a été dispensé aucun cours consacré à la critique du système enseigné ni aux différents contre-courants de pensée actuels. Pour lui, comme pour tant d’autres, le management n’est rien d’autre qu’un moyen pour rendre une société plus efficace dans sa globalité.
Nous remplissions donc nos verres respectifs lorsque, sans crier gare, la bombe fut larguée :
“Tu vois mon gars, le monde, c’est d’investissements et de profits dont il a besoin pour se développer. Et c’est précisément ce qu’on génère chez Deloitte en augmentant la performance des entreprises. Ce sont les grosses boîtes qui dynamisent la croissance et le pouvoir d’achat pour tous. Alors toutes ces grèves…”.
Vous imaginez mon désarroi, sachant que depuis vingt ans, nos retrouvailles trimestrielles se déroulaient tantôt à s’échiner sur de vieux jeux vidéo, tantôt à se rappeler nos anciens déboires affectifs, une bière dans chaque main.
Il est cependant malaisé de ne pas réagir lorsqu’on surprend un ami s’embarquer, tambour battant, dans la morne campagne lancée par les petits hommes gris[2] contre la dignité humaine, la pensée, l’amour du travail intellectuel, l’authenticité, les doutes, la légèreté, la spontanéité.
Pour couper court et gagner du temps, je lui proposai d’en débattre pendant son lunch en one to one, avec son psy d’entreprise,[3] lorsque son conference call sera over.[4] La situation n’était pas désespérée, il avait souri… Mais tenait à ne pas en rester là…
“Tous ceux qui ont un tant soit peu étudié l’économie savent que cela a toujours fonctionné de cette manière, arrête de vouloir toujours tout remettre en question ! On nous apprend des techniques efficaces pour accroître les bénéfices en tenant compte de tous les aspects, y compris humains. Et toute la société en profite, de ces bénéfices”.
Je me trouve, certes, en minorité idéologique, mais vu ce à quoi ressemble le monde du travail, la navigation à contre- courant ne m’émoustille pas outre mesure. Quoi qu’il en soit, j’allais prendre les armes[5] contre Fabien et ses idées qui n’en étaient pas contre cette discipline qui ne vise finalement qu’à l’enrichissement d’un groupe restreint d’individus. Ceux que l’on devrait suivre aveuglément sous prétexte que ces mêmes personnes seraient susceptibles de nous “offrir” un emploi. Et quel emploi…
Tes œillères, cher Fabounet, semblent exceptionnellement efficaces puisqu’elles t’empêchent d’avoir ressenti la souffrance psychique et physique des employés des entreprises dans lesquelles tu consultes tous les jours ou alors aurais-tu simplement été à la bonne école et camouflerais-tu tes doutes par ce sourire et ce voile apparent d’aisance ostentatoire ? Ce sont précisément ces méthodes de gestion, en raffinement constant et aux effets éprouvés – tant en termes de réduction des coûts que d’intensification du travail – que tu es habilité à mettre en place qui en sont la cause.
De plus en plus de travailleurs sont harcelés, déstructurés, broyés au travail par ces méthodes qui, depuis plus de vingt ans, se sont développées et deviennent la norme. Elles entraînent, mois après mois, selon les cas, burn out, tentatives de suicide et maladies professionnelles lorsque le travailleur se tait, avertissements et licenciement lorsqu’il proteste. Elles sont le fruit d’une évolution idéologique structurelle et n’ont rien de simples méthodes isolées lancées à la rescousse d’une petite entreprise en difficulté.
Je décidai d’appuyer mon argumentaire à partir de l’analyse développée par Luc Boltansky et Eve Chiapello dans Le nouvel esprit du capitalisme.[6]
Selon eux, l’accumulation illimitée du capital exige la mobilisation d’un grand nombre de personnes qui ne jouissent plus du résultat de leur travail et n’ont, dès lors, a priori, aucune motivation à participer à cette accumulation : les salariés.
Le capitalisme, complètement détaché de la sphère morale, nécessite, pour prospérer, la mise en œuvre d’une idéologie qui justifierait cet engagement inconsidéré. Pour ce faire, il ira chercher, en dehors de sa propre logique de base, des incitants et des légitimités culturelles pour l’implication de tous les travailleurs dans l’entreprise. C’est le lien qu’avait établi Max Weber entre l’esprit du protestantisme et l’accumulation captaliste.
Vers la fin des années 1960, Il a fallu modifier l’esprit du capitalisme pour répondre à un changement des valeurs dominantes et s’adapter aux deux critiques majeures qui lui étaient alors opposées : d’une part, la critique sociale, soulevée contre l’exploitation, réclamant notamment plus de justice sociale, d’égalité, un meilleur salaire etc. et d’autre part, la critique dite artiste orientée entre autres contre l’aliénation, la standardisation, la production et la consommation de masse, contre l’archaïque autorité patronale paternaliste, et donc animée par un désir de plus de créativité, d’autonomie, de mobilité et de spontanéité.
Les penseurs du néolibéralisme ont pu percevoir, dans la critique artiste, de nouvelles pistes favorisant l’accumulation du capital, tout en réduisant encore les coûts afférents à la production fordiste ou au contrôle hiérarchique des travailleurs. Le nouvel esprit capitaliste ne tarda donc pas à intégrer ces concepts exigés en les vidant de leur sens initial et en leur attribuant un objectif de profit. Ce faisant, à travers le management par projets et réseaux (néo-management) qui signe la fin de l’entreprise fonctionnelle, le capitalisme créa des contradictions de valeurs qui ne tardèrent pas à produire un éclatement du monde du travail et la souffrance d’une grande partie des travailleurs.
Le capitalisme pencha, par exemple, dans le sens d’une libération qui permit une flexibilité, un changement d’activité et de projet ainsi qu’une rupture vis-à-vis des appartenances locales. Mais cette libération s’est faite au détriment de la libération revendiquée par la critique artiste : la délivrance d’un système ou d’une situation d’oppression.
La critique d’inauthenticité était quant à elle orientée contre la production standardisée massive et industrielle qui aboutit à la création d’une masse humaine à la pensée unique. La réponse capitaliste a été la mise en œuvre d’une marchandisation par la diversification à outrance des biens et des produits qui entraîna la marchandisation de domaines qui, jusque là, avaient échappé à la sphère marchande (activités culturelles, loisirs…).[7] Cette marchandisation accrue entraîna de surcroît la prospection et la mise en valeur de gisements d’authenticité, sources inépuisables de profit.
Parallèlement à ce phénomène, la liberté devint la liberté d’acheter, le plus possible et le plus souvent possible. Le travailleur subit une démultiplication de son aliénation par cette incitation à la consommation de masse qui l’enferme en le persuadant que son salaire, même s’il fait vivre les siens, ne suffit plus ; il doit travailler plus dur pour pouvoir se procurer cette superfluité.
Alors que l’autonomie revendiquée visait celle qui s’entend de pair avec l’émancipation de Todorov et la réalisation de soi, l’accroissement d’autonomie s’est construit au détriment de la protection et de la sécurité de l’emploi, ainsi que d’une perte d’emprise du travailleur sur son environnement. On exige à présent de lui, sur ses projets professionnels, une implication personnelle qui empiète sur sa vie privée, ne lui laissant aucun répit. Le néo-management organise un véritable viol de l’intimité et détruit ce mur qui, depuis plus d’un siècle, protégeait de l’entreprise, la vie privée du salarié. Il s’agit pour l’employeur d’asservir également l’esprit des travailleurs, de contrôler à son profit l’ensemble de leur temps et de leur subjectivité (la biopolitique de Foucault caractérise ce contrôle social au niveau de la Cité). On exige des individus la soumission absolue et de tout instant de leur subjectivité imposant à chacun d’être responsable de son “employabilité” dans une flexibilité maximale.
Le travailleur peut aujourd’hui souffrir tant au travail par la mise en place de méthodes de management pathogènes (objectifs inatteignables, cadences insoutenables, perte d’identité…), qu’après le travail (travail à ramener à domicile, disponibilité sur smartphones…) et même de l’absence de travail (synonyme de perte de l’estime de soi et d’exclusion sociale).
Là où la critique artiste exigeait une hiérarchie moins accablante et plus d’autogestion, on assiste à un renforcement de l’auto-contrôle, du contrôle informatique en temps réel, de la surveillance accrue des travailleurs entre eux, tous tenus responsables de la bonne exécution du projet en cours.
Le management par projet fonctionne couramment sur base d’objectifs annuels à atteindre “en toute autonomie”. Lorsque les objectifs d’une année sont réalisés, la hiérarchie considère qu’elle peut élever d’un cran le niveau exigé pour l’année suivante. Chaque année devient de facto plus insurmontable, et ce, jusqu’à ce que le travailleur renonce, au nom de ces objectifs, à des parts de plus en plus importantes de sa vie privée. Tant le besoin de reconnaissance de ses pairs que la crainte du licenciement et les pressions insurmontables le précipitent dans le mal-être, la dépression, voire la tentative de suicide.[8]
Le salarié a l’obligation d’être flexible, de pouvoir se couler dans tous les moules, mais doit conjointement développer sa spécificité propre et la mettre en avant afin d’intéresser les autres, rite indispensable pour pouvoir passer de projets en projets et devenir “quelqu’un” dans le monde de l’entreprise. Une autre contradiction déstructurante du néo-management réside dans le fait, comme on l’a dit, qu’il faut être soi-même, être libre, pour conquérir d’autres projets dans ce réseau interconnecté alors que l’homme n’est pas dupe et vit avec le ressenti permanent et justifié d’être manipulé, exploité ou récupéré.
L’économiste Frédéric Lordon[9] a mis en exergue une des caractéristiques du capitalisme actuel, à savoir, la forme de “domination symbolique” (Bourdieu) exercée en vue d’enrôler les individus dans son projet. Le néolibéralisme tente de convaincre les individus que le travail est le lieu de la réalisation de soi, en l’associant intrinsèquement à des “affects joyeux”, plutôt qu’extrinsèquement, c’est-à-dire lorsque le travailleur perçoit son salaire. On va manipuler ce qui est de l’ordre des désirs en requérant du salarié, non seulement qu’il fasse ce qu’il faut faire, mais qu’en plus, il trouve cela agréable. Alors, on va organiser de grandes soirées arrosées de mousseux aux étiquettes dorées, organiser des team-buildings au Club Med et autres grandes messes en tous genres.
Pour Paul Ariès,[10] le concept d’autonomie est tellement falsifié qu’il est réduit à néant. Le recrutement sert à déceler les candidats les plus aptes à la soumission, ceux qui semblent prêts à vivre pour leur entreprise et à accepter cette mère assouvissant leurs besoins primaires au prix de la privation de leur autonomie et de leur dignité.
Le néo-management conteste de plus en plus aux salariés le droit à la jouissance de leur identité propre dans le cadre de l’entreprise, en visant systématiquement à imposer aux travailleurs une identité nouvelle, qui n’est même plus celle des métiers, qui est celle de l’entreprise elle-même. Les procédés mis en place pour y arriver ne manquent pas : nouveaux modes d’organisation du travail qui brisent les cultures de métier, instauration de règles de travail identiques et standardisées, code vestimentaire, tutoiement, expressions de langage imposé pour les commerciaux, etc.[11] Et il s’agit moins d’être plus efficace que de déshumaniser, de désubjectiviser ce qui se passe dans l’entreprise.
L’entreprise moderne rompt ainsi avec le paternalisme d’antan et développe aujourd’hui un maternalisme encore plus pervers, car fondé sur une logique de dévoration de son personnel. Oscillant de la Clémentine de Vian à la Folcoche de Bazin, d’une mère étouffante, castratrice, refusant à ses enfants leur indépendance et leur autonomie à celle qui les exclut et les rejette. Le lien à l’entreprise devient fondamental alors qu’il est de plus en plus éphémère.
“Bon allez, prend ta manette, on se fait une petite partie et oublions tout ça, t’es lourd…”
N’en espérant pas moins, je voulais tout de même conclure mon propos sur une autre note que celle du dépit, car si ce nouveau capitalisme semble triompher, une idéologie qui s’appuie sur le paraître et la manipulation des valeurs dans un but d’exploitation d’une majorité de personnes ne pourrait être viable à long terme. Un jour, les collectivités se reformeront et seront suffisamment fortes pour lutter à nouveau pour le changement. En attendant, transmettre l’information, discuter, partager entre travailleurs, recréer des identités propres et briser l’isolement semblent les meilleures dispositions à prendre pour faire comprendre à tous que les incitants proposés par ce nouveau management ne conviennent plus, n’ont jamais convenu. Une adaptation – ou pourquoi pas une réelle réforme – doit s’opérer au plus vite. Le néo-management a déjà contaminé le monde des entreprises et poursuit inlassablement sa chevauchée à l’assaut des services publics, des associations, des écoles…
[1] Tout comme Solvay qui s’accoutre dorénavant d’un irritable “Business School”.
[2] A la Simenon, ces petits hommes gris représentent la matérialisation finale du cauchemar imaginé par Robert Musil dans L’Homme sans qualités (Seuil, 1979). Dixit Benasayag.
[3] La mise à disposition de psychologues d’entreprise est une technique utilisée dans un grand nombre de sociétés. Si l’employé n’est pas satisfait, que les conditions de travail ne lui conviennent pas, ce n’est pas de la faute de l’organisation du travail, c’est lui qui a un problème personnel et l’entreprise, protectrice, va l’aider à le résoudre. C’est surtout une bonne manière de lui renvoyer ses difficultés à la figure en se tour- nant vers une pathologisation du social destinée à court-circuiter toute action collective.
[4] L’anglais, pour désigner certains concepts (le wording), est très usité en management. Il servirait à fonder une communication rapide et internationale. Il sert plutôt à masquer le vide des concepts, de la pensée et à enrober d’un voile pseudo branché des formules puériles, infantilisantes. Même le burn-out ils vous l’imposent en anglais…
[5] Des armes de Ferré, celles “au secret des jours; Sous l’herbe, dans le ciel et puis dans l’écriture; Des qui vous font rêver très tard dans les lectures; Et qui mettent la poésie dans les dis- cours”.
[6] Le nouvel esprit du capitalisme, Luc Boltanski et Eve Chiapello, Gallimard (“Nrf essais”), 1999.
[7] En écrivant ce texte, j’enrage précisément sur chaque pub qui entrecoupe ma playlist musicale sur Youtube depuis que le site de partage de vidéos a été racheté par Google.
[8] Comme le souligne Durkheim, le suicide est avant tout un phénomène social et ne saurait se résumé à une folie interne ou héréditaire comme certains chefs d’entreprises tentent souvent de s’en convaincre ou de convaincre le grand public. La même analyse s’applique aux autres symptômes du mal- être au travail.
[9] Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La Fabrique, 2010.
[10] Paul Aries, Harcèlement au travail ou nouveau management, éditions Golias, 2002.
[11] Ce n’est pas sans raison que l’on refuse dorénavant aux ouvriers de décorer leurs ateliers comme cela se faisait avant, avec des posters parfois de mauvais goût, ou si on ne peut plus écouter son poste de radio, ou encore que des safety rules de type “obligation de tenir la rampe pour descendre les escaliers sous peine d’avertissement” (règlement de travail Exxon Mobile) sont imposés, qu’une charte informatique vient déterminer ce que l’entreprise considère être une navigation correcte ou “morale” sur Internet, la généralisation de pratiques comme l’imposition d’un prénom unique pour un même poste ou de contraintes corporelles (maquillage, …).