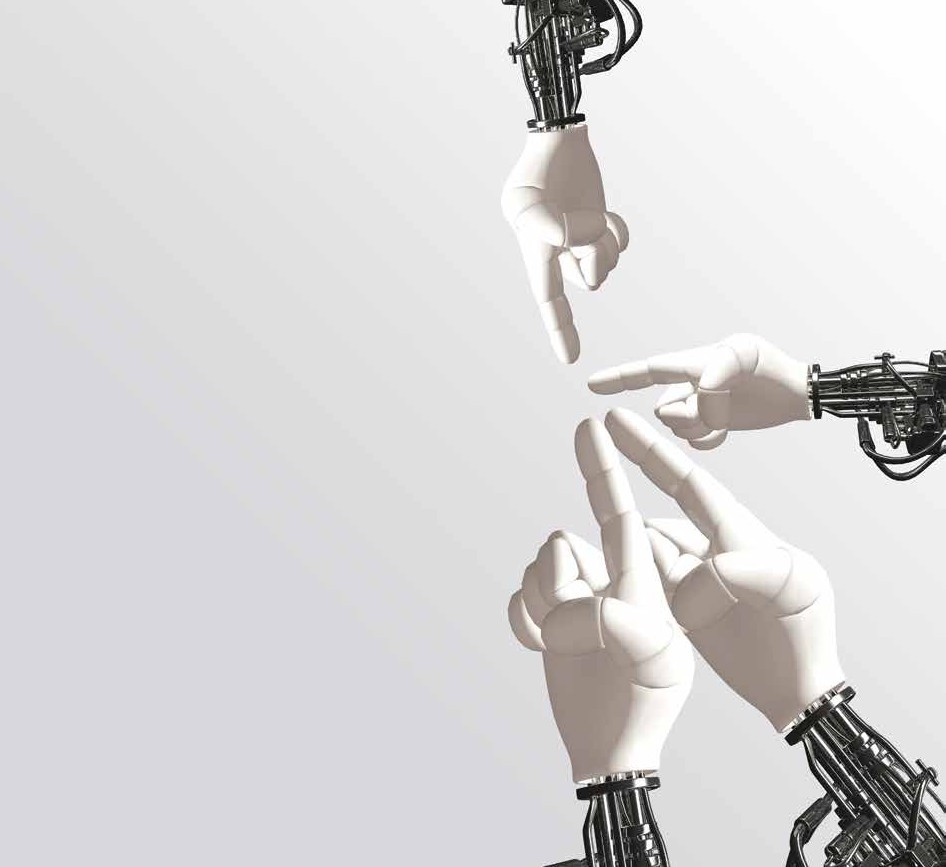Le capitalisme , nous avons l’impression de tous savoir ce que cela veut dire. Pourtant, lorsque l’on se met à creuser la question, il semble insaisissable. Un tour d’horizon pour aider à s’orienter.
LES POLITIQUES DU CAPITAL
Afin de nous aiguiller dans un labyrinthe d’auteurs et de définitions, faisons le temps de cet article cette hypothèse : « le capitalisme », ce sont « des politiques du capital ». C’est-à-dire des dispositifs institutionnels, bureaucratiques et juridiques, étatiques ou non, qui reproduisent ou mettent en œuvre les conditions et structures sociales favorables à la reproduction du capital. L’enjeu est le suivant : penser la dynamique du capital dans des termes politiques et pas seulement sociaux. Par exemple, les « politiques du capital » se construisent avec et contre l’État. Avec, car sa puissance lui est nécessaire. Et contre, car la régulation de l’Etat lui est parfois défavorable. Ces politiques sont donc des efforts réalisés par les capitalistes pour maintenir en place un mode économique incapable d’exister par lui-même. En effet, comme le théorisait Rosa Luxemburg (1913), le capital n’a pu se constituer qu’avec l’aide de rapports non-capitalistes. Elle expliqua que les crises liées à l’accumulation de capital ont engendré une intensification des logiques impériales. Aujourd’hui, une fois la conquête à l’échelle mondiale quasiment réalisée, c’est à la suite des crises et des innovations que le capital se renouvelle. La recherche de nouveaux marchés est toujours brutale, mais les capitalistes actuels possèdent, entre autres, l’arme de la consommation de masse pour tempérer les conflits tant que les inégalités ne se creusent pas trop. Une politique qui semble avoir fait son temps.
Mais qu’est-ce qu’un capital ? Il faut être précis et un peu technique. C’est une somme de valeurs avancées en vue de financer une activité économique, changeant de forme en fonction de son accroissement. On dit que le capital « transite ». Argent transformé en marchandise, puis à nouveau transformé en argent, etc. La valeur change de forme, s’accroit afin de créer un profit, mais ne se perd pas. Le capitalisme, malgré le flou que cette expression recouvre, c’est le rapport social qui découle de cette activité. Et il est loin d’être neutre : le rapport social capitaliste est un rapport de « réification ». Cela signifie que tout est une marchandise potentielle, y compris nous-même, nos liens sociaux, etc.
S’appuyant sur la séparation des producteurs d’avec les moyens de production opérée par le rapport social capitaliste, les politiques du capital travaillent à transformer la société et les rapports sociaux en rapports marchandisés et en concurrence, produisant des individus s’envisageant comme des « entrepreneurs de soi » qui ont à faire croître le capital qu’ils sont eux-mêmes. C’est bien sûr une évolution largement invisible pour la population. Cela a notamment été installé réforme après réforme du « marché du travail ». Il ne fait plus de doute qu’il existe une proximité désormais intime entre les logiques du capital (exploitation, marchandisation, rentabilité et innovation) et la constitution de subjectivations individuelles et collectives. Cela signifie, comme l’écrivait l’économiste Karl Polanyi en 1944, que la circulation du capital se réalise dans la toile de la vie sociale et écologique. Le résultat, disait-il également, pouvait avoir des conséquences destructrices pour l’environnement et le travail.
LE MANAGEMENT: LE CAPITALISME AU PLUS PRÈS DES CORPS
Arrêtons-nous sur un exemple collectif de « réification » : la souffrance au travail et les conditions mortifères qui y mènent. Fréquemment « invisibilisée », elle ne fait la Une qu’en de rares et spectaculaires occasions. Le cas de France Télécom est un exemple révélateur : entre les années 2007 et 2009, cette entreprise eut l’objectif de provoquer 22 000 départs – sans licenciements ! – sur 120 000 employés. Des managers furent chargés d’organiser la désorganisation, mobilisés par des objectifs liés à la concurrence. Le scandale finit par sortir, et leurs dirigeants mis en procès. Des démissions forcées arrachées au prix de 19 suicides, 12 tentatives, et d’un « management par la terreur » pour tout le monde. Dépossédés du sens de leur travail, obligés de se soumettre à la « sociopathie managériale »[1], qui passait notamment par la dégradation volontaire des conditions de travail des employés, ces derniers finirent désœuvrés et pour certains pétèrent un plomb. Une salariée s’est ainsi jetée par la fenêtre devant ses collègues. Scène d’autant plus morbide que les dirigeants prévoyaient de faire partir les employés « d’une façon ou d’une autre, par la fenêtre ou par la porte ». Les exemples sont nombreux, parfois moins dramatiques sur les plans de vies humaines, au sens biologique. Mais les décompensations psychologiques peuvent être source d’une très grande souffrance, menant à des troubles du sommeil, addictions, divorces, AVC, etc.[2]
Il faut résister au réflexe du « ce n’est pas comme ça partout » ou « c’est un cas extrême » pour en tirer des leçons. En prenant un peu de hauteur, on s’aperçoit que les professions actuellement touchées par les « réformes » apparaissent parfois comme privilégiées. Pensons aux profs, médecins, infirmiers, postiers, etc. En tout cas, loin d’être les plus précarisés de la société, comme le sont les SDF ou les migrants. Mais ces « privilégiés » sont en réalité les témoins, en premières lignes, d’une dégradation spectaculaire des conditions de travail. Donc une dégradation sociétale : concernant tous les salariés, chômeurs, retraités,etc.
LE SALARIAT: LA VIE DANS LE CAPITALISME
Nous pourrions être accusés de biais catastrophiste. Disons simplement que pour la majorité de la population mondiale la reproduction matérielle passe par l’argent. Celle-ci est soumise aux impératifs des politiques du capital, à la violence de la reproduction sociale (inégalités scolaires et familiales par exemple) et aux rapports hiérarchiques. Bien sûr, il arrive qu’un travail soit réalisé par les travailleurs de telle sorte qu’il leur permet de vivre de façon non aliénée. Car plus que le salaire, qui sert à rester dans l’emploi, il faut provoquer l’implication. C’est tout à l’avantage du capital, car des travailleurs non aliénés travaillent souvent de manière plus efficace.[3]C’est toute l’ambivalence du management que de jouer avec le bâton et la carotte. Mais à la fin des fins, il ne reste que le bâton, même chez Google, même lorsqu’il existe un « Chief Happiness Officer ».
Le « bâton », ce sont des forces structurelles : chantage au chômage, affaiblissement des défenses du monde du travail, éclatement de la classe ouvrière, l’humain comme ressource. Au niveau des employés, cela mène à la lutte des places plutôt que la lutte des classes. Chez les cadres, le harcèlement moral qui devient une morale du harcèlement.[4] Mais ce n’est pas tout. Les agents ne flottent pas dans l’éther. Si ces mesures sont prises afin de « dégraisser » une entreprise, c’est pour qu’elle rentre dans les normes internationales du capitalisme : satisfaire à une obsession de la rentabilité financière, devenue idéologique. Plus pervers encore : quelques fois l’argument financier n’est là que pour cacher la volonté d’une entreprise de « bien se faire voir » du marché et faire peur à la concurrence. Car oui, dans ce monde-là, virer des gens peut-être bien vu. Et pour cela, il faut des hommes conditionnés à la rationalité économique la plus obtuse. Nous y sommes : plus qu’une problématique individuelle, isolée, c’est bien à la production d’une subjectivité particulière que nous assistons. C’est pour cela que Luc Boltanski et Eve Chiapello parlent d’« esprit du capitalisme », cet « ensemble de croyances associées à l’ordre capitaliste qui contribuent à justifier l’ordre et à soutenir, en les légitimant, les modes d’action et les dispositions qui sont cohérents avec lui ».[5] Une dévotion qui n’est pas sans conséquences écologiques et sociales et qui a des racines dans l’organisation capitaliste de nos sociétés.
Lectrice attentive de Rosa Luxemburg[6], Hannah Arendt la synthétise également sous le terme d’impérialisme. C’est l’esprit du capitalisme de la classe dirigeante. Historiquement, les démocraties capitalistes ont construit un état de droit et exporté la terreur sur les territoires étrangers : « L’impérialisme naquit lorsque la classe dirigeante détentrice des instruments de production capitaliste s’insurgea contre les limitations nationalistes imposée à son expansion économique. C’est par nécessité économique que la bourgeoisie s’est tournée vers la politique […], il lui fallait imposer la loi de la croissance économique constante à ses gouvernements locaux et faire reconnaitre l’expansion comme but final de la politique étrangère ».[7]
L’ÉTAT-NATION, UN REFUGE?
Dans ce cadre, une petite musique se fait entendre : nous pourrions maitriser notre destin économique dans le cadre de l’Etat-Nation et se protéger des destructions du capital. Selon la juriste Monique Chemillier-Gendreau, il ne faut en réalité plus penser dans les termes de la souveraineté si celle-ci est définie comme un pouvoir au-dessus duquel il n’y a rien. Et si elle est la figure unifiée de l’Etat, elle est une chimère malsaine incompatible avec la démocratie. Plus exactement, la souveraineté ne permet pas de représenter la pluralité, mais est une radicalisation de la décision majoritaire. Il faut travailler à concevoir « des communautés politiques dans lesquelles vous avez des institutions qui ont des compétences. Une communauté politique c’est justement un groupe de gens, qui, parce qu’ils sont ici, ensemble, sur ce territoire, ont à gérer leur vie. La commune, la région, l’État, le Continent, et l’Humanité doivent être pensés et compris comme des communautés politiques avec ce lien de fraternité entre les membres et des compétences qui sont adaptées à l’échelle. Les Etats-Nations ne sont pas le bon échelon pour régler un certain nombre de problèmes majeurs qui menacent l’humanité ».[8] L’écologie en est une, quid des politiques du capital ? La souveraineté entendue ici fait plus que s’en accommoder. Plus le champ économique s’autonomise, prend ses distances avec le tout de la société, plus des fractions importantes de cette dernière affirment en réaction une pensée de l’antériorité de la nation. Et une économie exclusivement pensée comme internationalisée et « parasitaire » mène à sanctuariser les frontières (toujours à l’encontre des plus faibles). Pour paraphraser Lafontaine : selon que vous serez puissant ou misérable, les frontières vous seront ouvertes ou fermées.
« LE CAPITALISME PARASITAIRE », UNE ERREUR D’ANALYSE
L’erreur serait de croire qu’en ciblant aveuglément l’un ou l’autre « coupable » (le FMI, l’OMC, etc.), sorte de clé de voûte, le tout s’effondrerait à l’avantage des peuples. Penser le mode de fonctionnement de l’économie capitaliste, dans son mode ordinaire, c’est autant penser les structures complexes que des subjectivations, des manières d’être et de faire. Chercher la cause des causes, cela pousse à tenter d’identifier un rouage externe, un dénominateur commun – même large, tel que « le Système ». L’attaque contre le 1 % les plus riche, par exemple, qui a émergé à la suite d’Occupy Wall Street et qui se retrouve dans le programme d’un candidat comme Bernie Sanders ne peut se justifier que si c’est c’est un slogan qui s’accompagne d’un ambitieux programme social inclusif. Sans cela, cette lecture purement anti-oligarchique, qui pour certains fait office d’analyse, manque, voire dénie, les luttes internes aux 99 % restant. Cette focalisation sur une tête d’épingle peut mener dans le pire des cas jusqu’aux éructations complotistes et antisémites plus ou moins policées. Le symbole d’un pouvoir des juifs, sorte de domination universelle immensément puissante, abstraite et insaisissable sur le monde nait de cette mauvaise conception du capital.[9] Cela participe d’une conception « parasitaire » du capitalisme et renforce les logiques identitaires venant de l’extrême droite. Elle consolide également les politiques du capital dans l’espace national… mais aussi international ! Il faut comprendre que le capital prospère dans un monde dérégulé, en mettant en concurrence des Etats-Nations. Un émiettement des Etats, plutôt que leur fédération régulant les échanges, provoque une émulation du capitalisme. Plus précisément, l’accumulation du capital requiert des États forts sur lesquels les capitalistes « du centre » puissent compter, ainsi que des États faibles ou défaillants, dits « en périphérie », qui ne puissent s’opposer à l’exploitation de leur force de travail.
Cette critique du caractère parasitaire du capitalisme ne doit pas masquer la prédation qu’opère la finance sur le tissu économique industriel. Pour autant, celle-ci s’inscrit dans le même mouvement que le renforcement du management, sans s’y confondre. Abattez la finance, vous aurez toujours le management, qui ira se greffer sur un autre « esprit » que celui du capital.
UNE VIE EN DEHORS DES RAPPORTS CAPITALISTES
Une des choses les plus frappantes, lorsque l’on traite ces questions, est la très grande plasticité, flexibilité et adaptabilité du capital à ses différents environnements. C’est ce qui oblige à reconnaître la difficulté à définir une bonne fois pour toutes les institutions les plus propices à son développement, et en même temps à acter sa pérennité. Le panorama décrit rapidement ici ne laisse que peu de place pour les espaces protégés, les hétérotopies. Par contre, nos luttes collectives ne sont jamais vaines, à quelque échelle que ce soit, pour protéger la biosphère ou combattre les dérives managériales. Quand bien même nous serions pris dans le processus de production-consommation capitaliste, la pluralité des actions visant à élargir le domaine de la gratuité, pour l’auto-organisation démocratique de la communauté politique dans une perspective écologique, la lutte contre la domination inscrite dans la proposition de l’égalité des libertés, la promotion des communs, tout cela ouvre des brèches. Il faudra néanmoins plus qu’une éthique de vie pour transformer nos rapports sociaux. Contre les politiques du capital, ces questions s’articulent afin de préserver une « toile de la vie sociale et écologique » viable.
[1] LORDON Frédéric, Les sociopathes (De France Télécom à Macron), La pompe à phynance,https://blog.mondediplo.net/les-sociopathes-de-france-telecom-a-macron
[2] ISRAEL Dan, Quand France Télécom se débarrassait des «fruits trop mûrs ou pourris», Mediapart, https://www.mediapart.fr/journal/france/210519/quand-france-telecom-se-debarrassait-des-fruits-trop-murs-ou-pourris?onglet=full
[3] Voir BURAWOY Michael, Produire le consentement [« Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism », 1979], La Ville Brûle, 2015.
[4] DE GAULEJAC Vincent, La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social. Editions Points, 2009.
[5] BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Tel, Gallimard, 2011, p.45.
[6] MOREAULT Francis, Hannah Arendt, lectrice de Rosa Luxemburg, Revue canadienne de science politique, Vol. 34, No. 2 (Jun., 2001), pp. 227-247.
[7] ARENDT Hanna, Les origines du totalitarisme II. L’impérialisme, Fayard, « Points/Politiques », p.16.
[8]https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/comment-faire-une-societe-juste-et-bonne-avec-monique-chemillier-gendreau
[9] POSTONE Moshe, Critique du fétiche-capital. Le capitalisme, l’antisémitisme et la gauche, PUF, 2013.