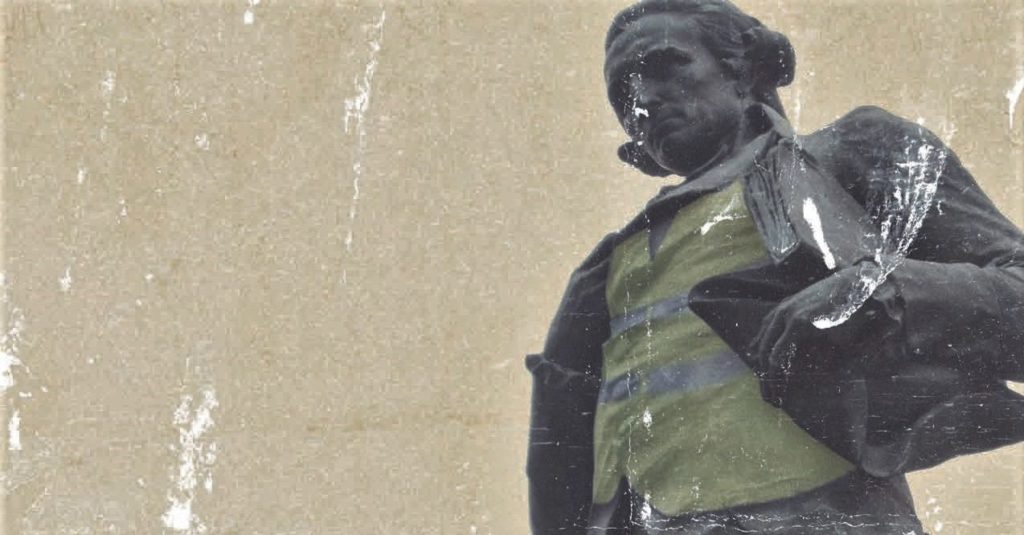Le mot « dialogue » vient du grec (ancien) et signifie le discours qui se diffuse ou qui se rend intelligible « à travers », ce qui implique une altérité, réelle ou imaginée. Les dialogues de Platon en sont un exemple classique. Sans faire l’apologie de ceux-ci, disons simplement que la méthode qui consiste à confronter des idées, à clarifier des formules toutes faites, à s’éloigner des lieux communs pour suivre son propre libre examen, bref à sortir de notre « bulle », nous semble plus que jamais indispensable. Dans un monde polarisé par les réseaux sociaux, les injonctions idéologiques et un climat anxiogène, les occasions de pouvoir participer ou assister à des forums de discussions ouverts ou à des célébrations de la différence se font de plus en plus rares. Pour ce faire, la culture est un moyen extraordinaire de susciter la réflexion, le rire, le mélange des genres, les rencontres de toutes sortes…
Le Festival des Libertés se veut une invitation à sortir de notre zone de confort pour échapper aux algorithmes, pour faire société, pour renouer avec l’énergie des foules, les personnages mis en scène, mais aussi ceux que l’on se crée et les situations insolites qui font la condition humaine… Affranchissons-nous des « murs » des réseaux sociaux pour plutôt franchir ceux des théâtres, abolir ceux que l’on s’impose à soi-même. Osons les rencontres. Osons être à l’écoute, mais aussi prendre la parole. Osons le dialogue.
Dialogues et démocratie
Nous vivons dans des régimes dits démocratiques. Or, ce terme est polysémique, tant chez ses critiques que ses partisans. Qu’est-ce que la démocratie ? Représentative, délibérative, garante des droits humains… Quelles institutions font qu’un régime est « démocratique », à quel degré ? De quelle représentation parle-t-on ? De quelle délibération ? Où sont les instances, les forums, les mécanismes de consultation qui engagent un dialogue citoyen, réellement politique ? Comment conjuguer élections et alternance du pouvoir avec des institutions non partisanes et neutres dans l’administration du droit ? Quelle place pour les contre-pouvoirs ? À qui devraient s’adresser les productions dans le milieu de l’éducation permanente ? Dans quel paysage s’inscrit-on ?
Pour résumer de manière synthétique, nous pourrions dire que la démocratie est un ensemble complexe de dialogues. Cette complexité crée parfois une distance entre les habitants des différents quartiers et territoires, car il est difficile de s’y retrouver… et la lasagne institutionnelle belge n’aide pas !
Faire une synthèse des instances délibératives qui composent la démocratie en Belgique serait à la fois ennuyeux et au-delà de ce qui est possible de faire rigoureusement dans une analyse d’éducation permanente comme celle-ci. Cela dit, il n’est pas inutile de rappeler que les espaces de délibérations, de confrontations des arguments, existent bel et bien en Belgique, ce qui en fait une démocratie. Évidemment, tout n’est pas parfait, loin de là. La réalité est nuancée. Les forums existent, à différents niveaux, avec des degrés et des exigences de formalité et de consultation citoyenne qui varient. Les communes, les entités fédérées, comme la Région Bruxelles-Capitale et le gouvernement fédéral sont organisés autour d’une succession de dialogue, de débats visant à civiliser les conflits et offrir une certaine transparence législative. Qu’il s’agisse des débats électoraux, des débats parlementaires, des commissions, des cours de justice, des forums participatifs au niveau local, les espaces de dialogue sont multiples. Bien que cette complexité puisse être une source de confusion pour certains, elle est souvent présentée comme permettant à chacune et chacun de pouvoir se faire entendre ou s’impliquer, au niveau de son choix. Les institutions européennes constituent également un niveau supplémentaire, présent à Bruxelles, où se trouve le siège de la Commission (pouvoir exécutif).
Socle des démocraties, au cœur même des pratiques qui ont contribué à façonner leurs différentes institutions, le dialogue arrive d’abord comme une méthode libre exaministe, permettant de questionner des idées reçues et des croyances fondées sur des lieux communs. Au sein des institutions démocratiques, le dialogue permet, du moins dans l’intention qui perdure depuis la Grèce antique, de faire vivre le débat rationnel et de l’ouvrir au grand nombre, au demos.
Ainsi présenté, le dialogue semble constituer un idéal. Or, ce serait une erreur de le concevoir ainsi. Les débats démocratiques sont souvent conflictuels, hargneux et les attaques personnelles sont monnaie courante. Ceci n’est pas sans alimenter le cynisme de la population, du demos, où le scepticisme à l’endroit du caractère « représentatif » de la démocratie parlementaire est déjà présent. Le décalage entre les élus, souvent politiciens de carrière, et la population, soumise à concurrence rude sur le « marché du travail » qui mène à une érosion la classe moyenne est de plus en plus prégnant.
Le dialogue prend donc place dans des réalités sociales qui le précèdent et qui influencent les processus délibératifs et décisionnels. Il repose sur des asymétries économiques, culturelles et politiques qui déterminent, voire discriminent, qui a voix au chapitre, qui est entendu et qui est légitimé. Pourtant, c’est précisément en reconnaissant ces déséquilibres que l’on peut œuvrer à les corriger. Des espaces délibératifs conscients de ces enjeux peuvent devenir un puissant outil d’émancipation, d’inclusion, de libertés et d’intelligence collective, à condition d’être capables de réflexivité.
DIALOGUES DE SOURDS
De nombreux obstacles entravent pourtant la réalisation des idéaux et des missions des institutions qui servent à médier les conflits légitimes qui existent au sein d’une matière sociale hétérogène. C’est un des grands défis auxquels nos démocraties font face et auxquels les mouvements politiques attachés à la démocratie peinent à offrir des réponses qui rassemblent. Nos sociétés sont de plus en plus fracturées. En conséquence, les mouvements politiques mutent et évoluent rapidement, mais sans toujours représenter les idéaux progressistes que nombre de citoyens partagent. Les réseaux sociaux contribuent également à polariser les discours politiques, qui sont ensuite repris par les médias traditionnels. Cette dynamique donne l’impression à énormément de personnes d’être prises en otage dans un dialogue de sourds, dont la stérilité n’a d’équivalent que la tristesse de l’absence de perspectives solidaires et joyeuses.
La méfiance, voire la défiance entre groupes sociaux, prend place dans une société inégalitaire et fragmentée. Il est important d’en avoir conscience et d’ajuster les processus de discussion, afin de permettre un arbitrage démocratique juste. C’est précisément ici qu’il faut accepter de nuancer nos lectures idéologiques, parfois réductrices, pour ouvrir un dialogue qui ne soit pas dévoyé par les langages opaques, excluants, et les biais multiples qui existent au sein d’une société libre et ouverte.
Or, ces dévoiements et ces court-circuitages du débat rationnel sont exploités par les réseaux sociaux. En effet, les divergences de valeurs et les particularismes de toutes sortes se transforment parfois de richesses potentielles en des barrières infranchissables. Il serait naïf de ne pas prendre en compte, dans la construction des dialogues, la puissance des algorithmes qui exacerbent les positions les plus antagonistes. Cela n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement de nos sociétés, puisque le débat prend place dans des espaces dont les règles rompent avec celles des institutions démocratiques classiques. Sous une apparence de démocratisation de la parole, est-ce que cela ne ferait pas que reproduire, d’une certaine manière, ou sinon renforcer, les inégalités qui plombent les principes démocratiques ? La monétisation de la portée de diffusion des contenus et les positions politiques des grandes figures derrière ces réseaux sont pour le moins interpellantes… tout comme le développement d’une nouvelle forme de contrôle et de pouvoir qui se profile grâce à elles. Le dialogue ouvert qui nous était promis au départ devient un dialogue qui se présente sous des formes antinomiques, voire toxiques, au débat serein.
On peut également faire l’hypothèse que le manque de mécanismes institutionnels favorisant un dialogue démocratique structuré, ainsi que la crise de confiance envers ceux déjà existants, empêchent les citoyennes et citoyens (avec et sans papiers) de s’entendre et de se faire entendre.
Canaux
Le dialogue, s’il ne se limite pas à une position symbolique et prend en considération les structures dans lequel il prend place, est essentiel à la vie en société. À commencer par le fait que chacune et chacun soit reconnu capable de parole, de rationalité et de subjectivation permanente de sa condition.
Dialoguer, c’est travailler le conflit pour en arbitrer collectivement les résolutions et arbitrages possibles. C’est également une pratique qui doit s’opérer dans un cadre favorable à l’intérêt de toutes et tous, à une émancipation à la fois individuelle et collective. Lorsqu’il est (en)cadré par les valeurs (épistémiques) de la discussion rationnelle, il permet, dans l’idéal, de créer une culture civique commune, ou à tout le moins un langage commun, incarné par le droit, qui demeure un objet de critique et d’évolution perpétuelles.
C’est pourquoi l’échange et la confrontation des idées et des intérêts doivent être continuellement renforcés et élargis à toutes les voix, y compris celles qui sont trop souvent marginalisées. Un dialogue véritablement inclusif ne se contente pas de juxtaposer des opinions : il crée les conditions d’une participation active et équitable. C’est ainsi que l’on peut faire du dialogue non pas un simple concept, mais un moteur vivant du changement démocratique. Comment organiser des institutions à travers lesquelles les paroles, même les plus minoritaires, soient réellement prises en compte dans les différents exercices démocratiques qui influencent les normes qui structurent nos rapports sociaux, nos droits, nos perspectives ?
On le répète à propos de nombreux sujets, mais l’éducation générale et plus particulièrement à la citoyenneté joue un rôle crucial pour favoriser à la fois l’écoute active, la posture du doute, ainsi que la pensée critique et le libre examen. C’est une condition de légitimité et d’effectivité démocratique de la création d’espaces de délibération, tels que des forums, des assemblées citoyennes et des plateformes en ligne, offrant aux citoyens des lieux où ils peuvent échanger librement et de manière constructive. Il ne s’agit pas ici d’être aveugle au fait que les États modernes disposent déjà de lieux privilégiés pour l’exercice démocratique. L’éducation permanente en Belgique en est un exemple paradigmatique. Ces espaces doivent être conçus (et pour cela, faire l’objet d’un effort soutenu) pour être inclusifs et accessibles à toutes et tous, indépendamment de leur statut social ou économique, afin de garantir, ou du moins de tendre vers, une participation équitable. Ce qui pose aussi la question à savoir comment conjuguer particularismes et intérêt général ? Les réponses à apporter à cette question doivent impérativement prendre en compte la crise de confiance que traversent nos institutions démocratiques.
En apprenant à gérer les désaccords de manière pacifique et constructive, les individus et les groupes peuvent transformer les tensions en opportunités de compréhension mutuelle – ne serait-ce que des raisons des leurs désaccords. Cela passe par la promotion de méthodes de résolution de conflits basées sur la communication non violente, la négociation et la médiation. Des approches innovantes, autant dans les institutions juridiques que pour améliorer le caractère représentatif des institutions législatives, pourraient permettre de désamorcer grand nombre de conflits, qui ne cesseront pas d’exister, malgré l’incapacité collective d’y faire face de manière politique.
En intégrant également de nouvelles pratiques dans les institutions éducatives, les lieux de travail et les espaces communautaires, il est possible de créer un environnement où le dialogue devient une norme commune, même en présence de divergences profondes. Or, soyons aussi conscients des limites de cet idéal. Il y aura aussi toujours les libertés civiles, le droit d’utiliser ses droits pour faire des choses qui déplaisent à la majorité, du moins dans une démocratie « libérale ». Bref, il y aura toujours un aspect conflictuel des intérêts et des idéaux dans une matière sociale hétérogène, c’est-à-dire celle admise et produite par une société réellement libre et ouverte. C’est justement pour cette raison que nous avons besoin de leaders politiques capables de nuances, qui ne soient ni fatalistes, ni « laisser-fairistes » (quoi qu’ils se disent « de gauche »), sur les enjeux démocratiques liés au pluralisme. La laïcité, entendue au sens d’un principe politique neutre, demeure d’ailleurs un garde-fou contre les différents extrêmes.
CONCLUSION
Comment dès lors le dialogue, malgré sa complexité et les obstacles structurels qui l’entravent, peut-il rester ou devenir un pilier fondamental de la démocratie ? En reconnaissant les déséquilibres et les barrières qui parasitent la communication, pouvons-nous transformer le dialogue en un outil puissant d’émancipation et de cohésion sociale ? Quels espaces et quels cadres de débats est-il urgent de créer ? C’est sur ces questions que le prochain Festival des Libertés se penchera afin de faire du dialogue non pas un simple idéal, mais une réalité vivante et dynamique, capable de renforcer nos démocraties et de construire un avenir plus juste et plus solidaire.