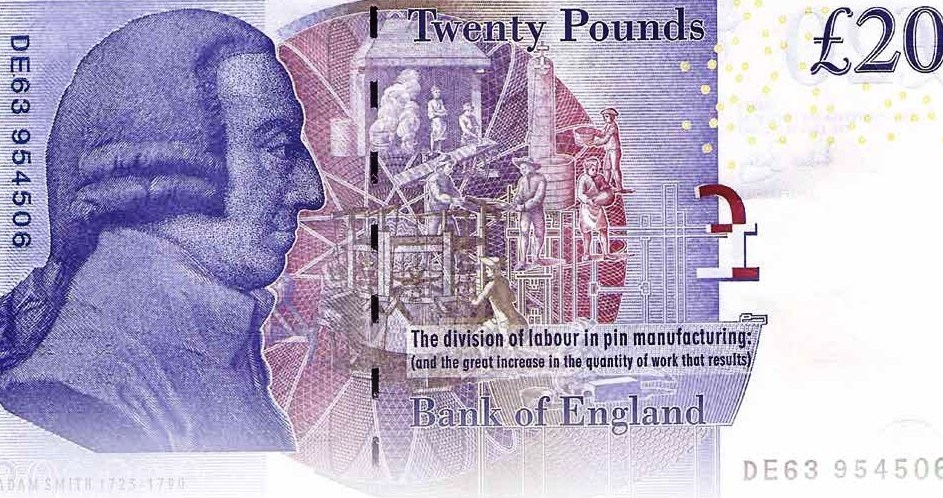La manifestation d’Oxford est gigantesque, bien plus importante que ce qui était prévu, comme bien des manifestations qui exigent le retrait de ces statues. Cela semble laisser perplexes pas mal de commentateurs, même parmi les plus sympathiques, qui ne comprennent décidément pas comment des manifestations contre les violences policières peuvent conduire au déboulonnage de statues. Pourquoi les manifestants ne s’intéressent-ils pas plutôt aux « débouchés politiques ? Pourquoi se préoccuper ainsi des reliques ? En quoi l’histoire importe-t-elle ? Déboulonner une statue, affirment certains détracteurs, ne changera rien. Ce qu’ils ne saisissent pas, c’est que les luttes autour de ces statues sont des luttes de sens, et que modifier le sens de quelque chose change tout – pour la bonne raison, précisément, que les humains ne sont pas des brutes (p. 217).
Amitav Ghosh (2024). La malédiction de la muscade. Wildpr
Contexte
Dans ce numéro dédié aux thèmes du conservatisme et des mouvements réactionnaires, il nous semblait essentiel d’aborder les carnavals belges, tels que celui d’Ath, ainsi que leurs figures controversées qu’ils mettent en scène, comme le Sauvage (rebaptisé le Diable) ou Zwarte Piet. Ces personnages, façonnés par la tradition, incarnent un folklore auquel beaucoup de personnes s’identifient. Pour autant, est-ce que ce même folklore justifie que le racisme et la négrophobie doivent rester associés à ces représentations ? La tradition peut-elle, en son nom, excuser de telles dérives ? En quoi ces symboles perpétuent-ils des imaginaires coloniaux et comment comprendre les vives oppositions militantes, mais également les mouvances conservatrices et réactionnaires qu’ils suscitent ? Ces questions révèleraient, entre autres, l’enjeu d’une mémoire coloniale méconnue par une partie de la population en Belgique, bien qu’elle soit inscrite dans son historicité.
Aborder cette histoire coloniale peut donner l’impression de s’éloigner du sujet principal (les carnavals). Pourtant, ce contexte historique expliquerait en partie les réactions conservatrices et réactionnaires aux revendications antiracistes, exacerbées par une méconnaissance de cette partie de l’histoire belge. À cette dimension historique s’ajoute la valeur d’appartenance culturelle et parfois générationnelle des défenseurs des folklores, pour qui ces traditions font partie intégrante de leur identité, jouant ainsi un rôle important dans la cohésion sociale du pays.
Cet article propose donc d’analyser les tensions et les différentes perceptions autour de ces traditions, en croisant deux approches. D’abord, par la perspective psycho-sociale apportée par le Pr Laurent Licata, spécialiste en psychologie sociale et interculturelle à l’ULB ; ensuite, celle de l’engagement militant, avec Mouhad Reghif, membre fondateur et porte-parole de Bruxelles Panthères, afin de mieux comprendre la complexité de cette controverse. Nous présenterons le sujet en quatre parties : une exploration du folklore belge et de son héritage culturel ; une étude des défis sociaux et psychologiques soulevés par ces traditions ; un examen des stratégies militantes de Bruxelles Panthère ; et enfin, une réflexion sur les perceptions opposées et les possibilités de dialogue entre ces deux visions du patrimoine belge.
Le carnaval en Belgique, héritage culturel et perceptions variées
On observe des visions divergentes autour des symboles et traditions, accompagnées de défis pour reconnaître les injustices, passées et présentes. L’échange avec Laurent Licata[1], professeur à l’ULB, a mis en évidence l’importance d’un dialogue constructif entre les parties pour parvenir à une compréhension mutuelle.
Il est important de souligner que 2020 a été une année charnière pour les mouvements décoloniaux, marquée notamment par les actions de Black Lives Matter. En ce qui concerne l’histoire coloniale, une partie de la population belge aurait une méconnaissance de l’histoire coloniale. Cependant, il y a aussi une bonne partie d’intellectuels qui connaissent le sujet, mais qui continuent de défendre les traditionalistes.
Les perceptions autour des traditions et des symboles, tels que le Sauvage de Ath, varient fortement selon les parcours individuels et le vécu migratoire. Pour les personnes afrodescendantes, ces représentations sont naturellement perçues comme offensantes en raison de leur histoire ; tandis que, de l’autre côté, les défenseurs des traditions les considèrent comme éléments constitutifs de leur identité culturelle. Cette opposition démontre la nécessité d’un dialogue, comme le souligne le Pr Licata, pour que les deux parties se sentent écoutées et avancent vers une compréhension commune.
Il paraît essentiel de développer des outils psychopédagogiques afin d’aider les traditionalistes et défenseurs du folklore à saisir pourquoi certaines traditions peuvent être vécues comme offensantes. Cela inclut la création d’espaces sûrs où chacun peut s’exprimer sans crainte de réactions hostiles. Par ailleurs, intégrer davantage l’histoire coloniale et les injustices raciales dans les programmes scolaires contribueraient à améliorer la compréhension de ces enjeux, tout en respectant la liberté d’opinion à travers un dialogue respectueux et inclusif.
Les actions de sensibilisation menées par Bruxelles Panthère, comme l’envoi de courriers aux élus et aux ministres compétents, leurs innombrables communiqués, leurs articles, leurs conférences et leur présence sur les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant qui a permis de soulever les problématiques liées à ces symboles et traditions racistes. Bien que légitime, cette sensibilisation suscite parfois une réaction défensive chez certains traditionalistes qui se sentent attaqués dans leur identité culturelle, révélant une polarisation croissante entre les deux camps. Toutefois, les mouvements comme Bruxelles Panthère ouvrent des perspectives de dialogue constructif et de réévaluation des traditions, favorisant ainsi des pratiques plus inclusives.
Dans un contexte de diversité croissante, les traditions, bien qu’essentielles à la cohésion sociale, doivent évoluer pour mieux refléter la pluralité de la société actuelle. Les tensions entre tradition et décolonisation peuvent certes creuser des fractures, mais elles peuvent également catalyser des discussions cruciales sur l’identité et la reconnaissance des minorités. Ainsi, la création d’espaces de dialogue où chacun peut être entendu semble primordiale.
La méconnaissance de l’histoire coloniale en Belgique constitue un frein à la compréhension des enjeux actuels : de nombreux traditionalistes ignorent encore les implications racistes de certaines coutumes. Et c’est là qu’intervient le rôle l’éducation permanente avec une sensibilisation accrue essentielle pour pallier cette lacune. Bien que la prise de conscience ait progressé ces dernières années, il reste un long chemin à parcourir.
Le carnaval en Belgique : entre antiracisme et tradition
Au travers d’une longue discussion cette fois-ci avec Mouhad Reghif[2] de Bruxelles Panthère nous avons pu aborder la question du racisme et de la négrophobie dans certains folklores dits traditionnels tels que les carnavals. Bien que nous ne soyons pas alignés sur toutes les positions politiques de Bruxelles Panthères, les actions menées par ce collectif antiraciste ont attiré notre attention, car nous savions bien qu’ils avaient subi une vague de haine et de commentaires « réacs » à la suite de leur victoire avec l’UNESCO. C’est la raison pour laquelle il nous semblait opportun d’en parler avec son représentant.
Certains carnavals regorgeraient de représentations racistes notamment à travers des personnages comme le Père Fouettard, qui est associé à des stéréotypes négatifs sur les personnes noires et antisémites comme avec les caricatures des personnes juives orthodoxes représentées avec un nez crochu, assisses sur des sacs d’or, somme toute des symboles qui reprenaient la rhétorique anti-juive de l’époque. Ces manifestations dépeignent souvent les minorités avec des traits et des attributs grossiers qui renforcent les stéréotypes déjà existants. Il y a eu aussi les folklores de Malmédy et Stavelot où des personnes représentaient et incarnaient des peuples autochtones et des personnes noires, sans se soucier de l’image que cela pourrait provoquer et donner. Nous avons beaucoup entendu parler du Carnaval d’Alost en 2019 lorsque l’UNESCO avait retiré la parade annuelle de la liste du patrimoine culturelle mondial après les représentations antisémites. Sophie Wilmes à l’époque Première Ministre disait même que ces caricatures nuisaient à l’image de la Belgique.[3] Cela a aussi généré des réactions véhémentes et réactionnaires de la part du bourgmestre d’Alost, du collectif responsable de l’organisation du carnaval et des habitants de la ville.
En 2018, une action menée par Bruxelles Panthères a conduit à l’annulation de la « sortie des nègres » après un plaidoyer de qualité auprès du bourgmestre de Lessines. C’était par peur des troubles que l’évènement pourrait engendrer que celui-ci annula l’évènement. Pourtant, malgré l’annulation, les organisateurs ont continué à perpétuer des pratiques racistes en renommant l’évènement « sortie des diables » tout en conservant des éléments du blackface, ce qui démontre une résistance au changement et une minimisation des préoccupations soulevées par les militants antiracistes et de la société civile en général. Pour donner suite à cela, des militants de Bruxelles Panthères ont été convoqués au tribunal pour des accusations de menace dans un contexte terroriste, ce qui selon Mouad Reghif était infondé et visait à criminaliser les actions pacifiques et de sensibilisations. Ils ont été finalement acquittés par le parquet, reconnaissant que leur action ne représentait pas de menaces. Ce qui a légitimé leur position en tant qu’organisation éducative.
Ces mouvements antiracistes ont contribué à changer la perception du collectif au sein de la société même si certains continuaient à les percevoir comme des “terroristes”. Mouad Reghif souligne l’importance pour les partis politiques de lutter contre le racisme plutôt que de se contenter de financements symboliques. Il faudrait plus d’engagements politiques concrets face à ces problèmes systémiques.
La victoire avec l’UNESCO
Mouhad R. souligne l’importance d’adopter une stratégie inspirée de Malcolm X, qui a compris que la question des droits des Noirs aux Etats-Unis était une question de droits humains à aborder au niveau international et notamment à l’ONU. C’est en ce sens que cette inspiration a conduit Bruxelles Panthères à s’adresser à l’UNESCO concernant la Ducasse d’Ath. Plusieurs courriers ont été envoyés dont certains réclamaient l’exclusion de la Ducasse d’Ath et il a fallu trois semaines pour que l’UNESCO leur rende une réponse et de surcroît favorable ce qui a donné raison au collectif sur toute la ligne. En conséquence une demande a été adressée aux autorités belges pour qu’elles modifient et retirent le personnage du « sauvage » de l’évènement.
Les réactions publiques et médiatiques ne se sont pas fait attendre, suscitant un intérêt considérable avec des interviews accordées à la BBC, le Washington Post[4], ou encore Euronews. À la suite de cette surmédiatisation Mouad Reghif a mentionné avoir reçu des menaces et des insultes sur les réseaux sociaux, ce qui illustre la polarisation des opinions sur la question de la Ducasse d’Ath et de la lutte contre la négrophobie mais qui met surtout en avant une mouvance conservatrice et réactionnaire. Après des pressions, le personnage du « sauvage » a été renommé « le diable » et a subi des modifications esthétiques, mais cela ne résoudrait pas le problème de fond de la négrophobie. Malheureusement, en plus de la vague réactionnaire et conservatrice qu‘ils ont pris en pleine face, ils ont été invisibilisés par les médias et politiques belges et dans le processus de rénovation (rendu possible grâce à leurs actions) malgré leur rôle central dans la dénonciation du personnage. La lutte de Bruxelles Panthères a conduit à une modification du droit interne belge, avec l’adoption d’un nouveau décret aligné sur les critères de l’UNESCO, donc même si leur action a été injustement invisibilisée, elle a eu un impact significatif sur la reconnaissance des droits humains et la lutte contre le racisme qui a résonné tant au niveau national qu’international.
Conclusion
Le débat sur le folklore belge et ses symboles racialisés témoigne du conflit entre tradition et conscience décoloniale, où un fort attachement identitaire devient un point de discorde. Nous sommes confrontés à la nécessité de reconsidérer notre patrimoine. Le cas du carnaval, avec des personnages tels que le Sauvage et Zwarte Piet, illustre cette tension et révèle de profondes différences dans les perceptions culturelles et les significations historiques de ces expressions. Les manifestations de Bruxelles Panthères incarnent une volonté d’entamer un dialogue nécessaire sur les symboles de haine noire et de racisme dans le folklore local, et sur la relation entre identité culturelle et colonialisme. Elles soulignent l’urgence d’une réflexion collective. Les victoires militantes comme celle remportée à l’UNESCO montrent que les cadres internationaux peuvent légitimer ces revendications, mais les réactions publiques polarisées et parfois violentes rappellent la nature délicate de ce processus de transformation.
Le rôle d’universitaires comme le Pr Laurent Licata, dans ce dialogue, illustre l’importance de créer des ponts entre les différentes positions pour passer au-dessus de l’incompréhension et mettre en place un espace de dialogue respectueux, ouvert aux critiques, mais tout en restant conscient des impacts identitaires profonds que ces changements impliqueront. Il est crucial de promouvoir des outils pédagogiques et une éducation historique plus inclusive qui rendent visible l’histoire coloniale belge, pour que les nouvelles générations puissent mieux appréhender les enjeux actuels. Finalement, étant donné que les traditions représenteraient un ancrage culturel fort pour certains, elles ne doivent pas se soustraire aux exigences d’une société plurielle. Ce débat, loin d’être clos, pose les jalons d’un renouveau culturel qui, en s’ouvrant davantage aux réalités multiculturelles, pourrait enrichir l’identité belge en incluant celles et ceux qui en ont été exclus.
[1] Laurent Licata, professeur en psychologie sociale et interculturelle à l’Université libre de Bruxelles (ULB), entretien personnel avec l’auteur, 30 septembre 2024
[2] Mouhad Reghif, membre fondateur et porte-parole de Bruxelles Panthères, entretien personnel avec l’auteur, 6 octobre 2024
[3] Euractiv. (2024, 14 novembre). Le Premier ministre belge réagit au controversé carnaval d’Aalst. Euractiv France
[4] Harlan, C. (2019, 20 août). A Belgian festival has long featured savage blackface. Is it time for the U.N. to stop honoring it? The Washington Post.