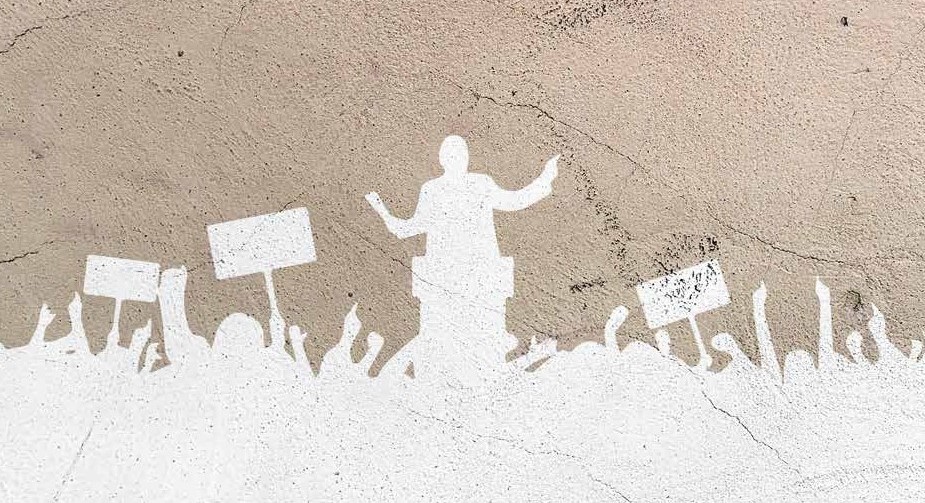*Cet article tire son origine d’une production commandée par le journal “Politique – Revue de débats”. Il a ensuite été retravaillé pour Bruxelles Laïque.
Alors qu’à la rentrée tant Elisabeth Degryse que Valérie Glatigny avaient assuré que “la gratuité scolaire ne sera pas remise en cause”, des décisions et projets de la Ministre de l’Education inquiètent pourtant. Le coût de l’école pourrait bien demain, encore plus qu’aujourd’hui, être à deux vitesses. Une remise en perspective du droit à la gratuité scolaire est donc nécessaire.
La gratuité scolaire en Belgique : loi catholique, puis consensus général
C’est en 1914 que pour la première fois, une loi belge déclare l’enseignement obligatoire et gratuit pour chaque enfant, jusqu’à 14 ans. Cette loi est à replacer dans le cadre de l’après-première guerre scolaire (1879-1884), à laquelle cléricaux et anticléricaux se livraient avec acharnement.
C’est en réalité trois décisions parallèles qui ont construit les fondamentaux de notre école publique : le même jour, on a voté l’interdiction du travail des enfants, l’obligation scolaire pour tous et, comme corollaire, la gratuité de l’école. Si on interdisait aux enfants de travailler et qu’on les obligeait à aller à l’école, on n’allait pas en plus demander aux parents de financer une seconde fois l’école que leurs contributions fiscales payaient déjà.
À l’époque, c’est un gouvernement catholique qui a mis en place cette loi, portée par Prosper Poullet (Parti catholique). Dans ce contexte, la gauche, pourtant acquise au principe de l’école obligatoire gratuite, avait même quitté le Parlement en signe de protestation. L’école publique communale (organisée par l’État), et qui était principalement à destination des plus pauvres, était en effet déjà soumise à la gratuité. Et le corollaire de la gratuité de l’école obligatoire pour tous était le financement de toutes les écoles, publiques comme privées (confessionnelles), par l’État.[1]
L’accès à l’enseignement était donc gratuit. Et les fournitures et manuels, nécessaires pour l’exercice de l’obligation scolaire ? C’est la fin d’une deuxième guerre scolaire qui permettra de résoudre cette question. Et cette fois, il y a consensus général. En 1958, sous l’égide de Gaston Eyskens, le Pacte scolaire est négocié et adopté entre catholiques, socialistes et libéraux. Un de ses engagements est de réaffirmer la gratuité scolaire pour tous, laquelle s’étend au matériel scolaire. Depuis, la loi affecte expressément les dotations des établissements à la distribution gratuite de manuels et fournitures aux élèves soumis à l’obligation scolaire. Ce lien entre obligation scolaire et gratuité est encore confirmé en 1983, sous le gouvernement Martens V, quand une loi étend l’obligation à 18 ans. Le ministre qui porte cette loi s’appelle Daniël Coens (CVP), père de Joachim Coens, ex-président du CD&V.
Dans les faits, cependant, on n’y est pas et malgré la lettre de la loi et son esprit, de très nombreuses écoles ont continué à demander aux parents de financer directement ou indirectement leur mission de service public, dans l’attentisme et le laissez-faire des pouvoirs publics, qui leur ont pourtant alloué des moyens publics substantiels pour ce faire.
Suite aux travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence initiés par Joëlle Milquet (cdH) en 2015, la marche vers la mise en œuvre de la gratuité scolaire reprend à la demande de l’ensemble des acteurs de l’enseignement (pouvoirs organisateurs d’écoles, syndicats d’enseignants, associations de parents). C’est Marie-Martine Schyns (cdH) qui instaure la gratuité des fournitures dans l’enseignement maternel à partir de 2019, et Caroline Désir (PS) poursuit le mécanisme au début de l’enseignement primaire à partir de 2022. Sous Valérie Glatigny (MR) cependant, la progression au-delà de la 3e primaire a été gelée.
Le droit fondamental protégé : la gratuité de l’enseignement
Le consensus général pour la gratuité scolaire a été si important que ce principe s’est mué en droit fondamental et constitutionnel de chaque enfant depuis la fin des années 80. La gratuité scolaire est aujourd’hui protégée à la fois par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Constitution belge.
L’étendue de ce droit fondamental de chaque enfant a parfois été contestée : est-ce qu’il faut interdire tous les frais scolaires, ou seulement ceux d’inscription ? Cette contestation a elle aussi une source historique : à l’époque où on a inscrit la gratuité scolaire dans la Constitution, on y a protégé la « gratuité d’accès » à l’enseignement. Ce terme avait été choisi pour ne pas rendre immédiatement anticonstitutionnelles des pratiques de perception de frais scolaires qui existaient alors dans l’enseignement secondaire supérieur (en ce compris le qualifiant). Pour l’enseignement fondamental, il n’y avait par contre pas de discussion. Les travaux préparatoires constitutionnels précisent d’ailleurs que « pour l’enseignement maternel et primaire, « en ce compris les quatrièmes degrés » (l’ancien enseignement d’obligation scolaire), cette gratuité implique la mise à la disposition gratuite de livres scolaires et de fournitures classiques ».
Cette distinction avec l’enseignement secondaire n’a cependant plus lieu d’être, depuis que la Convention internationale des droits de l’Enfant et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux ( ?) et culturels ont été ratifiés par la Belgique, et que la Cour constitutionnelle estime qu’il faut interpréter tous les textes de droits fondamentaux ensemble, en vertu de la théorie de « l’ensemble indissociable ».[2] La gratuité scolaire protégée est bien celle de l’ensemble de l’enseignement obligatoire suivi, pas simplement son accès. Cela a été rappelé tant par la Cour constitutionnelle qu’encore récemment en 2019 par le Conseil d’État, lequel estime que « l’effet de cliquet empêche que les pouvoirs organisateurs puissent faire payer des frais pour des services ou fournitures obligatoires, à tout le moins pour les manuels et fournitures scolaires que la dotation, pour l’enseignement de la Communauté, et les subventions, pour l’enseignement subventionné, doivent couvrir »…[3] C’est donc bien vers la fin de l’ensemble des frais scolaires que la Fédération Wallonie-Bruxelles doit encore progresser.
Sous le gouvernement Degryse et la ministre Glatigny, la gratuité scolaire en danger
On l’a dit, les assurances de la Ministre-Présidente et de la ministre de l’Éducation que “la gratuité scolaire ne sera pas remise en cause” ne sont pas aujourd’hui cohérentes avec les décisions prises.
D’une part, alors que la gratuité des fournitures devrait déjà être intégralement d’application dans l’ensemble de l’enseignement primaire, le gouvernement a décidé de geler à la 3e primaire la progression de ce système dans lequel ce sont désormais les écoles qui fournissent aux élèves le matériel de base nécessaire aux apprentissages (contenu du plumier et du cartable). À partir d’août 2025, chaque année, les parents de 56 000 enfants perdront le bénéfice du dispositif et verront leur facture de rentrée scolaire augmenter d’une centaine d’euros, quand leurs enfants arriveront en 4e primaire. D’autre part, la ministre Glatigny a suspendu à la rentrée 2024 l’inspection des frais scolaires, ce service public qui avait été organisé depuis 2021 pour vérifier l’application de la loi autorisant certains frais scolaires[4] dans les écoles.
Geler la gratuité et arrêter de contrôler les écoles ? Ces décisions ne concordent pas avec la réalité de terrain – et ce, sans parler ici du fait qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, deux parents sur trois déclarent actuellement vivre des difficultés financières du fait du coût de l’école.[5] Début 2025 est en effet parue la plus large évaluation jamais réalisée de la gratuité scolaire et du respect de la législation lorsque celle-ci autorise la perception de frais scolaires (83% des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles visitées en quatre ans). Elle a montré que lorsque la loi autorise – à l’encontre du droit fondamental – les écoles à percevoir des frais scolaires, moyennant certaines garanties données aux parents[6], 72% des écoles sont en infraction sur l’observation de ces garanties.[7] Par contre, lorsque la logique n’est pas la perception des frais, mais la gratuité, le schéma s’inverse. Pour le nouveau système de fournitures scolaires distribuées par les écoles en maternelles et début de primaires initié en 2019 par Marie-Martine Schyns (cdH), 92% des écoles respectent intégralement la loi et l’adhésion des directions est massive.
Interrogées par l’administration sur les effets de ce nouveau système, les directions se sont en effet montrées très positives. Elles ont pu témoigner que le système de gratuité est plus simple administrativement que le fonctionnement par frais scolaires. Dans le système par frais scolaires autorisés en effet, certains frais sont acceptables et d’autres non ; les directions sont tenues à communiquer certaines informations à intervalles réguliers ou doivent prévoir des procédures d’échelonnement des frais ; certains frais ne peuvent être demandés que facultativement aux parents, ce qui rend peu prévisible la contribution totale que l’école recevra des parents ; si une famille est en difficulté, l’école est tenue d’adapter le paiement à la situation sociale ; et enfin, ce système de frais scolaires exige parfois de multiplier les rappels, voire d’intenter des procédures de recouvrement complexes, longues et incertaines pour les directions, et humiliantes pour les parents…
Mais les directions ont également souligné des mérites intrinsèques au système, au bénéfice premier des conditions d’enseignement pour les élèves. Elles ont ainsi été nombreuses à signaler que le système de gestion du petit matériel de base par les écoles améliorait l’égalité des chances à l’école. Elles ont constaté qu’il assurait à chaque élève la mise à disposition du même matériel de qualité sélectionné par les écoles et que la qualité du matériel à disposition en était renforcée, donc la qualité des conditions d’apprentissage. Elles ont souligné que les budgets affectés permettaient en plus d’organiser plus et de meilleures activités scolaires. Et enfin, elles ont noté une amélioration de la relation parents-écoles. Rien que ça.
Les conclusions sont donc évidentes : il faut poursuivre les contrôles dans les écoles et étendre la gratuité scolaire, puisque le mécanisme fonctionne bien. C’est du reste ce que l’administration de l’enseignement recommande dans les conclusions de cette évaluation.
La fausse bonne idée : différencier la gratuité et la réserver à certains
Est-ce parce que les conclusions de l’évaluation ne vont pas dans le sens souhaité ? Toujours est-il que la ministre Glatigny a annoncé une deuxième évaluation de la gratuité scolaire et que, dans l’intervalle, le gel de la gratuité des fournitures est prolongé, alors que les maigres budgets nécessaires à sa progression avaient été trouvés. Cette seconde évaluation est prévue en 2026 (seulement), et avec un objectif quelque peu différent. La ministre a en effet décidé d’amalgamer une réévaluation du dispositif de gratuité des fournitures scolaires à l’examen de différents dispositifs de réduction de frais maintenus à charge des parents sans pour autant les faire à ce jour basculer dans la gratuité (exemple : achat ou location de matériel informatique par les parents, subventions visant à réduire le coût de la surveillance du temps de midi, transports scolaires), ou d’aide aux élèves et familles en difficulté (exemple : décret avantages sociaux, repas gratuits dans les écoles de milieux socio-économiques défavorisés, ou encadrement différencié). Elle appelle l’ensemble de ces dispositifs “mécanismes de gratuité”, alors que la gratuité scolaire n’est pas une aide sociale destinée aux plus précaires, mais un mode de financement de l’enseignement intégralement par l’impôt et que la gratuité scolaire protège (jusqu’à aujourd’hui) l’exercice de l’obligation scolaire, non pas l’alimentation des élèves.
Plusieurs des interventions de la ministre Glatigny indiquent qu’elle souhaite réfléchir à réserver la distribution du petit matériel scolaire aux seules familles en difficultés financières. Ce projet envisagé complexifierait énormément la tâche aux écoles. Il engendrerait un sentiment d’arbitraire intolérable découlant de l’effet de seuil généré (pourquoi la famille Michel devrait-elle bénéficier de son droit fondamental à la gratuité scolaire, mais pas la famille Durant qui gagne 25 euros de plus par mois ?). Il stigmatiserait les enfants de pauvres qui recevraient les crayons et classeurs de l’État devant leurs condisciples qui, eux, recevraient ceux fournis par leurs parents… Et il violerait certainement le droit fondamental à la gratuité scolaire.
La gratuité scolaire est un droit pour tous les enfants. Chacun y a droit, puisque chaque famille contribue déjà au financement du service public d’enseignement, à proportion de ses capacités financières via l’impôt. Ce n’est donc pas un gel de la gratuité qu’il faut prôner, ni de la réserver à certains enfants plutôt que d’autres. La première des responsabilités de Valérie Glatigny – et celle de son partenaire de gouvernement qui a par ailleurs le portefeuille de la coordination des droits de l’Enfant – c’est de mettre en œuvre les engagements juridiques appelant la Fédération Wallonie-Bruxelles à arriver progressivement à la gratuité complète de l’école.
[1] WYNANTS Paul, La loi du 19 mai 1914 sur l’instruction primaire : une avancée démocratique ? dans O par, L Société, A de, N en, C avec, L Facultés, U Notre-Dame, D la & À Paix (eds), Congrès de Namur : 28-31 août 2008 : actes. vol. T. 2, Presses universitaires de Namur, 2011, Namur, pp. 253-264
[2] C.C., arrêt n° 136/2004 ; explications détaillées ici, p. 9 : https://www.const-court.be/public/stet/f/stet-2021-001f.pdf
[3] Lire plus spécifiquement les pp. 25 et 26 : https://archive.pfwb.be/1000000020b401b
[4] A l’encontre du droit fondamental, donc…
[5] https://liguedesfamilles.be/article/barometre-des-parents-2024
[6] Certains frais sont exigibles et pas d’autres, certains frais ne peuvent être proposés que facultativement, communication claire aux parents explicitant les frais autorisés et ceux qui sont toujours facultatifs, échelonnement toujours possible des frais, adaptation des paiements à la situation sociale de la famille, etc.
[7] https://liguedesfamilles.be/article/frais-scolaires-voyage-en-zones-de-non-droit