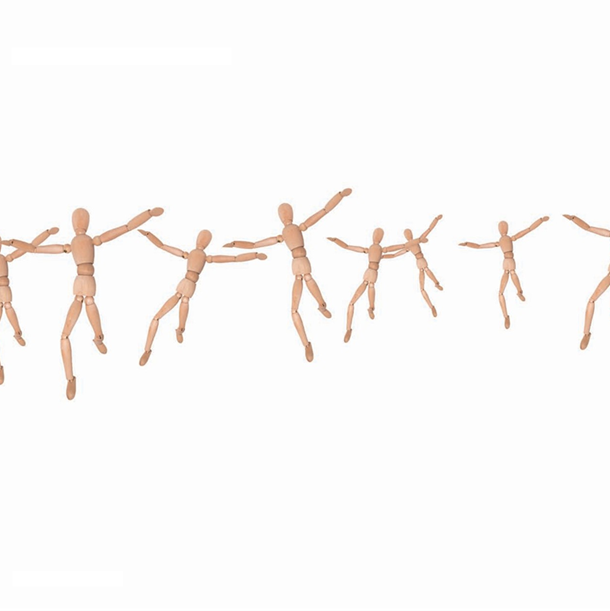Depuis fin 2017, l’Iran a connu plusieurs vagues de protestations périodiques dans différentes régions du pays. Même si la capitale iranienne, Téhéran, a souvent constitué un épicentre, des contestations ont également lieu dans d’autres grandes villes urbaines (Machad, Ispahan, Shiraz) et dans les villes périphériques (Kermanshah, Gorgan, Arak) du pays. Le visage de la contestation change et prend différentes formes en fonction des restrictions imposées par l’État. Différents espaces et moyens sont explorés pour la propagation et la diffusion de cette contestation populaire. Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de donner un aperçu des différentes formes d’expressions protestataires contre l’État iranien et à l’encontre de la figure politicoreligieuse, remise de plus en plus en question par la jeunesse iranienne.
CONTINUITÉ
Les récents mouvements de mobilisation de la population sont loin de constituer une nouveauté en Iran. Le pays a connu, dès l’avènement de la République islamique d’Iran (1979) et durant cette dernière décennie, une série de mouvements contestataires à l’encontre de l’État, de la mise en place de l’architecture institutionnelle de la société islamique et de l’imposition du voile obligatoire pour les femmes. Dans les médias occidentaux, l’attention a principalement été portée sur ce qu’on a communément appelé le “Mouvement vert”, qui s’est développé en réaction aux résultats des élections présidentielles de juin 2009. L’ensemble de ces soulèvements a d’ailleurs précédé le “Printemps arabe” (à partir de décembre 2010) – et en ce sens, l’Iran a été l’un des premiers pays du Moyen-Orient à connaître une expression directe, visible, physique et sans équivoque du mécontentement populaire.
RUPTURE
Un sentiment commun est souvent partagé : la perte de confiance vis-à-vis du système et des autorités étatiques. Ce manque de confiance a pris racine dès 1979 avec la mise en place d’une série d’organes répressifs, les arrestations arbitraires et disparitions d’opposants politiques et la volonté systématique d’un contrôle total et d’une surveillance omniprésente, sans parler de nombreuses bavures, issues de la mauvaise gouvernance et des lacunes
organisationnelles à l’échelle du pays. Ce contexte politique a non seulement semé la méfiance sociale, mais a fait du non-dit, du double-discours, de la langue de bois et du mensonge, de la corruption, un mode de (sur)vie pour la société et un mode de gouvernance pour le détenteur du pouvoir politique.
Cet effritement de la légitimité politique, un processus qui a débuté, selon nous, dès 2005, s’est confirmé à différentes occasions. À titre d’exemple, la population a été particulièrement échaudée lorsqu’elle a commencé à réaliser que, face aux nombreuses catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, glissements de terrain, etc.), la réponse étatique était souvent lente et inefficace, voire inexistante ; ou encore par l’incident de la frappe du vol PS 752 par deux missiles iraniens, avec une perte totale de 176 personnes à bord, en janvier 2020. Cette bavure étatique a démontré à nouveau l’incapacité de l’État iranien à être un État protecteur, à assumer publiquement ses actes et à être transparent.
Bien que le discours politico-idéologique de l’État continue à défendre, depuis 1979, la rhétorique “de l’ennemi et de la menace extérieure”, en provenance principalement des États-Unis et d’Israël, on a pu entendre à travers les slogans populaires, lors des derniers soulèvements en janvier 2020, un rejet de la diabolisation de l’Autre : “l’ennemi se trouve bel et bien au sein du pays et au cœur de l’État et non pas à l’extérieur du territoire iranien”, lançaient les manifestants. Les Iraniens reprochent aussi à l’État de prioriser la cause palestinienne, les enjeux du Hezbollah libanais et de s’impliquer socialement, économiquement et militairement en Syrie, en Iraq et au Venezuela au détriment des intérêts et du bien-vivre du peuple iranien.
Enfin, la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 a également été fortement critiquée par la population iranienne et a démontré à son tour le manque de coordination, de transparence et de gestion efficace et efficiente de la part des autorités étatiques. Ces différents exemples nous aident à comprendre la construction de cette perte de confiance vis-à-vis du système et la genèse d’un sentiment de méfiance et d’insécurité à travers le pays. La confiance sociale, légale et politique a été à maintes reprises minée et brisée par divers dysfonctionnements de l’État. Une méfiance contagieuse s’est alors propagée non seulement à l’égard des forces de l’ordre et de la sphère politique, mais aussi à l’égard des gardiens de la morale religieuse et du pouvoir judiciaire.
PRESSIONS MULTIFORMES
La pression qui pèse sur la société iranienne est à la fois idéologique, morale, sociale et économique. La critique dépasse aujourd’hui largement l’ingérence quotidienne de l’État dans la vie privée de ses citoyens. Ce qui est reproché à l’État iranien, c’est le non-respect du “contrat social”. Même au sein d’un État autoritaire, le Léviathan, tel que le philosophe Thomas Hobbes (15881679) le caractérisait, est censé garantir la sécurité et un minimum de bienêtre à ses citoyens, mais ce n’est pas le cas pour le Léviathan iranien. La lecture de cette rupture entre l’État et la société peut aussi se comprendre par un emprunt sociologique à une vision bourdieusienne de la contestation iranienne : Pierre Bourdieu soulignait dans La misère du monde que la main gauche de l’État éduque, nourrit, aide, loge, et garantit un système de santé, alors que sa main droite punit par l’intermédiaire de l’exécutif (le policier) et du judiciaire (le juge). En Iran, force est de constater que l’État déploie principalement sa main droite, sous la forme la plus répressive en dépassant largement la violence symbolique et la coercition légitime (Max Weber)[1] et en faisant abstraction de sa main gauche, censée garantir un état de droit à l’ensemble de la population, sans distinction d’ethnie, d’appartenance religieuse et de classe.
Sous le poids des inégalités et injustices sociales, du fléau de la corruption, d’une inflation constante, d’un chômage endémique, d’une dépréciation monétaire régulière, d’une précarité et paupérisation croissantes, la frange anti-austérité (composée principalement de retraités, d’enseignants, d’étudiants et de la classe ouvrière) est souvent au cœur des mobilisations populaires et sa présence est de plus en plus visible malgré le risque d’arrestation. Cette visibilité et l’occupation de l’espace public démontrent que la peur viscérale des brigades antiémeutes et de la figure de l’autorité morale et religieuse s’affaiblit.
PROTESTER : ACTE DE RÉSISTANCE ET STRATÉGIE DU DÉTOURNEMENT
Dans une société où les contraintes politico-religieuses et économiques sont devenues coutumières, les réactions se multiplient et différentes formes de résistance se mettent en place, notamment via des campagnes sociales et actions collectives. On peut notamment souligner ici la campagne nommée Un million de signatures menée par des femmes militantes mobilisées contre les lois discriminatoires de la législation iranienne (en 2006), la campagne Mercredis blancs contre le port obligatoire du voile (en 2017), la campagne Je suis Majid Tavakoli pour soutenir ce leader étudiant arrêté et emprisonné à la suite de ses discours et prises de position lors de manifestations (en 2006 et 2009), ou encore la campagne Je n’enregistre pas mon blog (dès 2007) pour détourner la surveillance étatique du cyberespace.
L’expression des revendications et la dénonciation de la pression socio-économique ne se limitent plus uniquement à la rue et aux enceintes universitaires, elles s’exposent aussi dans les espaces intermédiaires, comme les taxis ou salles de cours, via la création artistique (cinéma, peinture, théâtre, musique, etc.) ou encore via la forte utilisation des plateformes numériques (réseaux sociaux, blogs, applications mobiles, etc.). Certes, aucun de ces espaces (public, privé ou virtuel) n’est sans risque de répression étatique. Protester en Iran constitue, encore en 2020, un acte dangereux. Les personnes qui manifestent le font au risque de leur vie : arrestation, emprisonnement, perte d’emploi ou encore renvoi définitif de l’établissement scolaire pour les étudiants, et l’ouverture d’un casier judiciaire qui leur interdira de s’inscrire par la suite à l’université ou de décrocher un emploi.
LA RÉSISTANCE CRÉATIVE
C’est justement à partir de cette tension à la fois sociale, politique et économique que sont nées des formes de résistances créatives. La production artistique et l’art, au sens large du terme, à travers différentes disciplines, peut être considérés comme un acte de résistance en soi, principalement dans un contexte particulier de surveillance, de contrôle et de censure. La résistance des artistes iraniens peut aussi être parfois invisible, silencieuse, non-armée, et “infra-politique”[2] (infrapolitics) : “[…] on peut résister d’abord par l’acte même de créer”.[3] Cette création artistique devient une manière de s’exprimer et s’inscrit délibérément à l’encontre de ce qui est considéré comme révoltant, injuste, inadmissible. La création artistique s’emploie à combattre avec force, à dénoncer, à faire réfléchir ou à provoquer. L’idée, la critique ou la dénonciation émises par l’œuvre créée, ainsi que tout le travail de réflexion en amont accompagnent le processus de la création artistique, particulièrement lorsqu’il s’agit pour les artistes en arts visuels de développer un art dit conceptuel ou contextuel, et pas forcément un art dit “politique” qui serait donc par définition “en prise avec le monde social et politique”.[4] Alors que dans les pays occidentaux, l’artiste est avant tout en prise avec la pratique et le déploiement de son art, en Iran, l’artiste est d’abord et avant tout “en prise avec le monde social et politique”.
Étymologiquement, le mot “résistance” vient du latin resistere, de restare qui signifie “être debout”“, “tenir tête”, “tenir ferme”, dans une préoccupation, ni morale ni immorale, mais bien vitale et existentielle. L’artiste, en Iran, “se tient debout” et donc résiste en créant. Il crée pour résister et s’inscrit pleinement dans le fameux mot d’André Gide : “L’art naît de contrainte, vit de lutte, meurt de liberté”.[5] Il s’agit aussi dans ce cadre de résister au danger (au niveau de la prise de risques politiques) et face à l’inquiétude sociale collectivement partagée. Dans le milieu artistique, les meilleurs exemples sont l’existence même des collectifs et regroupements d’artistes : ainsi la Maison du Cinéma ou l’Association des Ecrivains iraniens.
On peut aussi citer l’exemple du réalisateur Jafar Panahi qui a été interdit de tourner des films, de donner des interviews et de sortir du territoire iranien. Toutefois, il continue à réaliser de manière clandestine et la distribution de ses productions s’effectue de manière étendue sur la scène internationale et dans le cadre de festivals prestigieux, en recevant non seulement un accueil favorable du public, mais aussi des récompenses par le milieu cinématographique. Certes, il ne peut pas donner des entrevues officielles à des journalistes, mais il reste très actif sur les
réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram, en maintenant ainsi le lien social avec le monde extérieur.
Cette résistance n’est pas toujours physique ou matérielle, mais elle peut également s’exprimer silencieusement par une absence corporelle, une “résistance silencieuse” parce que des voix semblent s’affairer même dans le silence. Le meilleur exemple que nous pouvons avancer, c’est l’absence de certains artistes dans certains lieux, comme par exemple dans le Festival Fajr ou lors de certaines rencontres (conférences, congrès, etc.) organisées par l’État iranien. Au même titre, l’abstentionnisme lors des élections iraniennes peut être considéré comme une forme de résistance, voire même d’une traduction possible de l’opposition au système et d’un mécontentement socio-politique de la société face à l’État : “[…] ces petites résistances muettes, obstinées, singulières qui rythment nos journées !”[6]
FRUSTRATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Même si l’âge des contestataires est assez représentatif d’une démographie jeune en Iran, la frustration sociopolitique et économique est bien intergénérationnelle. La génération 2.0 tente tant bien que mal de composer et de vivre avec les pesanteurs culturelles, une modernité exogène, une perte de repères, une moralité religieuse imposée et ses désirs refoulés. La jeunesse se pose en contradiction constante, en quête et avide de libertés individuelles et assoiffée de changements socio-politiques et culturels.
Cette mise en tension face à l’autorité peut se comprendre, à travers différentes générations, dans une triple dialectique :
- entre modernité/rupture & tradition/ continuité, aux prises entre une société moderne à bien des égards, mais qui n’a jamais véritablement produit au préalable un processus interne de modernisation et dans une société en présence d’éléments traditionnels ancrés ;
- entre passé & futur, une nostalgie d’un passé qui n’existe plus ou qui n’a peutêtre même jamais existé, mais qui circule comme une utopie dans le présent, ce qui constitue une difficulté à se projeter dans un avenir et d’organiser sa vie sur l’échelle du temps par manque de perspective d’avenir ou d’espoir d’un changement social possible ;
- la tension existante entre l’État et la société, ou plus précisément, entre les attentes et les besoins de la société et la non-prise en considération de ces demandes multiples par l’État. À la prise en considération de la tension comme source constitutive des formes de résistance se greffe l’établissement de forces contraires et opposées, souvent dans une logique dichotomique et schizophrénique.
ENJEUX MULTIPLES
Nous pouvons effectuer un classement sommaire des types de revendications des trois dernières décennies. Lors des contestations de 1993, 1995 et 2007, les revendications étaient principalement d’ordre économique, alors que celles qui ont surtout émergé en 1999, 2003 et 2009 étaient d’ordre politique.
Pour ce qui est des récentes protestations de 2017 à 2020, même si les revendications restent principalement d’ordre économique, elles glissent aussi vers des questions politiques avec des critiques ciblées (les bas salaires, le port du voile obligatoire, l’approvisionnement en eau, la hausse brutale des prix du carburant, etc.). Il est aussi important de souligner que de nouvelles formes d’activisme, centrées sur les enjeux environnementaux (la désertification, la pollution, la sécheresse, la dégradation des plans d’eau et l’épuisement des ressources en eau), ont aussi émergé en Iran dès les années 1990 : la conscientisation du grand public face aux enjeux écologiques et environnementaux, mais aussi par des actions de lobbying avec pour objectif de porter des demandes de réformes au niveau local.
Cette prise de conscience collective et individuelle et la perte de confiance totale de la population iranienne face au système aboutiront indéniablement à une rupture décisive entre la société et l’État. Malgré la répression étatique, les contestations vont continuer à avoir lieu et pourront être de plus en plus violentes alors que, jusqu’ici, à part quelques incidents mineurs, les actions contestataires étaient principalement pacifiques et sans
un appel aux armes. Cette rupture se creusera davantage, ou pas, en fonction de la prise en considération de la réalité sociale et économique des citoyens et de la réponse de l’État iranien à son égard.
[1] Le concept du monopole de la violence physique légitime (Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit) est une définition sociologique de l’État développée par Max Weber dans Le Savant et le politique, 1919.
[2] James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, New Haven, Yale University Press,1990.
[3] Dominique Noguez, “Le vilain petit cygne”, Résister – Le prix du refus, Éditions Autrement, Série morale, n°15, 1994, p. 96.
[4] Aline Caillet, “Figures de l’engagement, esthétique de la résistance”, Revue Esse, Art et Opinions – Thème : 20 ans d’engagement, Printemps /Été 2004, p. 10.
[5] André Gide, l’Évolution du théâtre, Conférence faite à Bruxelles le 25 mars 1904, dans Nouveaux Prétextes, Paris, Mercure de France, 1911, p. 17.
[6] Catherine Dommergues, “Jour après jour”, Résister – Le prix du refus, Éditions Autrement, Série morale, n°15, 1994, p. 23.
©image : MANA Neyestani