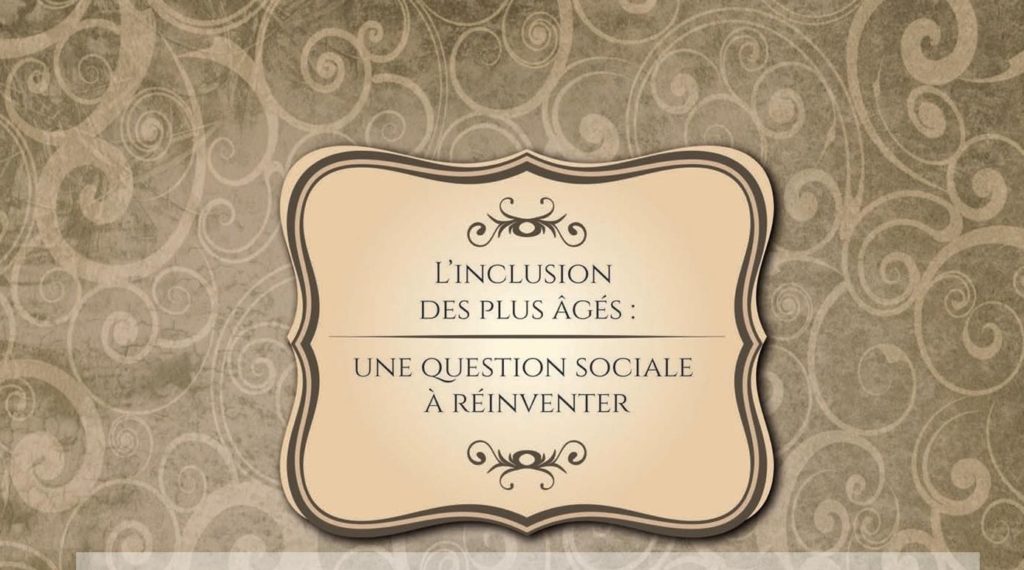« Seulement, on peut dire que plus le gouvernement a de force,
plus le Souverain doit se montrer fréquemment ».
J. J. Rousseau, Du Contrat Social, III : 13
Nous vivons une époque de basculements géopolitiques importants. Les alliances historiques s’étiolent, ce qui remet en question les fondements de la démocratie, voire sa viabilité dans un monde multipolaire et, a fortiori, dans l’Union européenne (UE). Dans ce contexte, il est capital pour cette dernière d’incarner politiquement un idéal démocratique fort, ce qui signifie de protéger et de renouveler des institutions capables de pacifier les divergences d’intérêts et de croyances, signes d’une société libre et ouverte. Or, plusieurs gouvernements nationaux œuvrent ouvertement à remettre en cause cette capacité de l’UE et, dans un effet miroir, à mater les divergences au sein de leurs propres sociétés civiles.
Qu’est-ce qui distingue la démocratie des régimes autoritaires ? Pour répondre à cette question, nous devons analyser de quelle manière celle-ci peut et doit civiliser l’économie du conflit, à travers des institutions capables de donner sens à la séparation et l’équilibre des pouvoirs, y compris des contre-pouvoirs et des mécanismes de contestation.
INTRODUCTION
La question de la liberté est une des questions classiques de la tradition philosophique et politique occidentale. Sans entrer dans les détails, disons simplement que cette analyse s’inscrit dans le renouveau de la tradition républicaine, incarné par l’École de Cambridge et les travaux de Philip Pettit – dont nous avons déjà présenté les thèses en ces pages.[1] L’idéal porté par cette tradition est celui de la liberté comme non-domination, que l’on retrouve dans les œuvres d’auteurs classiques comme Machiavel et Rousseau, chez qui on retrouve une opposition entre une élite désireuse de dominer et le grand nombre, qui souhaite seulement être libre. Le renouveau de cette tradition est plus pertinent que jamais, alors que le débat sur les interprétations au sujet de la démocratie se polarise autour des questions de droits individuels, notamment des minorités. On observe de plus en plus des discours et des gouvernements qui prennent en grippe l’hétérogénéité de la matière sociale, le droit d’avoir des droits, le droit d’utiliser ses droits pour faire des choix qui déplaisent aux majorités, ainsi que les mécanismes de contre-pouvoirs et de contestation des décisions politiques et de leur application. La mise en place par Orban en Hongrie d’une démocratie non-libérale en est un exemple parlant.[2] Or, c’est justement le caractère arbitraire du pouvoir que l’idéal de liberté comme non-domination cherche à contrer. Son histoire pourrait être synthétisée en affirmant qu’il s’agit d’une réflexion évolutive sur la démocratisation du statut de citoyen, du droit d’avoir des droits, ce qui sert d’horizon sémantique commun à celles et ceux qui se revendiquent de l’humanisme.
Maintenant que ces bases théoriques sont posées, bien qu’elles puissent faire l’objet de débats, nous pouvons procéder à la présentation de la conception de la démocratie comme « dialogue conflictuel permanent ». En effet, c’est à travers des institutions établies pour civiliser les différends qui existent au sein de la société que réside le potentiel de canaliser l’énergie des tumulti[3], au bénéfice du bien commun. C’est cette capacité à préserver les institutions et la puissance commune envers à la fois les dissensions internes, mais aussi les menaces extérieures que l’on nomme économie du conflit.
PLURALISME, DÉMOCRATIE ET LIBERTÉS
Une société libre, ouverte et démocratique produira naturellement un pluralisme des valeurs et des intérêts. C’est pourquoi le principe de laïcité est un des piliers de la démocratie : les libertés fondamentales qui permettent cette diversité ne peuvent pas faire l’objet de décisions ou de compromis politiques. C’est l’obligation négative qui pèse sur l’État : celle de demeurer neutre face au pluralisme qui compose la matière sociale à laquelle le politique, à travers l’établissement d’une Constitution, donne une forme. L’État ne doit pas prendre position, ni être influencé de façon indue par des groupes particuliers – et, à l’inverse, l’État ne doit pas se mêler de la gestion interne des communautés convictionnelles. Cela dit, les libertés individuelles ne sont pas absolues. Un équilibre doit exister entre les différentes libertés individuelles et l’intérêt commun, ainsi qu’entre les libertés de chacune et chacun.
Or, ce pluralisme se manifestera tôt ou tard par des divergences importantes sur l’étendue et les limites des libertés fondamentales, mais aussi sur les orientations générales de la société dans son ensemble. Par exemple, la liberté d’expression fait débat. Doit-il être permis de représenter, de critiquer ou de se moquer de certains symboles ? Doit-il être permis d’exprimer ses croyances partout, en toutes circonstances ? Ou bien est-il légitime pour le demos d’établir, de façon démocratique, des balises aux libertés individuelles, des normes de citoyenneté qui permettent de faire société au-delà des particularismes ? Les différentes opinions et arguments rationnels sur ces enjeux créent des tensions, parfois très vives, sur l’appréciation du caractère neutre ou équitable des institutions publiques. Comment alors l’État doit-il encadrer l’expression des croyances et des intérêts, tout en demeurant neutre et en permettant des espaces de débat, en entretenant des normes de citoyenneté communes, ainsi que des mécanismes de contestation démocratique ?
DÉMOCRATIE ET LÉGITIMITÉ DES INSTITUTIONS
Quel est donc le critère, dont découleront d’autres exigences particulières, qui donne à l’État et à ses institutions, ainsi qu’à ses représentantes et représentants, leur légitimité ? Pourquoi des personnes qui entretiennent des désaccords, parfois fondamentaux, quant à leurs croyances et leurs intérêts, peuvent-elles accepter que la police, la justice, les procédures législatives, les institutions chargées de l’instruction, et tant d’autres, qui disposent du pouvoir de coercition qui leur est délégué interviennent dans leurs conflits, arbitrent, limitent leurs libertés individuelles et se prononcent en leur nom ? Selon la perspective présentée ici, qui s’appuie sur l’idéal de liberté comme non-domination, la réponse est la mise en place effective, de canaux démocratiques de contestation des normes communes générales et de leurs applications particulières.
Cela dit, la question de la justice sociale et celle de la légitimité politique sont distinctes. Un gouvernement illégitime, ou employant des moyens illégitimes, pourrait instaurer un ordre social correspondant à une conception partagée par une majorité de citoyennes et de citoyens. À l’inverse, un gouvernement légitime, par exemple, pourrait mettre en place des mesures qui orientent la distribution des charges et des bénéfices de la coopération sociale dans une direction qui soit profitable à une minorité de personnes ou, encore, qui soit hostile à l’accueil de migrants, niant à la fois la volonté de plusieurs, mais, aussi, prenant le parti d’une incapacité collective à démocratiser le droit d’avoir des droits. Ces exemples, tout à fait fortuits (sic), servent à démontrer en quoi la question de la légitimité du pouvoir, exécutif en particulier, se pose avec acuité dans nos sociétés. Notamment sous le prisme de mécanismes de contestation libres et transparents qui s’inscrivent dans une recherche d’égalité de droit, a fortiori selon le principe de laïcité, qui se veulent des leviers pour les groupes qui ne sont pas représentés au sein du pouvoir exécutif.
LA DÉMOCRATIE COMME DIALOGUE CONFLICTUEL PERMANENT
La Belgique a une tradition politique de dialogue social, qu’on désigne souvent avec l’expression de « compromis à la belge ». Concrètement, il y a au moins deux dimensions que l’on peut expliciter pour désigner ce que signifie cet élément du langage politique. D’abord, de façon sommaire, la Belgique est divisée en communautés linguistiques (entre autres entités fédérées), qui ont chacune leurs institutions, mais aussi leurs listes de candidates et de candidats lors des élections fédérales. Or, ces communautés ont aussi leurs divisions internes, les fameux piliers historiques, qui ont façonné nombre d’institutions, comme l’éducation, mais aussi les organisations vouées à la contestation, comme les syndicats. Les relations entre les piliers de chaque côté des frontières communautaires sont souvent compliquées. Elles mériteraient une analyse en elles-mêmes. Ensuite, la Belgique se caractérise par son tissu associatif qui entretient, notamment à travers l’éducation permanente (ou du moins devrait), un dialogue critique, avec les institutions politiques… Et qui les financent. En théorie, le modèle belge incarne un dialogue conflictuel permanent, à travers la professionnalisation qui s’opère dans le tissu associatif, permettant de porter la voix de la société civile; mais aussi à travers un système de surveillance mutuelle entre les institutions politiques et les associations civiles.
Ce modèle se veut, selon la perspective présentée ici, une extension du principe de séparation des pouvoirs. D’un côté, la démocratie représentative et, de l’autre, un tissu associatif donnant une voix à la société civile sur les mesures sociales à mettre en place, avec un mandat réflexif sur les orientations politiques, la démocratie, ses institutions et tout autre sujet qui intéresse la matière sociale hétérogène avec laquelle les associations interagissent.
Si l’on résume selon la perspective théorique présentée plus haut, la démocratie ne se résume pas au vote, mais elle se manifeste plutôt par une économie du conflit dans laquelle la représentation des intérêts est organisée à travers une distribution complexe de l’expression des intérêts et des croyances diverses de la population, dans laquelle une myriade d’institutions influence les décisions politiques, mais aussi leurs mises en application concrètes. Mais dans les faits, la Belgique, à son échelle, comme nombres de pays européens et ailleurs, s’éloigne petit à petit de cet idéal démocratique.
L’ÉQUILIBRE DES PUISSANCES : UN DIALOGUE CONFLICTUEL PERMANENT
« [Car] les vices qui rendent nécessaires les institutions sociales sont les mêmes qui en rendent l’abus inévitable… ».[4] Cette citation de Rousseau exprime une problématisation dualiste du problème de la légitimité politique. D’une part, les processus naturels de socialisation créent des normes sociales qui institutionnalisent la loi du plus fort, ce qui rend l’artifice de la loi civile nécessaire, afin de palier au inégalités naturelles, à nos biais cognitifs, à notre égoïsme/opportunisme et de refonder l’ordre social sur un ordre proprement humain, humaniste, rationnel, moral… ce qui était le projet Du Contrat Social. D’autre part, la démocratie est un dialogue conflictuel incessant, sans quoi elle ne peut offrir une quelconque avenue à la corruption de la nature humaine et des institutions. Ce dont Rousseau est sceptique, malgré son obstination à en étayer la possibilité, à la fois philosophique et politique.
C’est dans cette dynamique qu’il faut situer la citation mise en exergue de l’analyse, selon laquelle « plus le gouvernement a de force, plus le Souverain devra se montrer fréquemment ». L’ordre social corrompt l’humain, l’ordre politique, basé sur une éthique humaniste, c’est-à-dire permettant d’instiller de la rationalité, de la morale, de la vertu dans l’organisation sociale, à travers des institutions politiques orientées vers cette finalité, est la seule chance d’échapper à la loi de la nature, à la loi du plus fort. Or, une fois la société civile, artificielle, établie, les mêmes mécanismes de corruption referont surface et viendront renouveler, dans un contexte langagier et institutionnel nouveau, les mêmes périls. C’est là où le gouvernement, l’exécutif, voudra substituer sa volonté à la « volonté générale » du peuple, souverain, en théorie, en démocratie. Mais le scepticisme de Rousseau envers cette possibilité et, surtout, sa pérennité effective, vient d’une compréhension classique du problème de l’action collective et la coopération sociale : « chaque individu peut comme homme [humain] avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu’il a comme Citoyen ».[5]
Donc, pour penser le conflit inhérent à la vie sociale et politique, Rousseau posait déjà, à travers un déconstructivisme avant-gardiste et critique envers l’optimisme des Lumières, les tensions multiples découlant de l’individualisme, des intérêts de classe, de l’opportunisme, de la cohésion sociale, etc. C’est ce qui mène à cette maxime selon laquelle si les citoyens négligent leurs obligations, la société doit les « forcer à être libres ».
En résumé, la question du dialogue social conflictuel permanent émane comme étant la seule possibilité de s’émanciper, à la fois individuellement et collectivement, de la tentation individualiste célébrée par les Lumières, en raison du fait qu’elle renforce la possibilité de miner collectivement, par agrégation, les conditions d’échapper à un ordre arbitraire, pour le dire poliment. Le conflit dialogique entre les ordres de citoyens est donc une nécessité. Cela doit être la finalité des institutions politiques, puisque sa fin, c’est-à-dire l’établissement d’une domination par des intérêts particuliers, signifie un retour à une vie dont les ressorts et les assignations sont dictés par un pur rapport de force, par opposition à un humanisme qui permet de dépasser les assignations et de créer un ordre social où l’Autre est protégé, par le droit, dans son droit d’avoir des droits, même si elle ou il appartient à une corporation d’intérêts ou de croyances différente de la nôtre.
ET CONCRÈTEMENT, AUJOURD’HUI ?
Actuellement, nous assistons, en Europe et ailleurs, à une recrudescence des partis politiques et des discours d’extrême droite.[6] Ces partis sont ouvertement hostiles envers l’UE ses institutions et, plus exactement, envers un équilibre juridique qui institutionalise un « contrat social » entre les États eux-mêmes. Dans la même veine, les mouvements politiques qui s’inscrivent dans cette idéologie affirment vouloir rompre avec le caractère « libéral » de la démocratie, c’est-à-dire le droit, notamment pour les minorités, d’utiliser leurs droits pour faire des choix qui déplaisent aux majorités nationales. Ce détournement de la démocratie se manifeste à travers des décisions politiques qui remettent en question la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaires), mais aussi à travers un refus catégorique de donner voix au chapitre aux minorités, politiques, religieuses, sexuelles ou autres, qui ne sont pas représentées au sein des gouvernements élus. Il s’agit là d’une usurpation pure et simple de la démocratie. Quel que soit le régime de scrutin, le fait d’avoir été élu démocratiquement ne signifie pas le droit d’exercer un pouvoir « absolu ».
Concrètement, le refus idéologique de concevoir la démocratie comme un régime ouvert et de réduire la légitimité politique aux résultats électoraux se traduisent par moins d’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment de la police et des services de renseignement. À titre d’exemple, le droit de manifester, pour contester des décisions politiques ou judiciaires, est mis à mal dans plusieurs régions d’Europe, y compris ici en Belgique.[7] Pour rester dans notre pays, la volonté politique de « donner » une personnalité juridique aux syndicats traduit une volonté de limiter ce droit de façon institutionnelle. Cette modification juridique permettrait, notamment, d’attaquer les syndicats en justice, afin de s’attaquer à leurs ressources financières et, ainsi, limiter leur liberté de choix, leur marge de manœuvre, puisque les cotisations des travailleuses et des travailleurs serviraient à défendre le droit de contester et de défendre leurs intérêts, plutôt qu’à entreprendre de nouvelles actions. Cette « modulation » du dialogue conflictuel représente une attaque contre la possibilité d’une économie de la contestation qui soit conforme au modèle démocratique et laïque que nous étayons, bien que sommairement, dans cette analyse. Les exemples hors Belgique sont aussi nombreux, mais un devoir de vigilance s’impose sur les orientations qui seront prises par le nouveau gouvernement fédéral (par exemple, les frais pour l’acquisition de la citoyenneté belge viennent de grimper de façon drastique, ce qui représente un frein à la démocratisation du droit d’avoir des droits, notamment le droit de vote pour influencer les décisions politiques[8]). Cela s’inscrit dans un contexte où la Belgique a été condamnée à d’innombrables reprises pour le non-respect des conventions européennes et internationales dans lesquelles elle s’était engagée, notamment en matière de droits des migrants et des demandeurs d’asile (Convention de Genève, par exemple).
CONCLUSION
Nous constatons aujourd’hui une tendance lourde dans les pays démocratiques, de subversion de la démocratie, dans toute sa complexité. Cela s’inscrit dans un contexte de changements géopolitiques importants, découlant d’efforts soutenus de la part des régimes autoritaires, de déstabiliser les démocraties. C’est donc d’autant plus inquiétant de voir nos gouvernements céder à ce chantage et, dans une forme de panique, s’attaquer à la démocratie, plutôt que la défendre. Évidemment, en pratique, les choses sont complexes, nuancées et il est difficile de saisir l’ampleur des bouleversements qui s’opèrent sous nos yeux. Cette analyse ne prétend pas non plus y arriver. Notre objectif ici consiste à présenter une conception de la démocratie qui met en avant sa capacité à reproduire des institutions aptes à civiliser les conflits et de démocratiser le droit de contester. Cette grille d’analyse nous offre des outils, dont on peut débattre, mais qui permettent d’évaluer les dynamiques politiques à l’œuvre en Belgique et ailleurs.
Reste maintenant à penser, de manière cohérente avec une conception démocratique et laïque de l’organisation des solidarités, comment préserver nos libertés et affirmer notre capacité collective à démocratiser le droit d’avoir des droits, plutôt qu’à prôner un repli sur soi, traduisant davantage nos misères que nos grandeurs. Bien que le pessimisme de Rousseau soit toujours d’actualité, ne perdons pas un de ses postulats fondamentaux lorsque nous pensons la résistance et la contestation : « Il est très difficile de réduire à l’obéissance celui qui ne cherche point à commander et le politique le plus adroit ne viendrait pas à bout d’assujettir des hommes qui ne voudraient qu’être libres » (Second Discours, II).
[1] https://echoslaiques.info/lhumanisme-comme-rempart-contre-le-complexe-du-pouvoir/
[2] https://www.ledevoir.com/monde/europe/913161/poutinisation-marche-forcee-hongrie-orban
[3] Christian Nadeau. (2003). « Machiavel, domination et liberté politique », Érudit, 30 : 2, p. 321-351.
[4] Jean-Jacques Rousseau. (1754/2008). Dans Rousseau ou la nostalgie de la pureté, Paris : Flammarion, p. 256.
[5] Ibid, p. 353.
[6] INSÉRER ICI LE LIEN VERS LE SITE DU CAL SUR LA CARTOGRAPHIE DES ÉLUS D’EXTRÈME-DROITE EN EUROPE.
[7] https://www.lesoir.be/681938/article/2025-06-16/le-droit-de-manifester-en-belgique-sous-pression-des-jeunes-sont-trop-intimides