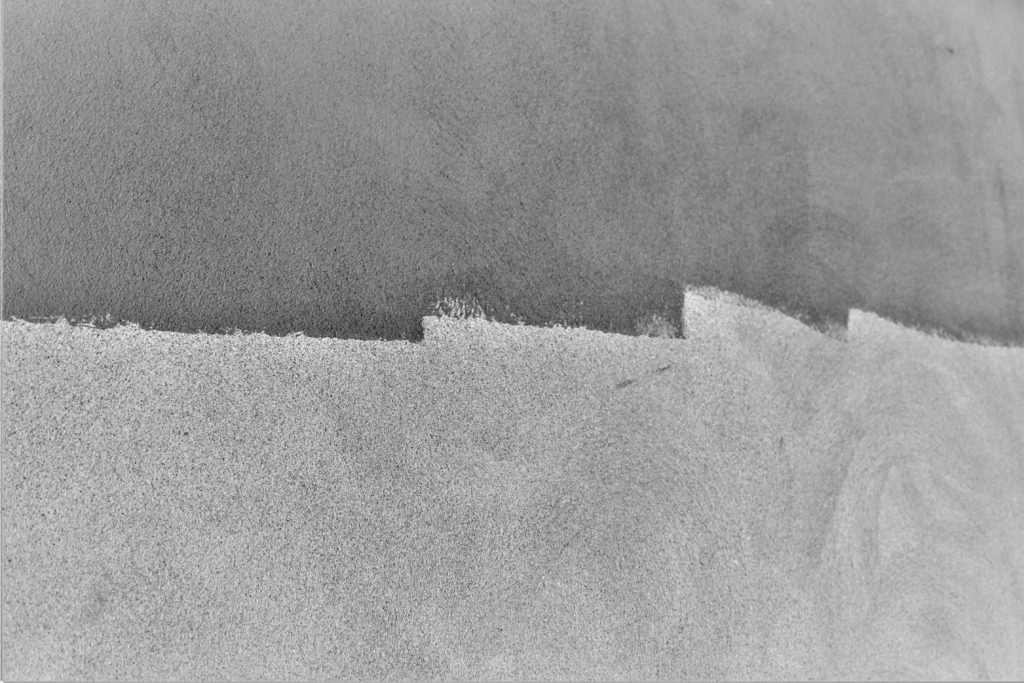C’est au début du XXe siècle que les États-nations commencent à ressentir le besoin d’offrir une meilleure protection sociale aux travailleurs migrants par le biais d’accords de réciprocité entre les pays d’origine et de destination. Il ne s’agit pas tant de mettre en pratique des principes humanistes ou encore moins syndicalistes, mais plutôt de la nécessité de lever certains obstacles à la libre circulation de la force de travail, entendue comme bras, c’est-à-dire comme facteur productif. Si pour une minorité de pays, il s’agit de protéger ses propres travailleurs expatriés, pour d’autres, il s’agit de protéger ses propres entreprises des risques de concurrence déloyale, et sa propre économie de ce que l’on appelle aujourd’hui, plus de cent ans après, le dumping social.
En réalité, des accords de réciprocité existaient déjà entre certains pays à la fin du XIXe siècle, permettant aux migrants d’emporter leurs économies avec eux. Par exemple, de tels accords sont conclus entre la France et la Belgique en 1882 et en 1897. Dans un contexte où l’épargne personnelle peut être assimilée à une sorte d’assurance, le transfert d’épargne entre deux pays est une anticipation intéressante des accords bilatéraux de sécurité sociale qui se développeront au cours du siècle suivant.[1]
Mais le premier véritable accord international visant littéralement à garantir des droits de sécurité sociale réciproques aux travailleurs migrants est signé par la France et l’Italie le 15 avril 1904.[2]
À la table des négociations siègent, pour la France, Arthur Fontaine, premier directeur de l’Office du travail, et, pour l’Italie, Luigi Luzzati, ministre du Trésor dans le gouvernement Giolitti II.[3] Luzzati est préoccupé par le sort réservé aux travailleurs italiens émigrés, dont environ 200 000 sont installés en France où ils sont passés en nombre devant les Belges en 1896. En particulier lorsqu’ils sont victimes d’un accident du travail, car la récente loi française du 9 avril 1898 sur le sujet contient des dispositions discriminatoires relatives aux étrangers. Un projet de loi sur les retraites ouvrières contient lui aussi des dispositions discriminatoires.
MAIS QUELLES COMPENSATIONS DOUANIÈRES !
Pour sa part, A. Fontaine est confronté à un dilemme de réciprocité formelle : étant donné que l’immigration se fait uniquement de l’Italie vers la France, et non l’inverse, quel intérêt la France aurait-elle à signer un accord qui, après tout, ne protège que les pensions d’accident du travail et de retraite des immigrés italiens ?
En contrepartie des avantages accordés aux travailleurs italiens, l’Italie offre des compensations douanières à la France, mais celle-ci ne sait qu’en faire.
Par ailleurs, l’hypothèse d’une éventuelle contrepartie douanière à une clause de protection des travailleurs avait déjà été rejetée par la France, lorsqu’au sein de l’AIPLT[4] un délégué belge avait proposé cet échange, en contrepartie de l’interdiction du travail de nuit des femmes. Lorsque la France avait rejeté cette contrepartie au motif qu’elle était trop moralement contestable, trop complexe à élaborer et trop incertaine dans son équilibre, A. Fontaine avait également fait remarquer que l’effet d’annonce pour les travailleurs aurait été détestable, puisqu’il aurait fait apparaître les traités de travail comme des annexes aux traités de commerce.
Dès lors, A. Fontaine trouve une autre compensation. Il est conclu que l’accord doit permettre à la France de résoudre une fois pour toutes le problème de la concurrence déloyale de son voisin, dont la législation inadéquate et les inspections du travail indulgentes ou inexistantes désavantagent l’industrie française, créant des problèmes pour les exportations. En deux mots, il s’agit, en contrepartie des facilités accordées aux travailleurs italiens, d’engager l’Italie dans le développement de son droit du travail, pour rendre plus facile et moins onéreux aux industriels français le progrès de la législation ouvrière.[5] C’est cela, et non des droits de douane, qui doit selon A. Fontaine apporter des avantages économiques tangibles à l’industrie française.
Il est difficile d’établir si cet accord contribue réellement à faire progresser la législation sociale de l’Italie. Cependant, la chronologie de l’apparition des premiers régimes d’assurance va précisément dans ce sens : en juillet 1904 l’assurance obligatoire contre les accidents du travail pour les mines de soufre en Sicile, en 1907 le premier Fonds national d’invalidité et de vieillesse, en 1910 le Fonds national de la maternité, en 1917 l’assurance contre les accidents du travail pour les ouvriers agricoles, et en 1919 celle pour tous les travailleurs.[6]
Si les premiers accords permettant aux migrants d’apporter leurs économies peuvent être considérés comme des antécédents, cette convention de 1904 entre la France et l’Italie est le premier véritable traité international de sécurité sociale jamais signé dans le monde.
LA CRÉATION DE LA CECA ET DE LA CEE
En 1951, c’est encore la France qui fait pression sur les autres futurs pays de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) pour qu’ils adoptent des mesures salariales comparables aux siennes. Elle estime que, si elles ne sont pas supprimées, les inégalités existantes en termes de protection des travailleurs, par exemple en ce qui concerne les congés payés, l’égalité des sexes et le niveau général des salaires, constitueront un obstacle majeur à l’ensemble du marché commun émergent.
Toutefois, les pays partenaires considèrent que l’harmonisation est prématurée d’un point de vue politique et impossible dans la pratique.[7] Le problème réside dans le fait que l’élimination, ou du moins la réduction, des inégalités sociales réduirait certainement la concurrence industrielle déloyale entre les pays, mais aussi les flux migratoires. Or cela ne profiterait qu’à la France, et certainement pas à l’Italie, qui a besoin d’alléger le fardeau de son chômage de masse, ni aux pays plus lourdement industrialisés, désireux de recevoir des bras. En conséquence, le Traité de Paris du 18 avril 1951 instituant la CECA stipule que les questions salariales doivent rester de la seule responsabilité des États membres et que, sous certaines conditions, la Haute Autorité, organe exécutif de la CECA, peut intervenir en cas de salaires excessivement bas ou de réductions salariales exagérées.
Le problème se pose à nouveau quelques années plus tard, lors des négociations devant mener à la création de la Communauté économique européenne (CEE). Avec les trois autres libertés de circulation (des marchandises, des services et des capitaux), la libre circulation de la main-d’œuvre est destinée à être l’un des piliers du nouveau marché commun. Elle doit faire correspondre l’offre et la demande d’emploi, à travers les frontières internes du nouveau marché unique européen. Dans un entrelacement complexe de politique économique et sociale intérieure et de politique étrangère, la circulation des travailleurs doit progressivement devenir l’élément central du processus d’intégration européenne, dont une des missions est d’incorporer un droit fondamental à la sécurité sociale pour tout travailleur migrant. Dans ce contexte, il apparaît clairement que les différents systèmes nationaux de sécurité sociale, contenant des clauses limitant le droit aux prestations en fonction de la nationalité et de la résidence, risquent de constituer un puissant moyen de dissuasion à la circulation des travailleurs, et donc un obstacle aux principes inscrits dans le futur traité.
Malgré son très faible poids dans les négociations, l’Italie obtient une garantie de libre émigration future à travers les pays membres. Cela convient à ses partenaires, la Belgique et l’Allemagne en tête, qui ne souffrent alors pas de chômage et de pauvreté mais, au contraire, de pénurie de main-d’œuvre. Surtout d’une main-d’œuvre docile et non syndiquée, prête à accepter des conditions que les travailleurs nationaux commencent à rejeter catégoriquement.[8]
HARMONISATION OU COORDINATION ?
Deux approches sont alors envisageables : l’harmonisation ou la coordination. La première consiste à rendre les différents systèmes nationaux de sécurité sociale plus semblables les uns aux autres. La seconde, la coordination, à mettre en place un système qui, tout en respectant les diversités nationales, garantit la transférabilité de (certains) droits de sécurité sociale aux travailleurs en situation de mobilité d’un pays à l’autre. Ajoutons qu’en matière d’harmonisation, les représentants des six pays fondateurs ont deux façons potentielles de progresser. La première est d’établir un système commun de sécurité sociale. L’autre, moins radicale, consiste à donner aux États membres une certaine marge de liberté pour développer leurs systèmes de sécurité sociale, à la condition qu’ils respectent un ensemble de règles communes.
La France reste favorable à l’harmonisation, cette fois encore en raison de la concurrence déloyale résultant des disparités entre les législations sociales nationales. En effet, dans les pays où les mesures de protection sociale sont moins avancées, les entreprises peuvent se targuer de coûts de main-d’œuvre plus faibles, et donc attirer davantage d’investissements étrangers et atteindre des niveaux de compétitivité commerciale plus élevés, par rapport aux pays dont les systèmes de protection sociale sont plus développés. Mais l’Italie bloque les négociations : comme son système de protection sociale est le moins développé, seul un manque d’harmonisation garantira à ses entreprises de continuer à bénéficier de l’avantage concurrentiel d’un coût du travail plus faible par rapport aux pays qui ont déjà mis en place une législation du travail et de la sécurité sociale beaucoup plus avancée, comme la France ou les pays du Benelux.
Dès lors, il est décidé que, en matière de sécurité sociale, l’approche par coordination est plus appropriée que celle par harmonisation, notamment parce qu’elle est plus prudente et plus acceptable politiquement.[9] C’est donc elle qui figure dans le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la CEE. Ce point ne sera plus jamais mis à l’ordre du jour et, aujourd’hui encore, la solution arrêtée à l’époque continue de prévaloir.
L’objectif de la coordination européenne de la sécurité sociale est de faciliter la libre circulation des personnes afin d’éviter une perte des droits lors des migrations intra-européennes (UE, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et assurer une forme de continuité de la protection sociale lorsque ces personnes passent d’une législation nationale à une autre. Afin de mettre en œuvre la libre circulation, des règlements de coordination ont été établis dès 1959 et ont été continuellement mis à jour jusqu’à nos jours.[10]
LE DUMPING SOCIAL À L’HEURE ACTUELLE
Depuis lors, les régimes de sécurité sociale ont pu varier considérablement d’un État membre à l’autre et les dispositions européennes n’ont eu que très peu de pouvoir de les harmoniser. Cette harmonisation est bien évoquée dans tel ou tel pays, mais toujours à la baisse, sous prétexte de s’aligner sur le coût du travail de ses voisins pour améliorer sa compétitivité.
Le phénomène qu’on qualifie aujourd’hui de dumping social se résume à quelques chiffres. Si l’investissement public dans la protection sociale, mesuré bien entendu en parité de pouvoir d’achat, est par exemple de 15 600 € par habitant au Luxembourg et de 10 600 € en Belgique, celui-ci ne dépasse pas le seuil de 3 500 € en Roumanie et Bulgarie.
Le revers de ce dumping social représente une menace majeure pour les travailleurs, car il sape leurs droits de manière fondamentale. Pour s’en tenir aux mêmes pays, le salaire minimum légal, qui est aujourd’hui de 2 200 € au Luxembourg et de 1 600 € en Belgique, est de 400 € à peine en Roumanie, et de 330 € en Bulgarie. Pour ne pas parler des pays, comme l’Italie, où cette protection légale des salaires n’existe même pas. Il en résulte que l’Europe de la libre circulation des travailleurs est encore inachevée et ne pourra exister pleinement que lorsqu’elle disposera d’une sécurité sociale unifiée et, plus généralement, de normes sociales équivalentes partout. La liberté de migration, en d’autres termes, ne sera véritablement réalisée que lorsque la mobilité des personnes cessera d’avoir un effet direct sur la rentabilité du capital.
[1] Simon Roberts, « Bref historique de la coordination de la sécurité sociale ». Commission européenne, 50 ans de coordination de la sécurité sociale. Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2010, p. 14.
[2] Convention conclue à Rome le 15 avril 1904 entre la France et l’Italie, en vue d’assurer des garanties à la personne du travailleur.
[3] Michel Cointepas, « L’entrée de la direction du travail dans les relations internationales à travers la naissance du droit international du travail », Comité d’histoire des administrations chargées du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (CHATEFP), Cahiers du CHATEFP, n° 7, 2007, p. 61-80.
[4] Association internationale pour la protection légale des travailleurs. Il est, en quelque sorte, le précurseur de l’actuel Bureau international du travail.
[5] Artur Fontaine, Exposé de la convention franco-italienne relative au travail et à la prévoyance sociale, Association internationale pour la protection légale des travailleurs (AIPLT), 1904.
[6] Romeo Vuoli, Sulle origini delle assicurazioni sociali, Rome, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, 1935.
[7] P. Watson, Loi sur la sécurité sociale des Communautés européennes, Londres, Mansell, 1980.
[8] A. Morelli, « L’appel à la main d’œuvre italienne pour les charbonnages et sa prise en charge à son arrivée en Belgique dans l’immédiat après-guerre », Revue belge d’histoire contemporaine, volume 19, n° 1-2, 1988, p. 83-130.
[9] John Holloway, Social Policy Harmonisation in the European Community, Farnborough, Gower, 1981.
[10] Pour en savoir plus : Carlo Caldarini, Les effets de l’emploi atypique sur la protection sociale des travailleurs migrants, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2021.