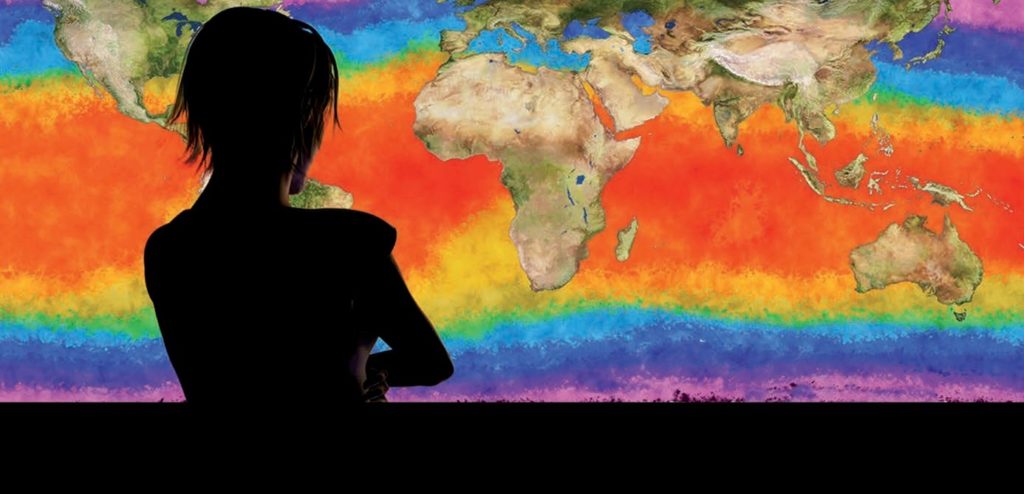Quels effets ont les nouvelles formes de gestion sur les employés du secteur privé ? Combinées au climat de crise et à l’impression d’urgence qu’elles injectent dans la réalité économique, ces politiques et stratégies de management semblent exercer des pressions de plus en plus fortes sur les individus. Entre la nécessité de survivre dans un environnement déshumanisé et le manque de clarté dans les objectifs des sociétés, les employés semblent fragilisés. Pour essayer de saisir les effets de cette pressurisation quotidienne, nous avons recueilli le témoignage d’une cadre dans le département marketing d’une multinationale. X[1] travaille pour cette société depuis plus de six ans et est en charge de gros projets ayant un impact sur le chiffre d’affaires et sur l’image de la société. Elle a quarante-trois ans, deux enfants et elle détient deux masters.
Tout a commencé avec une charge de travail qui était de plus en plus conséquente et continuelle tout au long de l’année. C’est-à-dire que, par le passé, nous étions confrontés à quatre ou cinq moments importants pendant l’année, qui exigeaient une charge de travail et un investissement personnel très importants. Ceux-ci alternaient avec des périodes beaucoup plus zen, qu’aux horaires de travail normaux.[2]
Mais, depuis les deux dernières années, suite à des changements au niveau stratégique de la société, accompagnés de changements de politique interne, nous avons été confrontés à un turn-over accru du personnel, à la mise en concurrence entre les collègues et au manque de transparence par rapport aux responsabilités et à la prise de responsabilités individuelles. Dans un tel climat, la communication entre départements semblait poser de sérieux problèmes.
À partir du moment où la crise s’est fait ressentir clairement chez nous, on a eu l’impression d’être confrontés à une frilosité grandissante par rapport à la prise des décisions et aux choix d’investissements. Les plans d’action et les objectifs à atteindre étaient de moins en moins clairs. Cette situation a entraîné la multiplication de demandes de la part du management dans le sens de plus d’analyses, de plus de documents administratifs, de plus d’exigences pour suivre des procédures qui changeaient tous les deux ou trois mois car ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord, du dédoublement des réunions et des présentations… Toutes ces sollicitations ont fait que, à un certain moment, nous n’avions plus de phases de travail plus calmes sur l’année et nous étions confrontés à une surcharge permanente de travail et de stress.
Nous n’avions plus aucun moment de répit, ni pour nous-mêmes ni pour communiquer avec les collègues. J’en suis arrivée à travailler soixante heures par semaine toutes les semaines pendant plus d’un an et demi. Soixante heures par semaine, cela signifie renoncer aux soirées entre amis, aux activités sportives. Il y avait toujours une raison pour prolonger le travail : un mail, par exemple, qui arrive à seize heures et qui demande quelque chose pour neuf heures le lendemain (pour finalement s’apercevoir que cela pouvait attendre).
Le rythme de travail exigeait que nous mettions en place des alarmes afin que nous n’oubliions pas de rentrer le soir. Tout cela avec une vie de famille pour chacun d’entre nous. Cependant, cela n’était pas, pour moi, la partie la plus compliquée.
Avec cette nouvelle politique interne, le personnel a été de plus en plus mis en compétition. C’était à un tel point que tous les mois, un peu à l’américaine, nous étions mis devant une assemblée de soixante personnes au cours de laquelle on décernait les bravos à ceux qui avaient réussi. Quant à ceux qui n’avaient pas atteint leurs objectifs, ils étaient appelés dans le bureau de la direction. Pourtant, il était difficile de savoir ce qu’ils attendaient de nous car il n’y avait pas de transparence sur les objectifs ou les moyens pour les atteindre.
Dans un tel contexte de compétition, la communication devient impossible : les gens ne se parlent plus, ils se méfient l’un de l’autre et la confiance n’est plus présente. On se bat pour sa place. On a l’impression d’être jugé à chaque moment.
De ce fait, pendant six mois, j’ai dormi au maximum trois heures par nuit. Les nuits difficiles s’enchaînaient. J’allais au lit en me disant “ce n’est pas grave ! Je prends un bloc-notes à côté de moi et je note les trucs que je ne dois pas oublier de faire le lendemain”. Pour finir, je me rendais compte que, après deux heures de prises de notes – dans le noir d’abord et puis à l’aide d’une lampe de chevet – il valait mieux se lever pour aller devant le PC. Donc, si l’on ajoute ces nuits très courtes aux soixante heures par semaine, au sommeil perturbé par le fait que l’on ressasse tout, dû au stress de tout ce qu’il y a à réussir... C’est l’image de l’élastique sur lequel on tire trop et qui finit par lâcher.
Et malgré cette pression sur ma santé et mon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, je trouvais le moyen de tenir le coup.
LA GOUTTE QUI A FAIT DÉBORDER LE VASE… ET DES MESURES URGENTES À PRENDRE
Dans certaines réunions, ils me demandaient de prendre toute la responsabilité sur mes épaules, d’aller faire un show et, quelque part, de camoufler des choses qui n’étaient pas en accord avec les décisions communiquées à un autre niveau (international). A partir du moment où j’ai commencé à ressentir que l’on attendait de moi de mentir, c’en était trop. C’est cela qui a tout déclenché. Après des mois de fatigue, de relations tendues en permanence avec certains collègues, on attendait de moi de ne plus être en accord avec moi-même : un soir, je me suis retrouvée perdue, vidée, tout à fait déconnectée du temps présent avec comme seule solution la prise en charge médicale.
Dans ces conditions, il y a urgence à définir les objectifs à atteindre et les moyens pour y arriver. Avoir un minimum de transparence, quels que soient les niveaux de la société, quelles que soient les personnes, pour que chacun sache exactement ce qui est attendu de lui.
Ensuite, il est important de retrouver une responsabilité face à cette situation : actuellement, personne n’ose en parler.
Nous sommes dans une société qui a oublié que l’humain devrait passer avant le business. Il faut des règles du jeu. Il faut qu’il y ait de l’humanité pour que les gens soient heureux. Si on est là simplement pour atteindre un chiffre et qu’on attend de nous d’être prêts à faire n’importe quoi, cela n’a plus aucun sens.
Or, les solutions qui sont mises en place sont complètement insuffisantes et non adaptées. Je les appelle l’humain artificiel. Il s’agit des team building, des coaching individuels et collectifs, des séminaires…
Même les temps d’échanges informels commencent à être cadrés et pris en charge par l’entreprise. Comme ça, au lieu de nos pauses-café d’antan, des “rencontres informelles” d’entreprise ont été mises en place, en principe pour discuter des thèmes variés, n’ayant rien à voir avec le travail… Le problème, c’est qu’au bout de quelque temps, ils ont été utilisés comme un moyen pour faire passer des communications de la direction des ressources humaines.
Il ne nous reste plus rien d’humain.
[1] Elle est actuellement en arrêt-maladie due à un diagnostic de burn-out et a accepté de témoigner pour Bruxelles Laïque Échos de manière anonyme.
[2] Pour X, un horaire de travail considéré normal équivaut à 40 – 45 h/semaine.