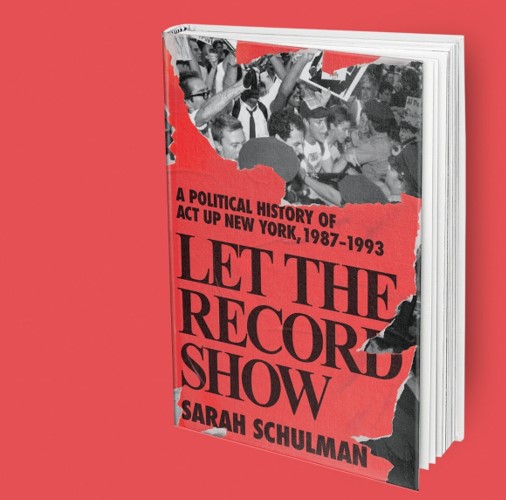Autrice: Sophie Montévrin
Comment aborder un phénomène aussi massif, aussi présent dans nos vies que les « réseaux sociaux » ? Si le choix de Sophie Montévrin est d’alerter sur l’influence toxique, le contenu de l’ouvrage est moins anxiogène que son titre. S’attachant à ne pas verser dans la condamnation pure et simple, elle cherche à mettre en lumière les ressorts individuels et collectifs qui rendent ces réseaux à la fois attirants et problématiques. Dans un style fluide, accessible et pédagogique, avec un propos centré sur les jeunes personnes, leurs besoins de reconnaissance et leur envie de distinction, l’autrice s’adresse – à notre sens – aux adolescents désireux d’une approche réflexive sur le sujet, aux parents curieux ou au personnel éducatif en général.
Organisé en 3 grandes parties, le livre couvre les dimensions les plus visibles des réseaux sociaux : la place dans nos vies, ce que cela dit de nous, et les risques liés à leur utilisation. S’il est toujours attentif à ne pas tomber dans la culpabilisation, l’ouvrage est cependant sur une ligne éditoriale à tout le moins inquiète : « le fait de surfer sur les réseaux sociaux, et sur le Web en général, est extrêmement chronophage. La tentation est grande de voguer d’une publication à l’autre, et le temps file. Il faut aussi sélectionner, trier, car la masse d’information est colossale. Charge mentale, nous voilà ! »[1]
Consciente des apports en matières de désenclavement, considérant les réseaux sociaux comme tout autre moyen investi par les adolescents, mais pas seulement !, pour leur construction identitaire, l’autrice prend en compte l’importance du lien : celui qui est tissé et maintenu, celui qui élargi le monde social, qui construit une communauté. A cette réalité, son propos est de mettre en avant les faces sombres de tels réseaux, ses paradoxes, les pièges à éviter, bref mettre des bémols sur la partition jugée trop lisse de l’utopie du « village planétaire ». Ainsi, à la suite d’un développement concernant le mouvement des Gilets Jaunes, de leur passage du virtuel à la rue, l’autrice reprend le fil de la question de la reconnaissance, au final très peu collective : « Même si Facebook permet de rallier des communautés, […] il ne peut réunir ou rassembler que pour un temps et selon des modalités précises. Car on ne peut faire fi de la différence trop longtemps, elle apparait forcément à un moment ou à un autre ! »
A la consommation d’information, souvent excessive, qu’il nous est complexe de traiter, se créer des manques. L’autrice rend compte de comportement particulièrement éclairant à ce sujet. Au désormais répandu FOMO (de l’anglais « Fear of missing out ») renvoyant à la peur de manquer (quelque chose), qui s’applique à la peur de manquer un message ou une notification, s’adjoint désormais le JOMO (« Joy of missing out »), le plaisir de manquer quelque chose. Et l’autrice de révéler le pot-aux-roses : cette revendication du lâcher-prise, créer de nouvelles distinctions numériques. De la simple « pause » (par exemple : « fini twitter pour moi ce soir, au dodo ») au luxe de la déconnection affichée comme comportement valorisé (Imaginons n’importe quel « influenceur » prendre des vacances), ce comportement reste, à suivre l’autrice, en réalité confiné dans le même cadre que son supposé comportement inverse.
Cette Geek Connection comme Montévrin l’appelle, se lit également dans sa description comme d’une part, une échappée du réel (sortir des tracas quotidiens), et d’autre part, l’image que l’on renvoie sur les réseaux (cela a à voir, selon l’autrice, avec la « réparation narcissique », et le fait de se sentir utile ou important). De même, insiste-t-elle, la mise en scène de l’image compte pour beaucoup. Le livre prend alors une tournure plus psychologique, au sens où, se retrouvent analysés les phénomènes de comportements individuels (par exemple, le fait de prendre en photo son plat servi au restaurant pour le mettre sur Instagram, ou les selfies). Les comportements associés à Facebook entretiendraient « la régression infantile ». Pour Sophie Montévrin, citant Michaël Stora, psychologue et psychanalyste spécialiste des addictions liées au monde numérique, « Facebook exacerbe l’aspect ‘’transparence’’ en refusant les faux profils […], et favorise par là même, et paradoxalement, le culte de l’image, d’un ‘’faux soi’’, c’est-à-dire une identité fictive, fantasmée. »[2]
Le livre poursuit enfin en mettant en garde contre les effets pervers des réseaux sociaux, notamment ce qui pousse au renforcement narcissique (lié, selon l’autrice, à une fragilité, un besoin de se valoriser). Cela peut prendre la forme de phénomènes telle que l’affaire de la « Ligue du LOL », du nom de ce groupe essentiellement masculin, lié au monde du journalisme, et cyber-harcelant de nombreuses victimes pendant des années. Groupe qui fut « guidé par leur besoin de faire corps (principe de la notion de communauté), par leur désir de réussir dans le milieu (principe de l’acceptation et de la reconnaissance sociales par leurs pairs), par leur envie de briller (principe de la valorisation et de l’affirmation narcissique), ils ont ignoré le principe de responsabilité et celui du respect de l’autre […] ».[3] Les réseaux sociaux, on le voit, il vaut mieux ne pas y foncer tête baissée et inconscient des risques.
Cela nous amène à notre conclusion. Dans le champ de mines décrit par Sophie Montévrin que sont les réseaux sociaux, mettons brièvement l’accent sur deux attentions particulières : (1) d’une part l’apprentissage pédagogique lié au fonctionnement des algorithmes. (2) D’autre part, une redécouverte du « monde réel » : « avant et après Facebook, Twitter, ou Instagram, il y a la vie, la vraie ! »[4]
(1) Apprendre à se servir des réseaux sociaux est lié à deux
écueils : d’un côté, « l’algorithme
va évaluer et sélectionner les publications qui les plus susceptibles de nous
intéresser »[5],
d’un autre côté, cela n’empêche pas de nous retrouver un jour victime (ou
bourreau), de cyber-harcèlement. Outre l’uniformisation, s’y ajoute un rapport
au temps infernal ou les problème d’attention[6].
Faut-il cependant faire porter l’entière responsabilité sur les réseaux
sociaux ? Disons les choses ainsi : se créer une « bulle »
n’est pas nécessairement négatif pour se protéger de certains indésirables… et
ne remet pas en compte la question de la contradiction. En effet, notre bulle peut
très bien être un espace qui intègre des personnes aux avis divergents. Cet
apprentissage-là est bien plus général que celui ayant trait aux réseaux
sociaux. Autrement dit, la critique des « bulles » ne devrait pas se
confondre avec le fait de laisser à Facebook et ses algorithmes le soin d’être
notre pourvoyeur de contradictions. De fait, quel sens cela a de faire, d’une
main la critique des réseaux sociaux, et d’une autre vouloir leur laisser les
clés, au nom de la contradiction, de la diversité des publications ?
(2) Enfin, le livre insiste beaucoup sur la construction de soi, de l’image que l’on renvoie. Les effets pervers que l’ouvrage décrypte se sont récemment retrouvés dans l’actualité. En France, une jeune femme, étudiante précaire, est interviewée par une chaine de télévision pour témoigner de la difficulté de ses conditions. Sujet qui enflamma les réseaux sociaux, puisqu’un étudiant s’immola quelques jours auparavant, mettant en cause les difficultés économiques structurelles. Cette jeune femme fut prise à parti sur les réseaux sociaux en raison de photo de vacances publiées sur son compte Instagram. Pour certains, cela remettait en cause son témoignage, sa probité de précaire. Comme le rappelle le sociologue Denis Colombi « contrairement à ce que l’on peut s’imaginer, lorsque l’on tombe dans la pauvreté, on n’abandonne pas les consommations « inutiles » […] simplement parce que ceux-ci permettent de tenir le coup face aux privations ou de résister au stigmate de la misère… »[7] Sophie Montévrin évoque une forme de duperie que chacun partagerait en conscience : « mais bien entendu, tout cela n’est qu’une mascarade. Et chacun le sait. Mais il est plus confortable de montrer des signes extérieurs de richesses d’existence que de se confronter à l’inanité des moments creux et fades, qui paraissent d’autant plus creux et fades face au déferlement d’images positives sur les réseaux ». Notons que l’existentiel ne tient pas tout entier dans le « réel », « la vraie vie », et que le creux et le fade n’est pas qu’une condition humaine abstraite, mais quelque fois la conséquence de politiques économiques. Dès lors, le refuge vers les réseaux sociaux est aussi, paradoxalement, une manière de ne pas tomber dans une plus grande misère existentielle.
Notre objet n’est pas ici de trancher entre la toxicité des
réseaux sociaux ou leur potentiel d’émancipation. Ils sont l’un et
l’autre : le cyber-harcèlement ou l’addiction n’invalide pas leur apport
en matière de prise de conscience internationale, de contact entre pairs, de
potentiel de mobilisation, etc. Mais ce livre nous rappelle, avec des exemples
très concrets, que parler de « réseau social », c’est avant tout
évoquer un dispositif technique qui fonctionne selon des règles (changeantes),
et qui a des conséquences. Une prise de conscience ne peut cependant pas se
limiter à sonner l’alarme. L’éducation des plus jeunes, notamment, ne passe pas
exclusivement par le maintien d’une crainte à l’égard de réseaux sociaux. Cette
éducation pourrait alors comporter un volet lié à l’alphabétisation numérique,
et partant, envisager dans une relation plus apaisée avec la culture des
réseaux sociaux.
[1] p.15.
[2] p.83.
[3] p.97.
[4] p.121.
[5] p.101.
[6] Juliette Chemillier, « Les nouvelles servitudes », La Vie des idées, 26 février 2020. http://www.laviedesidees.fr/Bernard-E-Harcourt-Societe-exposition-Desir-desobeissance-ere-numerique.html
[7] Denis Colombi, Comment peut-on être pauvre, AOC, 13.01.2020 https://aoc.media/analyse/2020/01/12/comment-peut-on-etre-pauvre/