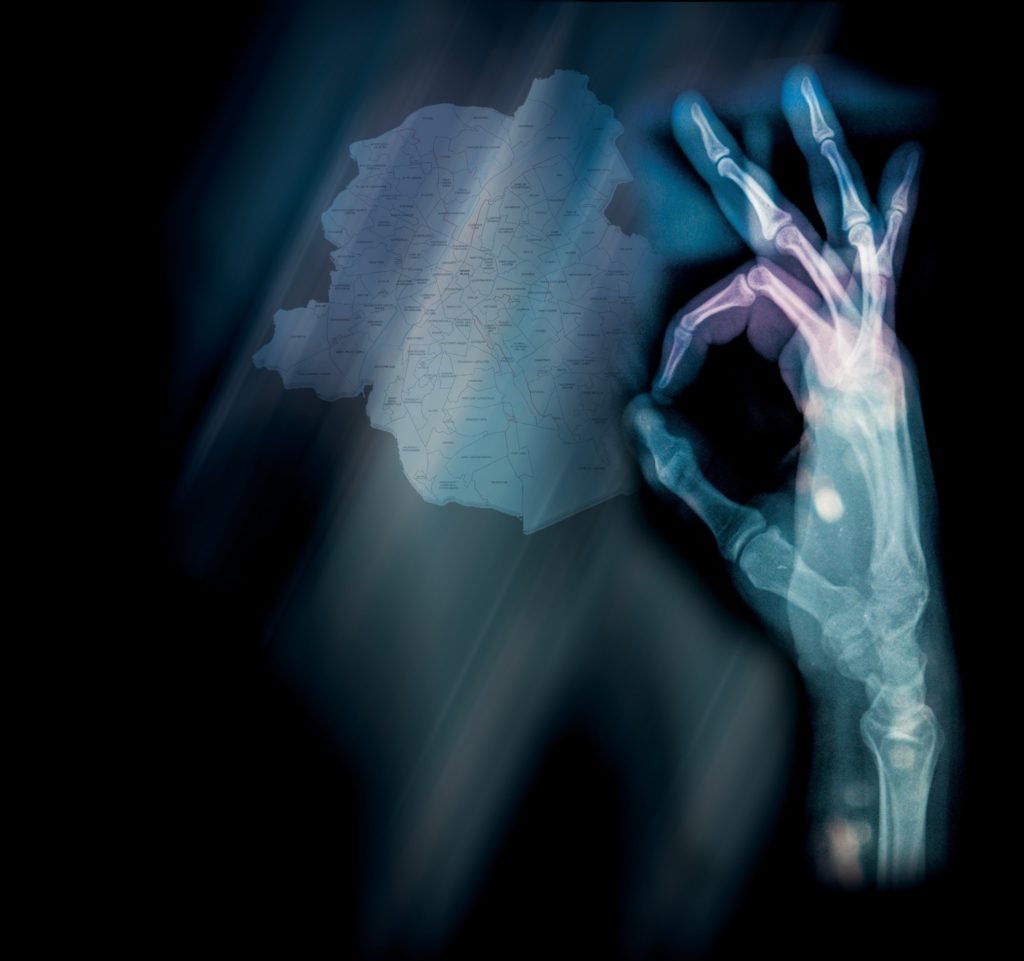Dans cet article, nous allons tenter de poursuivre l’approche réflexive ayant animé certains promoteurs du rationalisme du début du 20e siècle en explorant la déviation antisémite de « l’esprit critique » émergeant au sein même de la modernité européenne.
De l’Union Rationaliste à la zététique
À travers l’exploration de différentes émanations institutionnelles « rationalistes », nous allons parcourir le 20e siècle en mettant l’accent sur une dérive intellectuelle qui l’a accompagné.
Dans son ouvrage Militer pour la science. Les mouvements rationalistes en France (1930-2005)[1], le sociologue Sylvain Laurens rend compte avec une approche socio-historique du parcours de l’Union Rationaliste, association pluraliste fondée en 1930 pour la science et par des scientifiques. Donnons en quelques moments clés pour comprendre comment un mot, une idée — « le rationalisme » — peut se moduler au cours du temps, en fonction des contextes, des personnes qui s’en emparent. Au début de l’Union, d’intenses débats s’y déroulent concernant la défiance du grand public envers le progrès et les techniques, décriés après la Première Guerre mondiale. Il s’agit, pour les scientifiques composant l’organisation, de mettre en avant la posture promouvant l’indépendance de la recherche vis-à-vis de la religion et de l’État, d’accompagner le mouvement social et syndical, de sympathiser avec les soutiens de Dreyfus, de mettre la science hors des mains des partis politiques et d’investir l’espace public. La réflexion concernant la responsabilité des savants vis-à-vis de leurs œuvres est primordiale dans leur démarche d’éducation populaire. Il s’agit de faire usage de « l’esprit critique » prenant comme objet d’analyse « la recherche » et « la science ».
Des années plus tard, après avoir dû faire face à son instrumentalisation politique durant la Guerre froide, l’Union Rationaliste apparait radicalement transformée. Chemin faisant, elle a délaissé son « épistémologie[2] engagée », sa conviction que les sciences doivent être mises au service d’un projet humaniste de progrès social et d’émancipation collective, pour se consacrer à la critique des croyances ésotériques et populaires. Dans les années 1970, elle n’aborde donc plus les discussions internes liées à la production du savoir et ses usages, mais se focalise sur la critique de ce qu’elle désigne comme des « pseudosciences ».
Cette démarche met le pied à l’étrier de ce que l’on appelle désormais la zététique, qui prend son envol dans les années 1990. Cet « art du doute » radicalise la dimension ludique et individuelle de la pensée critique, vise à contredire les charlatans, déconstruire les phénomènes paranormaux, et corriger nos « biais cognitifs ». Cette mue contemporaine de l’esprit critique rationaliste n’est pas toujours vue d’un bon œil : on peut lire dans la revue Zilsel une désapprobation sévère de la démarche. Y est notamment reproché le fait que « toute la dimension collective du travail de véridiction scientifique s’en trouve évacuée. La zététique prétend […] transposer la méthode scientifique à l’échelle de l’individu comme mode d’appréhension de son environnement quotidien, le doute méthodique et l’exercice du raisonnement étant supposés lui permettre de réfuter des croyances par leur seul exercice ». [3]
Quand l’art du doute se frotte au négationnisme
Revenons rapidement sur la face sombre de ce produit d’autodéfense intellectuelle, non pour l’enfermer dans ses dérives, mais pour donner à penser à partir d’un angle socio-historique particulier. Le Cercle zététique (1993), et les Cahiers zététiques sont fondés par le militant royaliste d’extrême droite Paul-Eric Blanrue. Henri Broch, le fondateur historique du mouvement zététique qu’il lança en 1986 via le service minitel 3615ZET, en est président d’honneur. La pratique du doute de Blanrue, ainsi que ses positions politiques, se radicalisent par la suite. Il devient négationniste et antisémite. Ce qui conduit à une scission de l’association, des membres désavouant, sans ambiguïtés, Blanrue. Ces derniers fondent en 2003 l’Observatoire Zététique (à ne pas confondre, donc). De son côté, Blanrue radicalise encore le Cercle Zététique, devenu groupusculaire. Cette radicalisation s’observe notamment par la diffusion de thèses complotistes ou encore par la défense et la promotion de Robert Faurisson, négationniste tristement célèbre. Il poursuit ensuite sa carrière de polémiste en fréquentant Dieudonné et Alain Soral. Certains de ses propos rejoignent ceux de Faurisson, notamment lorsqu’il qualifie « la question des chambres à gaz et du génocide juif de cœur de la nouvelle religion mondiale ».[4]
La pensée rationaliste ne s’est pas limitée à ces institutions. Existe — entre autres — depuis 1968 l’Association française pour l’information scientifique (AFIS), fondée par Michel Rouzé, journaliste scientifique, et qui s’inscrit dans une veine grand public. Si sa ligne éditoriale est fluctuante au cours du temps, l’association prend essentiellement la défense du développement technologique et industriel contre l’« ésotérisme ». De 2001 à 2006, c’est Jean Bricmont qui en est le Président du conseil d’administration, avant d’en devenir le président d’honneur. Physicien et essayiste belge, acteur du milieu rationaliste, il suscite lui aussi la controverse. Proche de Blanrue et de ses combats, notamment en 2010, lorsqu’il milite en faveur des pétitions contre la Loi Gayssot — qui condamne la promotion du négationniste. Pétitions écrites en soutien au militant néonazi Vincent Reynouard, condamné au titre de cette loi.
Bricmont s’est fait par ailleurs connaître avec le pamphlet Les impostures Intellectuelles (1997), en duo avec Alan Sokal. Un livre au contenu disparate, dont le succès repose sur la critique de divers auteurs dits « post-modernes », et procède de la volonté de lutter contre ces « usurpateurs ». Et il est vrai qu’au-delà de l’entretien d’une polémique, quelques citations proposées interpellent quant à la légitimité de l’usage des mathématiques, par exemple, en philosophie. Comme le note le philosophe Pierre Macherey, auteur d’une fine mais radicale analyse critique de l’ouvrage, si quelque chose doit sortir de cet échange conflictuel, c’est qu’elle permet une meilleure connaissance de la philosophie en train de se faire.[5] Il est plus rarement signalé qu’en miroir de leur critique, ils y développent leur propre conception de la science. Leur critique tourne autour d’un laxisme intellectuel qui viderait la science de son effectivité, qu’ils définissent par l’idée d’un sens commun de la raison scientifique qui se traduit par une vérité générale. Celle-ci préexisterait à la connaissance, que l’on doit dès lors vérifier. Certes, il ne rentre pas dans les prérogatives de cet article de s’attacher à décrire toute la diversité des approches épistémologiques. Il nous importe simplement de noter le caractère minimal, autoréférentiel (pour eux, les faits attestent de la connaissance, celle-ci ne peut être contrôlée par l’expérience) volontairement restreint de leur conception de la science, apparentée à un sens commun, et répétée tel un credo.
Plus grave, faisant suite à une obsession désormais notoire à l’encontre des « sionistes »[6], et en échos aux propos tenus par Blanrue, le physicien réagit en 2018 au décès de Faurisson en qualifiant les « “négationnistes” d’“athées de [la] religion de l’holocauste” ». La voie qu’emprunte Jean Bricmont ne fait bien entendu pas l’unanimité chez tous les libres-penseurs et promoteurs du rationalisme. Le vidéaste Tzitzimitl, créateur de la chaîne YouTube « Esprit Critique » a cependant éprouvé le besoin de clarification.[7] L’auteur s’attarde sur un passage où Bricmont met en scène son approche modeste, de sens commun, du questionnement des faits : « Est-ce que c’est antisémite de se poser la question, de comment se fait-il, qu’une personne, peut-être parfaitement neutre, etc., d’origine juive, prend seule la décision d’annuler le spectacle de Dieudonné hier au Conseil d’État ? […] » La réponse est brève : oui, c’est antisémite. À l’encontre de la démarche critique, le physicien laisse entièrement place à une puissance explicative, à la rhétorique de l’évidence : le fait atteste de la connaissance. Et ce, sous la forme d’une (fausse) question. Cela s’apparente à une extension sans limites du soupçon, à de la démagogie : « Il s’agit de mobiliser la complicité du lecteur en prétendant recourir à sa propre sagacité, tout en flattant en réalité son ressentiment ».[8]
Drumont, l’antisémitisme et la raison sociologique
Remontons quelques décennies en arrière afin de mettre en lumière l’ambivalence au cœur même de la Modernité. Au tournant du 19e et du 20e siècle, un bouillonnement intellectuel se fait jour, dont les apports sont encore considérables aujourd’hui. Édouard Drumont, essayiste et journaliste, est un homme de cette époque. Il se fait connaitre avec le livre antisémite La France juive (1886), et est également fondateur du journal La Libre Parole, antidreyfusard et nationaliste. Personnage au public fidèle et mondain, mais se targuant d’amitiés prolétaires et socialistes, il s’appuie sur un « savoir social » pour justifier sa vision antisémite du monde. Comme nombre de ses coreligionnaires doctrinaires de l’antisémitisme, il cherche, à partir d’une « Vérité en exil », à alerter son lectorat sur la destruction d’un mode de vie authentique, et de le faire revenir dans le giron de la Raison.[9] Prenant appui sur des démonstrations en apparence positivistes, c’est-à-dire mettant les connaissances à l’épreuve des faits, Drumont construit un antisémitisme moderne. Celui-ci recouvre l’obsession racialiste d’essence biologique par la fonction sociale et la destinée historique. Son exercice de totalisation du monde social séduit un large public, sensible à sa parole crépusculaire où Rothschild, la juiverie, les israélites, les cosmopolites, sont la cause de la décadence de la France.
La Modernité, et son exigence de rigueur n’ont pas été un frein pour le développement de ces constructions intellectuelles. Une forme absolutiste de la liberté prise dans l’élan de la sécularisation de la société, ainsi que les nouveaux modes de productions et de légitimation des connaissances, aura transmis « à la pensée conspirationniste des ressources rhétoriques et procédurales qui garantissent encore son succès […]».[10] Pour le dire autrement, la pensée complotiste de Drumont « tire une grande partie de son efficacité sociale du fait qu’elle habille son message judéophobe d’une rhétorique scientifique sans laquelle elle pourrait difficilement être audible à l’âge de la Science. Elle permet au pamphlétaire de rationaliser en apparence sa haine antijuive ».[11] L’historien des religions Emmanuel Kreis appuie un versant plus matérialiste : « L’antisémitisme est un produit de la modernité, ce n’est pas un discours archaïque d’un autre âge. Il s’est développé à la fin du XIXe siècle en partie grâce aux progrès des moyens de communication, presse et chemin de fer ».[12] Pour autant, cette rhétorique de la scientificité se double de pouvoirs attribués traditionnellement aux prophètes archaïques. L’entrepreneur du dévoilement joue sur l’imaginaire de l’angoisse, révélant des vils soubassements et mécanismes obscurs à une population qu’il s’agit de réveiller, en attisant leur ressentiment. Drumont est par ailleurs fier d’être mis en marge de la science officielle de son époque. L’antisémitisme a peut-être du succès, mais, regrette Drumont, ce n’est pas une doctrine instituée, et des résistances se mettent en place. Il tire bénéfice de sa position par la forme persuasive de son discours : « Il tire sa légitimité du fait qu’il est illégitime ».[13]
D’où vient cette forme moderne d’antisémitisme ? Bruno Karsenti, chercheur en sciences sociales, propose une lecture stimulante.[14] La Modernité, et le 19e siècle en particulier, voit les États se reconfigurer et absorber les différentes « nations » les composant. Il est donc exigé des juifs — l’étranger par excellence — de renoncer à leur organisation traditionnelle pour intégrer ce projet moderne. Le succès est tel que cela a soulevé des soupçons : comment un peuple ayant été si longtemps hors de l’histoire générale peut-il participer si aisément à la vie sociale moderne ? « Le problème juif » moderne s’écrit là. Pour des gens comme Drumont, en réalité un sous-groupe se reconstitue, les aide et les avantage. « Ils » ne jouent pas le jeu libéral de l’émancipation individuelle, mais font des réseaux invisibles, ne sont pas dignes de confiance. Naturellement, les francs-maçons sont dans le viseur également. Karsenti, avec un brin de provocation assumée, fait de ces antisémites des proto-sociologues (ce dont se targuait par ailleurs Drumont). En somme, nous dit-il, ce n’est pas une coïncidence si la structure de raisonnement sociologique comme discipline, et l’antisémitisme moderne naissent dans ces années-là. Il y a dans la société une volonté de comprendre les groupes qui la composent, et donc le besoin d’une autre théorie de l’émancipation que celle de la philosophie politique libérale axée uniquement sur l’État et les individus. De là à faire de la déviation antisémite un procédé sociologique, laissons cela aux professionnels des impostures.
Ne pas se raconter d’histoires
Si les propriétés générales de la zététique sont relativement intangibles jusqu’aujourd’hui, celle-ci est actuellement au cœur d’un délicat processus, conflictuel, mais nécessaire, sur son positionnement dans le champ de la vulgarisation et de la didactique scientifiques. Il importe donc de dire que toutes ses manifestations n’en ont pas pour autant pris les formes que lui ont donné Blanrue, Bricmont et leurs divers épigones — la « communauté sceptique » ayant très largement, en paroles ou en acte, coupé les ponts avec le premier, tombé dans l’oubli. Mais pour le second, des frictions, des malentendus ou des aveuglements sont encore présents.
Dans la perspective du sociologue Max Weber, il apparaît important d’attirer l’attention sur les agents porteurs de discours. Cela dit, au-delà des noms cités, il importe de rendre problématique l’idée d’attachement abstrait aux mots « Science » ou « Rationalité », et le risque de reproduction de dichotomies stériles (raison contre croyance, ou émotions, par exemple), mais aussi sur la production de monstres naissant du ventre-même de la modernité (l’antisémitisme, le climato-scepticisme, etc.).
L’apport des sciences sociales et la création de contenu vidéo
Le milieu des vulgarisateurs sceptiques est traversé de courants. Il apparait important de donner un coup de projecteur sur celles et ceux pratiquant une épistémologie engagée et réflexive, laïque sur sa propre pratique. Cela se traduit en évitant la sacralisation de certains totems (telle que « la Science »), en ne créant pas un statut supérieur à une « Raison » (pour ne pas devenir un « oligarque de l’esprit », selon l’expression de Nietzsche), et tenant compte que ce que l’on appelle « méthode scientifique » recouvre une pluralité de méthodes pertinentes dans chaque champ de connaissance. Ces méthodes font l’objet de disputes qui se déroulent à la fois entre chercheurs, au sein des institutions académiques, et la “société civile”.
Dans une vidéo intitulée Le scepticisme a besoin de la sociologie, postée par Patchwork, créateur de contenu intervenant dans le champ de la zététique et des sciences sociales, cette épistémologie engagée se traduit par la critique d’une science pensée comme neutre. Cette idée de neutralité — qualifiée d’autoritaire — amène à envisager une pure correspondance entre « la science » et le réel. De là découle une vision de la science qui se veut respectueuse d’une « méthode scientifique » unique et intouchable. Le fantasme de cette neutralité est en réalité antithétique avec la démarche scientifique, qui est une co-construction évolutive des savoirs. Et si le terme « autoritaire » a été utilisé, c’est pour mettre en avant le fait que certains « rationalistes » qualifient de « propagandes » certaines évolutions scientifiques remettant en cause des savoirs. Se détacher de cette neutralité reviendrait, pensent-ils, à pluraliser la connaissance, donc la relativiser voire l’annihiler. Pourtant, la connaissance avance par la contradiction et le consensus stabilisé méthodologiquement, le tout dans un cadre socio-historique déterminé mais changeant. Par exemple, comparer une découverte, qui construit une vérité, faite au 21e siècle avec une découverte du 17e siècle n’a pas de sens si on n’intègre pas les facteurs sociaux, religieux, scientifiques, etc. Un autre vidéaste, « Le Patient zéro », traite de la croyance dans le libre arbitre avec les outils du scepticisme. Un passage d’une vidéo met bien en avant cette idée de production collective et située de la connaissance, celle-ci étant : « étroitement liée à la manière dont ce collectif fonctionne. Qui le compose ? ; comment sont organisées les relations au sein de ce collectif ? ; quelle hiérarchie est mise en place ? ; quel rapport de force ? ; etc. Parce que cette organisation apparaît comme contingente, on reconnaît une multitude de manières de réfléchir. Ce qui ne revient pas à dire que toutes les pensées se valent. Mais que leur valeur dépend du contexte dans lequel elles s’inscrivent. […] La réalité perd de son caractère autoritaire, transcendant, et devient fragmentée, évaluée à l’aune de sa situation qui l’a vu naître ».
Pour boucler la boucle
Cette compréhension systémique rejoint la critique du libéralisme et l’appel de Karsenti à travailler avec les outils de la sociologie. Il nous faut donc travailler dans les pas de Max Weber, autrement dit étudier la production des individus (leurs intérêts et stratégies, leurs représentations des choses, etc.), tout en conservant une perspective systémique. S’attaquer rationnellement à l’antisémitisme doit prend le même chemin. Comme le résume avec lucidité Bernard Lazare, contemporain et opposant de Drumont, pour qui « la personnalité de l’apôtre antisémite n’a pas l’importance qu’il s’attribue lui-même et que les autres lui accordent. Il disparaîtrait demain que l’antisémitisme ne disparaîtrait pas avec lui. »
[1] Sylvain Laurens, Militer pour la science, EHESS, 2019, pp.25-55.
[2] L’épistémologie est l’étude critique des sciences, destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée (théorie de la connaissance).
[3] Andreotti, Bruno, et Camille Noûs. « Contre l’imposture et le pseudo-rationalisme. Renouer avec l’éthique de la disputatio et le savoir comme horizon commun », Zilsel, vol. 7, no. 2, 2020, p.24.
[4] Entretien avec Paul-Eric Blanrue, par Rachida Guedjal, Algérie Network, 25 février 2011, dans Zilsel, art.cit., p.25.
[5] L’analyse de Pierre Macherey : https://urlz.fr/eYq1
[6] Pour juger sur pièces: Conspiracy Watch : https://urlz.fr/eYq4 ; Jean Vogel, « Les trois formules du professeur Bricmont ». Publié in Points Critiques, n° 311, décembre 2010. https://urlz.fr/eYq6 ; Foucart, Horel, et Laurens. « 8. Burn-out chez les héros de la raison », Les gardiens de la raison. Enquête sur la désinformation scientifique, La Découverte, 2020, pp. 223-245. ; Jean Vogel, « Antisémite en dépit de son plein gré », Résistances, 1 Mars 2020, https://urlz.fr/eYny
[7] https://www.tzitzimitl.net/liens. Son article ici https://urlz.fr/eYnw
[8] Cédric Passard, « Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez Edouard Drumont », dans Emmanuel Danblon et Loïc Nicolas « Les rhétoriques de la conspiration », p.613.
[9] Voir Marc Angenot : Ce que l’on dit des Juifs en 1889. Antisémitisme et discours social. Cahier de recherche du CIEE/ICES, no 6, 1984. https://urlz.fr/eYnt
[10] Emmanuel Danblon et Loïc Nicolas, Modernité et « théories du complot » : un défi épistémologique, dans « Les rhétoriques de la conspiration. », p.22.
[11] Cédric Passard, op.cit., p.591.
[12] Emmanuel Kreis : « Le lien entre antisémitisme et conspirationnisme s’établit dès le XIXe siècle », Médiapart, 15 janvier 2015. https://urlz.fr/eYqd
[13] Cédric Passard, op.cit, p.602.
[14] Bruno Karsenti, La Question Juive des modernes, PUF, 2017.
Image : © photo Pierre Soulages