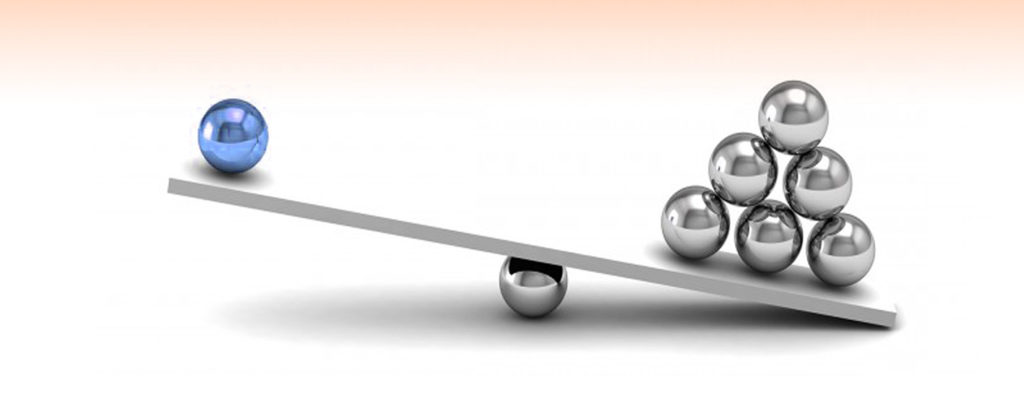Si quasiment personne ne peut ignorer aujourd’hui l’étendue des violences machistes que toutes les femmes connaissent au cours de leur vie, les politiques publiques sont loin derrière le changement de mentalités qui semble amorcé. Ce retard dans la mise en place de politiques de prévention de ce type de violences est d’autant plus flagrant lorsque nous dirigeons notre attention envers les femmes les plus vulnérables : sans-papiers, migrantes, réfugiées ou en attente de ce statut. La violence administrative serait la violence de trop, celle qui aggrave tous les autres processus d’altérisation, de subalternisation et d’enfermement dans des stéréotypes basés sur le genre, mais aussi sur la couleur de peau et sur l’origine géographique réelle ou supposée.
Avec la crise sanitaire, les situations d’extrême vulnérabilité concernant ces femmes sont devenues tellement criantes que les associations engagées dans l’action sociale avec les personnes migrantes se sont retrouvées submergés par leurs appels à l’aide. Des dispositifs ont été mis en place tant bien que mal pour répondre à cette urgence. La clandestinité organisée et son cortège de discriminations ont rompu l’équilibre précaire de situations qui étaient déjà à la limite du supportable avant le confinement.
Féminisation des migrations
Pendant plusieurs décennies, la migration des femmes vers la Belgique se faisait dans le cadre de politiques migratoires qui reflétaient les rôles traditionnels de genre : les hommes arrivaient en premier, pour travailler, et les femmes les suivaient pour s’occuper du ménage. D’abord le sien, puis celui des autres. Le regroupement familial était, jusqu’à il y a peu, la principale porte d’accès légal pour les femmes migrantes en Belgique.
Cependant, depuis les années 1990, la visibilité d’autres parcours migratoires des femmes s’accroît progressivement. « Plutôt que d’une augmentation soudaine des migrations féminines, il s’agit d’un progressifs « déplacement du regard » qui rend cette présence visible (…). Il s’agit également d’un changement de dynamiques : de plus en plus de femmes seules, davantage actrices de leurs trajectoires, mais aussi de plus en plus qualifiées, migrent ».
En Belgique, en 2020, 49% de la population migrante est féminine. Ce pourcentage a augmenté faiblement depuis les années 1960, période à laquelle les femmes représentaient 47% des primo-arrivants. Les vagues successives s’inscrivent dans un contexte socio-économique où la domesticité, les services à la personne et le travail reproductif (les soins au sein de la famille) sont l’alpha et l’oméga de leur destinée, quel que soit leur parcours, peu importe l’époque et cela malgré leur niveau de plus en plus élevé d’éducation.
L’assignation des femmes à la sphère reproductive est un trait culturel que les pays riches, industrialisés et démocratiques partagent avec les sociétés les plus traditionnelles ou avec celles gouvernées par les pires dictatures. Certes, dans les sociétés démocratiques d’Europe et d’Amérique du Nord, et dans une moindre mesure dans tous les autres pays qui tentent de s’aligner avec les principes égalitaires, on voit se mettre en place une pléthore de mesures qui, de la parité politique aux congés de paternité de plus en plus longs, tentent d’équilibrer le fossé existant entre hommes et femmes tant du point de vue de l’accès au pouvoir économique, politique et symbolique que dans la répartition des tâches.
Mais malgré ces efforts louables, pour les femmes il y a une certitude : les tâches domestiques, les enfants et les soins aux autres seront à leur charge. Peu importe le régime politique. Peu importe le lieu, peu importe la culture. Malgré l’illusion égalitaire, une répartition plus équitable entre hommes et femmes de cette charge reproductive n’est qu’exceptionnelle en Europe et la difficulté pour la rendre visible est le fruit de la croyance communément acquise que « chez nous » l’égalité serait déjà réglée. Cette illusion est difficile à déconstruire et résiste même dans les milieux les plus « progressistes », malgré la multiplication de données qui vont dans son sens.
Ainsi, « au niveau international, 76,2 % du temps consacré aux activités de soins non rémunérées est effectué par les femmes ». Pour la France, « la part des hommes dans le travail domestique passe de 21,8 % quand il a une conjointe inactive à 35,1 % quand elle est active professionnellement » , nous sommes encore loin des 50%-50% et avec la pandémie, les choses ne se sont pas améliorées : le chômage corona a été massivement pris par les femmes (grosso modo 70% pour elles, 30% pour eux).
Plus spécifiquement en Belgique, nos collègues de Laïcité Brabant Wallon nous rappellent que « En presque 15 ans, l’implication des hommes dans les tâches ménagères n’a pas bougé d’un iota. Pire, elle a même diminué ! Selon une étude sur l’emploi du temps des Belges réalisée par le SPF Economie1, en 1999, les hommes passaient 1h55 par jour à s’occuper des tâches domestiques, alors qu’en 2013, cette corvée quotidienne est descendue à 1h50 par jour. Les femmes, de leur côté, ont aussi diminué la cadence puisqu’elles n’y consacraient « plus » que 3h05 en 2013, contre 3h28 en 1999. Si l’on peut se réjouir que les femmes passent un peu moins de temps à balayer et à astiquer qu’avant, c’est seulement parce que leur niveau d’exigence a été revu à la baisse ou que les corvées ont été externalisées, en ayant par exemple recours à une aide-ménagère ».
En effet, derrière la grande majorité des femmes d’affaires, directrices d’entreprises, femmes politiques ou « simples travailleuses » du secteur marchand ou du secteur public, nous ne trouvons pas un homme activement engagé dans le travail reproductif mais plutôt une ou plusieurs travailleuses du care professionnel ou des services à la personne : femmes de ménage via les titres-services, filles au pair, nounous, puéricultrices, garde-malades, aides-soignantes… Autant de métiers féminisés, exercés majoritairement par des femmes issues d’anciennes colonies d’Afrique, d’Asie, et d’Amérique latine. Ces métiers sont également exercés par les femmes des pays d’Europe de l’Est et Centrale. Ils reflètent les disparités économiques entre les différents contextes géopolitiques. Dans ce contexte de mondialisation de la division sexuelle du travail, les femmes vont massivement intégrer le marché mondialisé du travail à travers des activités qui, culturellement, sont dans la continuité des modèles traditionnels de genre. Et ce « culturellement » n’est pas à prendre comme un marqueur de l’altérité culturelle des « peuples arriérés ». C’est un trait culturel universel. Peut-être le correspondant, dans la sphère du travail, de la « valence différenciée des sexes » concept clé de la pensée de la différence, développé par Françoise Héritier pour expliquer le caractère anthropologique de la domination masculine.
Ces modèles traditionnels de genre, qui placent les femmes du côté de la reproduction sont le point aveugle que les penseurs les plus critiques partagent avec les penseurs le plus conservateurs. Dans son ouvrage « Le capitalisme patriarcal », Silvia Federicci nous rappelle que « C’est parce qu’il n’a pas pu voir au-delà de l’usine et qu’il s’est refusé à envisager la reproduction comme un aspect du travail social (largement féminisé) qu’il ne s’est pas non plus rendu compte qu’il se tenait – à l’heure où il écrivait son Capital – au seuil même de l’émergence de la famille prolétaire nucléaire ».
Certaines chercheuses ont ainsi développé des concepts spécifiques qui rendent compte de la manière dont ces disparités économiques s’imbriquent entre elles. L’un de ces concepts est celui de « chaine du care ». Elle est décrite par Arlie Hochschild comme « un ensemble de liens tissés entre des personnes au niveau mondial et basés sur du care rémunéré ou non ».
A partir d’un exemple concret, on peut mieux percevoir cette interdépendance : « La fille aînée d’une famille pauvre du tiers-monde s’occupe de ses frères et sœurs (premier maillon de la chaîne) pendant que sa mère travaille comme bonne d’enfants pour les enfants d’une nounou ayant émigré dans un pays développé (deuxième maillon). Cette dernière à son tour s’occupe d’un enfant d’une famille d’un pays riche (dernier maillon). Ce type de chaîne traduit une écologie invisible du care, chaque maillon de la chaîne dépendant d’un autre ».
Cette chaîne du care, relie les femmes des pays riches et pauvres. Si elle est bénéfique au niveau individuel, autant pour les demandeuses que pour les pourvoyeuses de ce travail, elle tend à « reproduire les rapports de domination entre pays du Nord et pays du Sud, les inégalités de genre, l’individualisation des responsabilités des femmes vis-à-vis des tâches de reproduction sociale ».
L’assignation au travail reproductif est un trait partagé par les femmes originaires des anciennes colonies, mais également par celles issues des pays plus récemment intégrés dans le marché de travail européen (Europe de l’Est ou Centrale) et par les femmes belges nées de parents et de grands-parents belges des milieux populaires. Celle-ci opère comme un frein qui, malgré leurs efforts, restreint par la reproduction de stéréotypes, mais aussi par des barrières administratives, leur accès à l’émancipation.
Ileana , originaire d’Amérique centrale est docteure en médecine. Cela fait presque vingt ans qu’elle vit en Belgique. « C’est une histoire d’amour qui a commencé sur internet, avec un belge ». Actuellement, elle est aide-soignante dans un hôpital. « Je n’ai jamais eu l’occasion de faire reconnaître mon diplôme. Un an après le mariage, j’ai eu mes enfants. Quand ça a commencé à aller mal avec mon mari, j’ai dû travailler dans le premier poste qu’on m’a offert ». La procédure pour faire reconnaitre un diplôme universitaire étranger peut prendre plusieurs années et exiger des stages et l’approbation d’examens qu’une femme qui a la charge du ménage et des enfants ne peut tout simplement pas assurer sans le soutien d’une autre personne. Ileana le sait : « [Venir en Belgique] c’est la pire connerie que j’ai faite dans ma vie. J’ai perdu ma liberté ». L’émancipation qui s’envole, à nouveau, à cause d’une barrière administrative mais aussi, et surtout, à cause des stéréotypes de genre combinés à l’origine géographique et à certains traits physiques comme la couleur de peau.
Mona Chollet, dans son dernier ouvrage « Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles » dédie un chapitre entier aux fantasmes sexuels et à la fétichisation que les hommes occidentaux ont érigé depuis le 19e siècle à l’égard des femmes racisées. Les stéréotypes de genre, lorsqu’ils sont combinés aux rapports de domination coloniale ou économique, dévoilent la force structurante pour leur psychisme, d’opérer une distinction entre eux et l’Autre. Cet Autre absolu étant la femme asiatique, noire ou exotisée : « Chez les hommes qui les expriment, l’habitude d’occuper la position dominante, et la conviction que cette position est naturelle, empêchent de voir la personnalité d’une femme comme une richesse […]. Cette impossibilité se manifeste de façon particulièrement évidente dans les rapports avec des femmes racisées, mais elle n’existe pas seulement dans ce cas – au nom des « qualités » qu’on leur prête, ces dernières sont d’ailleurs érigées au rang d’exemples [de soumission, de docilité] pour l’ensemble des femmes. En raison de leur vulnérabilité économique, d’innombrables femmes n’ont pas d’autre solution que de se plier à ce jeu ».
Violences capitalistes et violences patriarcales
Nombreux parcours migratoires naissent du désir de s’émanciper des violences politiques et économiques qui affectent les hommes et femmes des pays du Sud et des pays d’Europe centrale ou de l’Est. Cette accumulation de violences s’inscrit dans une histoire qui, de la colonisation au colonialisme, « impose une division internationale du travail caractérisée par une surexploitation des travailleu.r.se.s des colonies. Dans ce même mouvement, il [le colonialisme] a agi en créant de nouvelles divisions sociales et sexuelles du travail, tout en produisant des catégories hiérarchisées en termes de nationalité, de classe, de « race » et de genre ».
A titre de comparaison, les travailleuses expatriées ou les conjointes de travailleurs expatriés résidant en Belgique ne sont pas victimes des violences administratives qui aggravent les discriminations qu’elles partagent parfois avec les femmes migrantes ou sans-papiers. Ainsi, bien que toutes les femmes soient susceptibles d’être soumises à une violence basée sur le genre au sein de leur foyer ou dans l’espace public, ce sont celles originaires des pays anciennement colonisés qui vont majoritairement se retrouver privées du droit à se défendre ou à se protéger par les voies légales. On imagine difficilement une fonctionnaire universitaire de l’OTAN se faire malmener par la police en cas de dénonciation d’une violence à son égard. Une femme pauvre et sans instruction, sans-papiers originaire d’un pays du Sud, en revanche, évitera probablement de se confronter aux autorités. Qui, des deux, sera mieux protégé?
Pour placer ces divisions sociales dans leurs lieux géographiques respectifs, Delphine Demanche, coordinatrice de la Sister’s House , partage avec nous le parcours-type des femmes qui arrivent à ce lieu d’accueil : « Beaucoup de femmes arrivent en fuyant le service militaire obligatoire en Érythrée, elles partent très jeunes, parfois dès 13 ans. Elles partent seules, ce sont des initiatives personnelles, à l’aide de passeurs. D’autres femmes, d’autres pays d’Afrique, partent pour éviter le mariage forcé ou l’esclavage sexuel. Il y a donc certaines femmes qui fuient un régime politique et d’autres qui fuient des violences spécifiquement liées au genre ».
Les besoins universels et les réponses spécifiques
Les politiques d’immigration de l’Union Européenne se durcissent et se déshumanisent. Cette réponse de repli répond à un paradoxe : les modèles de consommation des pays riches attirent, avec une promesse d’une vie meilleure, les habitants de zones géographiques devenues inhabitables ou indésirables justement par les modes de production des objets de cette consommation.
Inefficaces malgré les dangers croissants qu’elles provoquent, ces politiques n’empêchent pas que des milliers d’hommes et de femmes risquent leur vie dans la traversée vers le territoire européen. Pour les femmes, cette traversée est semée de violences spécifiques. « En général elles passent par la Lybie, où le système de traite d’êtres humains est organisé, avec esclavage et torture à la clé. Si nous apprenons qu’elles ont séjournée en Lybie plus de deux ans, on s’inquiète. Cela veut dire qu’elles ont probablement vécu des mois et des mois d’esclavage sexuel », explique Delphine.
Ce passage en Lybie est évoqué par les femmes de la Sister’s House à demi-mots et à voix basse, tellement il incarne de douleurs et de souvenirs de souffrances indicibles, mais partagées. Une ambiance plombée, malgré un quotidien souvent ponctué de convivialité, de repas préparés et pris en commun, d’intimité retrouvée souvent après de longs mois de vie à la rue, dans les zones les plus inhospitalières des villes et des campagnes de la route jusqu’en Belgique.
« On nous parle de « flux migratoire » – il faudrait qu’on change de terme, d’ailleurs! – et on oublie que ce sont des personnes qui ont des caractères, des personnalités et des histoires propres, personnelles et uniques », remarque la coordinatrice de la Sister’s House, pour qui l’accueil des habitantes de ce lieu tente de reproduire la vie à la maison. Les besoins d’intimité, de repos et de reconnaissance permettent de se reconstruire et de reprendre des forces pour poursuivre son parcours vers le Royaume Uni ou vers un projet de vie sur le continent. « Le fait de se sentir à la maison fait qu’on se sent autorisé d’être soi-même. On peut sortir du « mode survie », poursuit-elle.
Née d’un constat d’invisibilité des femmes dans les médias et dans les mobilisations pour les droits des migrants, « malgré le fait qu’elles étaient les premières à se faire arrêter par la police au parc Maximilien », la Sister’s House est le fruit d’une volonté de transgresser cette assignation de longue date des femmes à l’invisibilité. L’invisibilité est une autre forme de violence, certes moins mortifère que les autres, mais qui empêche toute possibilité de reconnaissance et de devenir sujet politique. Un lieu où le soin de soi et des autres est possible et qui permet de renouer avec des besoins universels de manière collective et en non-mixité nous fait rêver d’autres lieux où l’on puisse « devenir soi-même ». La sororité a une maison. Ses habitantes sont de passage. Espérons qu’elles puissent emporter avec elles ces graines de résistance face aux violences pour essaimer partout une solidarité sans frontières.