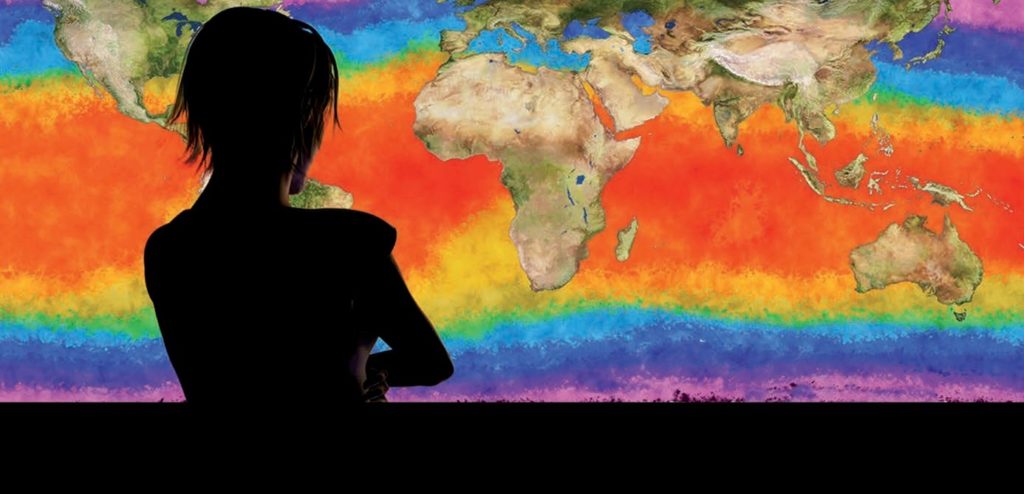“La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens”, écrivait Montesquieu[1]. Désormais, nous sommes amenés à croire que c’est la sécurité à titre préventif et le contrôle renforcé des frontières qui nous font jouir de la protection de nos personnes en société et de nos libertés individuelles et collectives.
Comment en sommes-nous arrivés à inverser à tel point le raisonnement que le passage de millions de personnes est remis en cause s’il entraîne, par son organisation et sa vitesse, le départ de combattants étrangers ou l’entrée clandestine d’un groupe ayant des intentions violentes ? Comment, au lieu de considérer la liberté comme le principe à partir duquel les interférences des États en termes de sécurité doivent être limitées, avons-nous, comme dans un jeu de ”reversi”, vu le développement d’une rhétorique où la liberté n’est plus que le point limite de la sécurité, elle-même redéfinie comme une suspicion nécessaire et vitale ?
De nos jours, tout se doit d’être sécurisé : nos habitats, nos villes, nos transports, nos mouvements, nos corps, nos écrits et nos idées. La perspective angoissée que, de l’extérieur ou parmi nous, certains fassent un usage illégitime de la violence en profitant de la liberté de circulation et de la confiance dans un espace sociétal où la présomption d’innocence a constitué et constitue (encore) le principe du lien social est désormais ancrée dans nos façons de voir et de penser. Ces façons de voir se nourrissent à l’aune de scénarii catastrophiques organisant le futur entre deux alternatives sinistres : la destruction inéluctable de la civilisation ou la prévention au présent du danger à venir. Lorsque la prévention se présente comme l’ensemble des mesures qui visent à garantir, à la fois l’intégrité et la pérennité des institutions et le maintien de l’ordre, et passe par des logiques de contrôle préventif, de la mobilisation de tous les citoyens et d’une surveillance de plus en plus interconnectée mais aussi discrète et à distance, le maillage territorial ou digital et le ciblage des populations ou des individus deviennent sa marque de fabrique.[2]
Tous ceux qui bougent sont alors un peu complices de bouger autant, de créer des flux qui de par leur nombre deviennent incontrôlables, surtout lorsqu’ils échappent ou sont empêchés de prendre des avions et arrivent par la mer ou la terre. Comme le signalait Zygmunt Bauman[3], la figure de l’ennemi terroriste a changé. Elle n’est pas tant celle d’un danger infiltré au milieu des réfugiés et migrants, souvent sévèrement contrôlés eux-mêmes, mais celle d’un infiltré au sein des voyageurs, des touristes que nous sommes, des couples qui ont trouvé l’amour à l’étranger et ont ramené l’autre pour vivre en famille. Si le maillage territorial de la sécurité renvoie à un continuum d’insécurité aux limites déterminées par des niveaux d’altérité différents, en revanche la logique sécuritaire qui se focalise sur les mouvements et la mobilité renvoie elle au soi, à l’intime et à la non-traçabilité de la potentialité d’une intention violente et à l’idée que nous sommes tous par conséquent des suspects en sursis.[4]
La mascarade du spectacle sécuritaire aux frontières ou dans les rues, qui déploie une certaine forme de violence rendue discrétionnaire par ses pratiques différentiées – mais qui n’empêche rien, n’arrête pas et ne dissuade pas –, ne fait que générer de l’anxiété, transformer un potentiel danger en une inquiétude permanente reprise à satiété par les jeux médiatiques. Contenir les limites de l’altérité, redessiner le nationalisme à coup de discours anxiogènes et de contre-mesures purifiant l’identité réinventée d’un passé traditionnel, dénationaliser pour bannir et prévenir plutôt que de surveiller, juger et punir sont les ingrédients de la recette politique des gouvernements de gauche comme de droite. Les libertés, les principes d’égalité, de non discrimination, d’innocence, de respect de la vie privée, existent toujours certes mais ont été relégués aux marges, aux points limites de la sécurité qui se veut interne et externe, répressive et préventive, protective mais discriminante. Peu importe les effets collatéraux de cette relégation car ils sont perçus comme négligeables pour autant qu’ils n’affecteraient que des autres, des ennemis et pas nous. Cette sécurité maximale qui se rêve globale, totale et illimitée et qui s’étale dans le futur pour empêcher l’incertitude est une proposition politique qui vient se substituer à l’autonomie et la liberté comme la constitution de soi par la reconnaissance de l’autre, de son existence, de ses droits humains et de la sécurité comme un moyen de garantir la dynamique du vivre ensemble hétérogène et du mouvement brownien d’une économie des différences. Dans cette dernière perspective, l’usage de la force reste un possible mais se doit d’être soumis au principe de justice. Cette adéquation de l’usage de la force avec sa justesse, sa nécessité et sa proportionnalité est encore bien présente chez les juges, dans les corps intermédiaires qui croient toujours à la séparation des pouvoirs comme moyen d’éviter un pouvoir despotique tuant la liberté. Mais force est de constater que de plus en plus de gouvernements se perçoivent comme des puissances tutélaires qui n’ont plus de citoyens mais des sujets. Des sujets assujettis à leurs origines, aux anciennes idées, à leur terroir, et ne bougeant plus.
Pourtant, ce qui se dit de plus en plus n’est en rien une nécessité imposée par la “violence terroriste”, elle a une histoire qu’il faut mobiliser pour se rappeler du temps d’avant “la servitude volontaire” devant la surveillance et la suspicion. Une histoire positive de la liberté individuelle et collective est toujours possible. Elle existe quand bien même elle est de plus en plus caricaturée comme une “contrainte”. Alors rappelons-nous, comment en trente ans, l’imaginaire collectif de la libre circulation en Europe a été profondément modifié. On ne visite plus l’Union Européenne, on rentre dans l’espace Schengen. On y rentre ou pas d’ailleurs. On peut aussi en être expulsé ou refoulé. La petite bourgade luxembourgeoise de six cents âmes de Schengen pourrait presque s’enorgueillir d’être ainsi au centre de l’attention depuis la signature en 1985 de l’accord éponyme visant à la constitution d’un espace de liberté et de sécurité. Lors de la date anniversaire de l’accord en juin 2015, le président du Parlement européen Martin Schulz n’a-t-il pas rappelé que “Schengen est peut-être un petit village mais c’est une grande idée”? Certes, en 1985 à Schengen, au fin fond du Luxembourg sur les rives de la Moselle et non loin des frontières allemandes et françaises, l’Europe est devenue plus qu’une réalité économique en embrassant la dimension politique de la libre circulation. Comment se fait-il que les riches heures de l’histoire de la libre circulation au sein de l’Union Européenne soient teintées d’une couleur plus sombre et que les réalités, les pratiques et les savoirs de l’espace Schengen s’énoncent dans une grammaire de la sécurité plutôt que de la liberté ?
Très clairement et au détour des années 1980, l’idée de cette Europe politique qui sous-tendait le projet de la libre circulation s’est accompagnée de crispations de la part de certains États pour lesquels l’ouverture des frontières était perçue comme une renonciation à l’idée même de souveraineté. Alors que certains services – douaniers en tête – s’inquiètent sur l’avenir de leurs professions, Schengen, c’est aussi la concrétisation d’un espoir policier, celui de pouvoir poursuivre des individus d’une frontière à l’autre et ce de manière légale et non plus à travers des réseaux de connivence et de coopération discrètes entre services d’un pays à l’autre. Schengen c’est aussi le visa du même nom, le sésame qui filtre, ouvre ou bloque les portes de l’Union Européenne et qui représente la cristallisation des efforts de contrôle de l’immigration y compris et surtout bien au-delà des frontières européennes, loin de nos yeux et de la possibilité d’un recours ou tout simplement d’une protection juridique. Schengen, c’est finalement l’ambiguïté de cette culture de la sécurité qui a accompagné le projet de la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, de ces mesures compensatoires visant à renforcer le contrôle aux frontières extérieures qui ont accompagné la mise en place de la libre circulation à l’intérieur. Comme si, effrayé par le projet, nous avions accepté de déshabiller l’un pour rhabiller l’autre et offert une contrepartie sécuritaire pour faire avaler la pilule par trop libertaire de la circulation sans frontières.[5]
Dans la mise en mots de l’histoire officielle de l’espace Schengen, le souci de sécurité, présenté comme mesure corollaire à la fin des frontières intérieures, tient de l’évidence et s’écrit en deux temps et trois mouvements. Une Europe de la libre circulation est certes un beau projet, mais une Europe sans frontières est forcément faible et vulnérable. Ne convient-il donc pas de compenser cette vulnérabilité par une plus grande coopération à l’intérieur et par un renforcement des frontières à l’extérieur ? Cette idée de déficit à compenser, de vulnérabilité à soigner est plus que l’envers de la médaille de la mise en place de la libre circulation. Il s’agit de la maxime, de l’épicentre même de l’espace Schengen autour duquel les tenants des libertés fondamentales, du droit des gens et de la libre circulation doivent s’arcbouter. Une maxime sécuritaire qui trouve dans la métaphore de la balance entre sécurité et liberté à la fois sa raison d’être et sa réalisation. En 2001, Lord Strathclyde, le chef des Conservateurs dans la Chambre des Lords, avait très habilement énoncé cette métaphore en disant qu’il convenait de trouver ”le juste équilibre entre les besoins de sécurité et la protection de la liberté”.[6] Plus de liberté passe par plus de sécurité car ne s’agit-il pas de maintenir les plateaux en équilibre ? Peu importe que cette métaphore soit erronée et qu’elle contribue à modifier en profondeur nos rapports au politique et à la citoyenneté.[7] Elle s’est durablement installée au creux de nos imaginaires collectifs car elle a la vertu de sa simplicité ; qui serait assez téméraire pour aller à l’encontre d’une théorie de la juste mesure et de la recherche de l’équilibre ?
Et pourtant cette métaphore est dangereuse et malhonnête car elle induit une représentation débilitante des libertés publiques là où, dans le cadre de nos démocraties libérales, celles-ci sont fonda- mentales et non négociables. Les libertés publiques sont essentiellement et fondamentalement normatives, elles encadrent le droit des États et ne sont pas soumises au bon vouloir de l’actualité aussi violente et anxiogène puise-t-elle être. Mettre les libertés publiques dans la balance en réponse à une actualité violente, c’est faire un calcul d’utilité politique à court terme. Combien de décisions absurdes ont-elles été prises au nom du 11 septembre ?[8] Face à l’exceptionnel, mesures exceptionnelles entendons-nous de plus en plus souvent. Il s’agit là d’une maxime de la raison d’État, d’un adage rhétorique fort, certes, mais qui n’est guère plus qu’un prêt-à-porter politique par défaut pour quiconque souhaiterait soit se montrer capable d’agir face à l’adversité, soit renforcer des pratiques de suspicion et de dérogation aux pratiques libérales de nos régimes libéraux. Refuser la métaphore de la balance est une chose, mais ne faut-il pas en premier lieu se sortir de toutes ces interprétations qui se conçoivent à l’intérieur d’une matrice de l’extinction et d’une heuristique de la peur ? Peur de ce qui pourrait survenir tout d’abord, sur la crainte d’une surenchère de violence toujours possible et où chaque attentat fonctionnerait comme indice de l’accomplissement des temps. Peur du nombre ensuite, sur les vagues successives de migrants, de réfugiés qui déferlent aux portes de l’Europe et qui charrient ses lots de cadavres. Peur de l’autre de manière générale, et où l’on se replie sur son petit quant-à-soi nationaliste, réinvestissant l’idée saugrenue qu’il y aurait des identités et des cultures naturellement compatibles et d’autres non.
Il faut sortir la libre circulation du cercle sécuritaire vicieux. Que l’on parle de tourisme, des programmes d’aide à la mobilité pour les étudiants et pour les apprentis, de la protection juridique et des droits des victimes s’accompagnant d’une harmonisation européenne de l’aide juridique pour les personnes les plus vulnérables ou encore du plafonnement des frais de téléphonie à travers l’Union européenne, la libre circulation est une chance. Une chance mais aussi un cercle vertueux. Renforcer la libre circulation n’est-ce pas donner une chance à la curiosité et par là même à l’ouverture d’esprit ? Le principe moteur de la libre circulation est-il autre chose que la démonstration effective que la diversité n’est pas un problème mais bel et bien une solution ? Dans notre climat politique délétère, anxieux et renfermé sur lui-même, la libre circulation des personnes et des idées pourrait bien ainsi contribuer tout autant à la lutte contre la radicalisation qu’à la lutte contre les nationalismes égoïstes, véritable enjeu politique pour notre avenir à tous.
[1] Montesquieu, Pensée n° 1574, in, Roger Gaillois, Montesquieu œuvre complète, volume 1, Paris, Gallimard, 1949.
[2] Didier Bigo, Emmanuel-Pierre Guittet, Amandine Scherrer, Mobilités sous surveillance, Montréal, Athéna éditions, 2009.
[3] Zygmunt Bauman, “From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity”, in, Stuart Hall and Paul du Gay (eds), Questions of Cultural Identity, London, Sage publications, 1996, pp.18-36.
[4] Emmy Eklundh, Emmanuel-Pierre Guittet, Andreja Zevnik, ed., Politics of Anxiety, London, Rowman & Littlefield, à paraitre
[5] Voir les travaux de Didier Bigo et Elspeth Guild : Polices en réseaux (Presses de Sciences-Po, 1996), Security and Migration in the 21st Century (Polity Press, 2009) et La mise à l’écart des étrangers (l’Harmattan, 2003).
[6] Didier Bigo, Emmanuel-Pierre Guittet, eds., “Antiterrorisme et société”, Cultures & conflits, n°61, Paris, l’Harmattan, 2006
[7] Didier Bigo, R.B.J. Walker, “Liberté et Sécurité en Europe : enjeux contemporains”, in ibidem, pp.103-136.
[8] Didier Bigo, Laurent Bonelli et Thomas Deltombe (eds.), Au nom du 11 septembre… Les démocraties face à l’antiterrorisme, Paris, La Découverte, 2008.