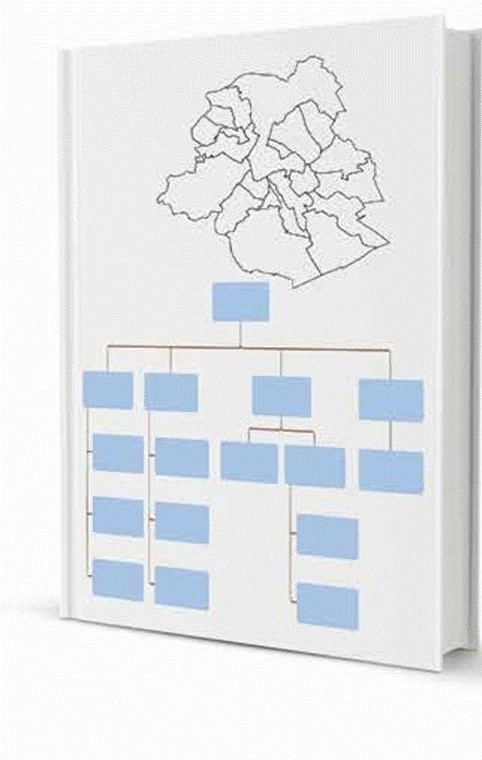Nous avons eu la chance de rencontrer Julien Pestiaux à deux pas du Palais royal et des bureaux de Climact. Une atmosphère feutrée, un bon café, et surtout un échange aussi dense qu’inspirant avec un acteur investi dans la transition énergétique en Europe. Hors du cadre associatif traditionnel, cette rencontre nous permet d’explorer un autre angle de la transition écologique, en nous tournant vers le monde des entreprises et des institutions – ceux qui, par leur poids, sont à la fois les principaux pollueurs… et les leviers les plus puissants pour provoquer le changement.
Julien, ingénieur civil électromécanicien, est associé chez Climact, une entreprise belge spécialisée dans les solutions climatiques et énergétiques qui accompagne les acteurs publics et privés en leur fournissant des outils stratégiques et concrets, des études prospectives et un soutien réglementaire dans le but d’accélérer la lutte contre le changement climatique.
Cette rencontre avec Julien Pestiaux nous offre une plongée au cœur des défis de la transition écologique, là où les grandes ambitions climatiques se confrontent aux réalités économiques et aux rapports de force internationaux. Julien ne vend pas du rêve mais nous fournit quelques clés pour comprendre comment les choses pourraient réellement changer… ou pas.
Après avoir passé en revue, de manière informelle, nos angoisses mutuelles concernant les instabilités politiques mondiales et la crise environnementale majeure qui ne font que se creuser, Julien nous dicte directement le ton en valorisant fortement le travail activiste et militant dans l’écosystème de la transition, tout en précisant que ce n’est pas du tout son rôle. Plutôt que de se concentrer sur la revendication, il préfère, de son côté, chercher à établir des ponts entre les différents acteurs afin d’essayer d’influencer le système dans son ensemble, précise-t-il.
Dans son travail, Julien Pestiaux dit viser la neutralité et l’objectivité sur les enjeux climatiques, tout en restant ancré dans des valeurs fortes qui guident son engagement pour l’environnement et les grandes questions de justice sociale.
Depuis quinze ans, il consacre son énergie à Climact, convaincu que son approche, plus dynamique et indépendante que celle des grandes firmes de consultance, permet d’apporter un regard neuf sur la transition. « Sans prétendre être parfaits, nous avançons avec des valeurs solides », ajoute-t-il.
En termes d’équilibre de valeurs, quel est son opinion concernant un discours dominant qui culpabilise l’individu en valorisant les “petits gestes”, occultant ainsi la responsabilité des grandes entreprises et des gouvernements alors que les bouleversements climatiques résultent avant tout, selon nous, de choix politiques et économiques ?
Pour Julien Pestiaux, bien qu’il existe parfois un discours cherchant à culpabiliser les individus, l’Union européenne et l’Etat belge ne semblent pas vraiment adopter cette approche. Au contraire, ils tenteraient plutôt de mettre en place un cadre réglementaire comportant des législations qui poussent les entreprises à intégrer la transition environnementale dans leur fonctionnement plutôt que se focaliser sur les petits gestes des individus.
Un bon exemple, selon lui, est la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui impose aux entreprises d’intégrer leur impact environnemental dans leur reporting, ainsi que les réglementations ESG (Environnement, Social, Gouvernance), qui les obligent à prendre en compte toute leur chaîne de valeur. Cela montre que la transition en cours ne repose pas uniquement sur la responsabilité individuelle, mais bien sur un cadre structuré à grande échelle. Pour lui, c’est la seule manière d’y parvenir car un changement basé uniquement sur les choix individuels ne peut suffire.
Julien Pestiaux souligne toutefois que les individus ont aussi un rôle à jouer : faire des choix éclairés et exercer une pression sur les décideurs pour orienter les politiques publiques dans la bonne direction. Il regrette cependant que les choix électoraux restent souvent dictés par une logique de protection individuelle plutôt que par une vision collective.
Il observe une tendance croissante à l’individualisme et au repli sur la cellule familiale, affaiblissant les dynamiques collectives. Selon lui, un engagement individuel, bien que nécessaire, ne suffit pas face à des enjeux aussi vastes. Se battre seul devient vite épuisant, et l’isolement dans cette démarche conduit souvent à l’abandon.
Julien Pestiaux poursuit en affirmant que si l’approche réglementaire européenne peine à s’imposer, c’est en grande partie à cause des déséquilibres économiques mondiaux. Il explique que les disparités entre les régions du monde compliquent l’application de règles environnementales strictes à l’échelle locale. Lorsque l’Europe impose des contraintes fortes aux industries, cela peut entraîner une désindustrialisation de certaines régions, tandis que d’autres pays en profitent pour attirer ces activités et déplacer le problème environnemental plutôt que le résoudre.
La situation actuelle, avec notamment l’Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui s’inscrit dans la ligne de leur impérialisme économique, renforce encore ces écarts. Une Europe qui mène seule cette transition, tandis que d’autres régions poursuivent leurs activités polluantes sans contraintes ne peut amener de solution. L’enjeu est de faire en sorte que les standards européens s’imposent progressivement à l’international, afin d’éviter une concurrence déséquilibrée et une transition inefficace.
L’un des outils majeurs pour atteindre cet objectif est le CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Ce système vise à appliquer aux importations le même niveau d’exigence en matière de CO2 que celui imposé aux producteurs européens. Par exemple, si une entreprise importe de l’acier d’un pays où les normes environnementales sont plus laxistes, une taxe est appliquée pour compenser cette différence.
L’idée est d’éviter les délocalisations vers des pays moins régulés et de garantir que la transition énergétique européenne ne soit pas compromise par une concurrence déloyale. Mais sa mise en place est extrêmement complexe, notamment parce qu’elle nécessite d’évaluer précisément l’empreinte carbone des produits importés, un défi technique impliquant l’analyse des chaînes de production à l’échelle mondiale. Actuellement, le CBAM ne concerne qu’un nombre limité de produits, ce qui pose un risque de contournement : une entreprise pourrait, par exemple, importer directement des voitures fabriquées avec de l’acier polluant plutôt que l’acier brut lui-même.
C’est pourquoi le mécanisme est déployé progressivement, avec un élargissement prévu à d’autres produits. Sa mise en œuvre suscite de fortes réactions internationales : les États-Unis, notamment, menacent de mesures de rétorsion en imposant des taxes similaires aux produits européens, rendant l’équilibre encore plus délicat sur le plan diplomatique.
Selon Julien Pestiaux, il est aussi grand temps que l’Europe réinvestisse massivement dans ses propres industries et infrastructures vertes si elle veut réussir sa transition énergétique alors qu’elle reste trop prudente, souvent contrainte par des limitations budgétaires strictes, notamment sous l’influence de pays comme l’Allemagne, qui freinent les dépenses publiques.
L’enjeu n’est pas seulement environnemental, il est aussi économique et stratégique. Il est crucial, selon lui, d’accélérer ces investissements, non seulement pour atteindre les objectifs climatiques, mais aussi pour garantir la souveraineté industrielle et énergétique de l’Europe.
Une autre inquiétude actuelle concerne la loi Omnibus, qui pourrait relever les seuils d’application de certaines directives comme la CSRD, exemptant ainsi les PME de ces obligations. Cette mesure risque d’être contre-productive, car les grandes entreprises, toujours soumises aux exigences de transparence, continueront de leur demander des données sur leur chaîne de valeur. Le résultat pourrait être un reporting fragmenté et hétérogène, rendant le processus plus chaotique au lieu de le simplifier.
Julien Pestiaux estime que si la rapidité des avancées réglementaires en Europe était nécessaire face à l’urgence climatique, elle a aussi engendré une complexité excessive qui peut freiner son efficacité. La CSRD, par exemple, représente une avancée majeure en imposant aux entreprises un reporting détaillé sur leurs impacts environnementaux, mais dans certains cas, cette obligation devient une charge administrative lourde, générant une masse d’informations peu exploitables.
Pour Julien Pestiaux, il est essentiel de trouver un équilibre : intégrer les enjeux climatiques à tous les niveaux, éviter une bureaucratie excessive et garantir que ces réglementations servent réellement la transformation des entreprises plutôt qu’une simple accumulation de données administratives.
Certaines entreprises affichent des engagements climatiques tout en maintenant des activités extrêmement polluantes et des investissements dans les énergies fossiles. En accompagnant ces acteurs, comment Climact s’assure-t-il que ses conseils aboutissent à de véritables transformations et ne servent pas simplement à verdir leur image sur fond de greenwashing ?
Climact a mis en place un système d’évaluation des projets afin de s’assurer que les entreprises qui font appel à elle souhaitent réellement avancer dans la transition et non simplement faire du greenwashing. Ce processus comprend notamment le critère de l’impact du projet (vérifier que la demande va dans la bonne direction et qu’elle ne sert pas seulement à verdir artificiellement l’image d’une entreprise – projets de comptabilisation carbone, de transition énergétique ou de transformation des modèles économiques) et le critère de l’engagement de l’équipe (évaluation de la motivation et implication des équipes).
Nous savons que certains acteurs peuvent chercher à améliorer leur image grâce à notre travail, affirme-t-il, mais notre mission est d’abord d’analyser factuellement leur impact et de les aider à comprendre comment le changement climatique et la transition énergétique affectent leur activité.
C’est ce que l’on appelle, dans le cadre de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), le principe de double matérialité. Cela signifie qu’une entreprise doit réfléchir à la fois à son impact sur l’environnement, mais aussi à l’impact des changements environnementaux sur elle-même (?).
Climact refuse catégoriquement tout projet qui ne viserait qu’à soigner l’image d’une entreprise sans actions réelles et mesurables autour d’un véritable engagement.
Un bon exemple de leurs défis fut le projet autour d’un acteur majeur du secteur automobile en Belgique, particulièrement influent sur le marché des voitures de société.
La première phase de l’intervention a consisté en une sensibilisation des cadres dirigeants et responsables stratégiques. Climact a organisé des workshops réunissant une vingtaine de personnes, dont le comité exécutif, pour poser factuellement les implications scientifiques, économiques et réglementaires de la transition. L’objectif était d’aider cette entreprise à comprendre comment son activité allait évoluer face aux nouvelles réalités du marché et des politiques environnementales.
En parallèle, cet acteur a intégré une démarche alignée avec les Science-Based Targets (SBTi), un cadre strict qui permet de structurer les stratégies de décarbonation en accord avec les objectifs climatiques internationaux. Ce référentiel impose des plans ambitieux de réduction des émissions, avec des objectifs chiffrés à court et moyen terme. Il offre un cadre structuré qui permet aux entreprises de fixer des trajectoires alignées avec les ambitions climatiques globales, tout en s’appuyant sur des données scientifiques robustes.
Au-delà du simple passage à l’électrique, c’est tout le modèle économique du secteur automobile qui doit être repensé. Et c’est ici que le facteur temps devient critique : à quelle vitesse une telle transformation peut-elle réellement se faire ?
Aujourd’hui, le marché reste fortement structuré autour des ventes de voitures thermiques, qui offrent des marges plus importantes, notamment pour les modèles haut de gamme. La mutation vers d’autres formes de mobilité (notamment via une adaptabilité du partage et des jauges des véhicules) reste marginale, en grande partie parce que les incitations économiques et contraintes réglementaires ne sont pas encore assez fortes pour accélérer la transition.
On retrouve ici une tension classique entre régulation et marché : tant que le cadre législatif n’accélère pas suffisamment la transition, les entreprises avancent à leur propre rythme, en équilibrant rentabilité et adaptation. Il est donc essentiel que les politiques publiques évoluent rapidement pour rendre la transition économiquement viable et nécessaire.
Si les référentiels globaux comme le SBTi sont essentiels, Climact pense néanmoins qu’il est crucial d’aller plus loin en intégrant une dimension plus locale et sectorielle, traduit en actions concrètes, adaptées aux réalités spécifiques de chaque secteur et pays.
C’est le travail qu’il sont en train de mener dans le cadre d’un projet pour la Commission européenne visant à traduire les trajectoires climatiques de l’Accord de Paris en objectifs concrets pour différents secteurs et pays.
Et pourquoi Climact, forte de son expertise, ne mène-t-il pas des actions militantes concrètes, sur le terrain, pour appeler au changement ?
Julien Pestiaux insiste sur le fait que malgré son engagement profond envers l’environnement, Climact a choisi de rester dans le cadre du marché plutôt que d’adopter une posture activiste. Il estime que parler le même langage que les grandes entreprises, en partager les codes, facilite le dialogue avec elles et permet d’intégrer les enjeux économiques et stratégiques dans les discussions sur la transition énergétique.
Les entreprises seraient souvent plus enclines à se tourner vers un cabinet de conseil comme Climact, plutôt que vers des organisations plus militantes, qui peuvent paraître en décalage avec leurs réalités économiques. Toutefois, Julien Pestiaux insiste sur la vigilance à ne pas perdre de vue leur mission principale : donner aux entreprises les moyens d’agir concrètement pour réduire leur empreinte carbone et leur impact environnemental de manière efficace et rapide.
Il précise que Climact travaille aussi avec le secteur public, qui représente une part importante de son activité, accompagnant administrations, pouvoirs publics et institutions en apportant une vision macro-économique sur l’évolution du marché et les transformations nécessaires pour accélérer la transition énergétique.
Selon lui, ce type d’analyse approfondie est essentiel pour ajuster les politiques publiques et garantir leur efficacité dans la transition énergétique.
Certaines politiques de transition énergétique sont souvent critiquées pour leur impact sur les ménages les plus précarisés. Comment prends-tu en compte ces aspects sociaux pour éviter que la transition ne creuse encore plus les inégalités ?
Pour Julien Pestiaux, cette question est essentielle, car une transition mal pensée peut en effet creuser les inégalités sociales, alors qu’elle devrait, au contraire, être un levier d’amélioration du bien-être pour tous.
Climact a beaucoup travaillé sur cet enjeu, notamment dans le cadre d’un projet pour l’administration fédérale portant sur la tarification du carbone. L’un des défis majeurs avec une taxe carbone ou une hausse du prix de l’énergie est que l’impact n’est pas le même pour tous les ménages. Une augmentation du coût de l’énergie touche de manière disproportionnée les foyers dont une part importante du budget est consacrée aux dépenses énergétiques.
Pour quantifier ces disparités, Cimact a segmenté la population en différentes catégories socio-économiques, afin d’évaluer l’impact réel d’une taxe carbone selon les niveaux de revenus. À partir de ces analyses, des mesures de compensation ont été proposées, car une taxe seule ne suffit pas à garantir une transition juste.
L’enjeu principal est de décider comment redistribuer les recettes générées par cette taxation. Diriger ces fonds vers les ménages les plus vulnérables, pour compenser l’impact disproportionné qu’ils subissent et leur permettre de mieux s’adapter aux changements semble être une solution pour le cabinet.
Un domaine clé où cette problématique se pose est celui des primes à la rénovation énergétique des bâtiments. Si l’on veut que la transition bénéficie réellement à toute la population, il est essentiel que les ménages précaires aient un accès prioritaire aux aides pour rénover leur logement et améliorer leur efficacité énergétique.
Or, dans la pratique, ce n’est pas encore le cas. Aujourd’hui, les dispositifs de soutien à la rénovation profitent surtout aux ménages les plus aisés, qui ont les ressources financières et administratives pour réaliser les investissements nécessaires. Les foyers les plus précaires, en revanche, n’ont souvent pas la capacité financière d’engager ces travaux, même avec des aides, ce qui les laisse bloqués dans des logements mal isolés, aux factures énergétiques élevées.
Il reste donc d’importantes améliorations à apporter pour que la transition énergétique ne se transforme pas en un fardeau supplémentaire pour les ménages déjà en difficulté. Une véritable politique de justice climatique et sociale doit être mise en place, afin que la transition devienne un levier d’amélioration du niveau de vie, et non un facteur d’aggravation des inégalités.