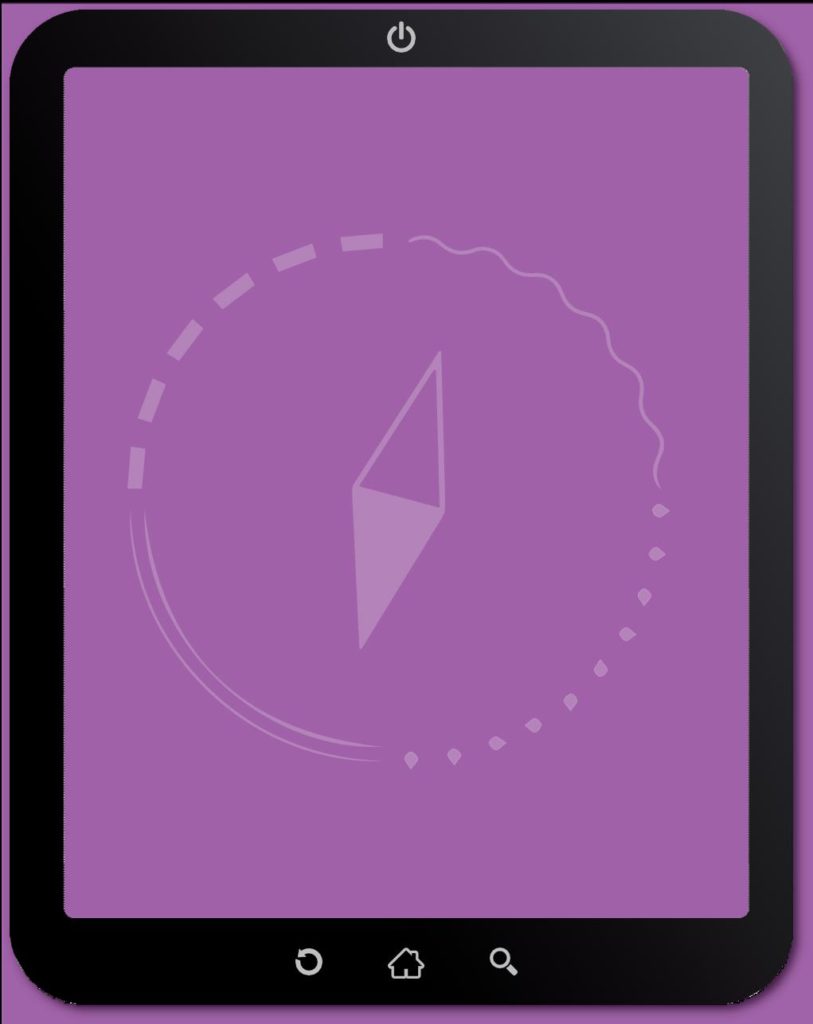Deux camps se disputent aujourd’hui les rênes de notre avenir politique. Populistes et technocrates tiennent chacun leur nom des invectives lancées par leurs adversaires. Depuis les années 90, Pierre Manent, Marcel Gauchet ou encore Christopher Lasch ont thématisé le divorce entre libéralisme et forme démocratique, entre l’idéologie des droits de l’homme et le gouvernement du peuple.1 La crise de 2008, et plus encore les remèdes avec lesquels on s’est proposé de la surmonter, ont accéléré ce lent processus de fragilisation des institutions. Reprenant ce constat, un jeune auteur allemand expatrié aux États-Unis, Yascha Mounk2, s’inquiétait récemment du développement parallèle d’un “libéralisme antidémocratique” et d’une “démocratie antilibérale”. Ironiquement, l’auteur voyait en Emmanuel Macron la preuve qu’une coalition des forces libérales pouvait vaincre les démons populistes qui partout ailleurs semblaient irrésistiblement triompher.
L’exemple français lui semblait marquer un tournant, un réveil. Le malaise profond qu’exprime le mouvement des gilets jaunes semble démentir cet espoir trop rapidement et trop naïvement conçu. Le point commun de toutes ces secousses qui agitent l’hémisphère occidental, c’est une remise en cause du dispositif représentatif. Il faut entendre par cela, non pas seulement son arrangement institutionnel, mais la relation concrète entre une classe dirigeante et ceux qu’elle gouverne. À l’approche des élections européennes et alors que les fractures françaises se confirment, comment expliquer cette décomposition de la démocratie libérale ?
DES SOCIÉTÉS FRAGMENTÉES
La première raison pour laquelle il devient de plus en plus difficile aux populations de reconnaître la légitimité sortie des urnes, c’est le creusement, au cours des cinquante dernières années, des écarts sociaux, économiques, culturels et géographiques entre leur propre condition et celle de l’ensemble d’individus parmi lesquels ils choisissent leurs représentants.
L’aggravation de ces écarts a deux conséquences principales. En premier lieu, elle signifie que ceux qui composent la classe dirigeante ont pour une large part des valeurs, des aspirations et une vision du monde sensiblement différentes de ceux qu’ils entendent diriger. Plus concrètement encore, la séparation grandissante des deux ensembles humains au sein d’une même société signifie que les représentants ont de moins en moins l’occasion de ressentir les conséquences de leur propre politique ou de côtoyer véritablement ceux qui les subissent.
Ces phénomènes ont la particularité de s’alimenter l’un l’autre. À mesure qu’il devient en effet plus facile de prendre des décisions, souvent techniques, derrière des portes closes, le fait de les soumettre à la discussion publique devient quant à lui plus risqué en raison des désaccords profonds qui opposent les dirigeants aux dirigés. La seule tâche de représenter les représentés ne pouvant plus résumer leur activité, les hommes politiques se trouvent de plus en plus souvent contraints d’invoquer de nouvelles sources de légitimité afin de justifier leurs décisions (nécessités économiques, droits de l’homme, intégration européenne etc.).
Cela pose un problème classique de principal agent : celui qui décide des mesures à entreprendre est confronté à deux contraintes ; ne connaissant pas les circonstances concrètes de ceux sur lesquels elles s’imposent, il manque d’information ; n’ayant pas à subir les conséquences de ses propres décisions, il ne s’en sent pas responsable. Les décideurs politiques conscients de cette situation ont longtemps cru que la décentralisation pouvait suffire à rapprocher le gouvernement des citoyens. Quels que soient les avantages qu’on en a retiré, ce type de réforme n’a visé que l’organisation institutionnelle du pouvoir et non sa réalité. Elles ont dans une très large mesure échoué à combler le déficit démocratique que ressentent de larges pans de la population.
LA SOCIOLOGIE DES ÉLITES
L’histoire de ce divorce admet beaucoup d’explications (disparition des institutions transversales, déclin industriel, mouvements de populations, tertiarisation des espaces urbains etc.). Il a dans chaque pays une intensité et des modalités différentes. Mais le facteur le plus puissant d’aliénation entre ces deux groupes sociaux tient vraisemblablement à l’importance grandissante des diplômes universitaires dans l’intégration de la classe dirigeante.
Dans L’âme désarmée3, Allan Bloom soulignait déjà l’importance politique de l’université en régime de représentation :
“Il n’est nul besoin de prouver l’importance de l’éducation, mais il faut noter que pour les nations modernes, qui se sont davantage fondées sur la raison dans ses différentes formes qu’aucune nation du passé, une crise de l’université, la demeure de la raison, est probablement la plus profonde crise à laquelle elles puissent faire face.”
À une époque où certains brocardent à l’envi l’inculture des élites, ces dernières n’ont paradoxalement jamais été autant exposées aux idées et modes de discours que produit l’université. Là où la politique est la représentation en acte de la société, l’université en est la représentation en discours. L’une et l’autre sont étroitement liées. Quel type d’éducation politique fournit-elle ?
Les deux caractéristiques des sciences sociales qui dominent le champ académique aujourd’hui sont, d’une part, le rejet des jugements de valeur par lesquels les individus déterminent le motif de leur action, et d’autre part, l’explication de leur comportement par des faits, les fameux déterminismes, dont ces derniers seraient très largement inconscients.
Ces deux idées – que les jugements par lesquels les agents croient déterminer le sens de leur action sont insignifiants, et que par conséquent ils en ignorent les déterminants véritables – imprègnent profondément la façon dont les classes dirigeantes interagissent avec les citoyens dans les démocraties postmodernes.
La sociologie affirme qu’il n’y a de connaissance que des faits, les technocrates prétendent quant à eux décider en leur nom. Cette compréhension du politique en exclut délibérément, comme “jugements de valeur”, les motifs par lesquels les agents fournissent les raisons de ce qu’ils font. Érigée en principe de gouvernement, la distinction entre faits et valeurs amène naturellement à dénigrer l’idée que la conversation civique puisse produire un ordre rationnel et juste. L’objectivité technocratique n’aurait donc rien à apprendre de la subjectivité démocratique. Elle creuse évidemment la distance et le mépris entre ceux qui ont accès à la compréhension scientifique du social et les autres.
LA PÉDAGOGIE ET LA REVENDICATION
Quel sens la discussion publique peut-elle avoir si les décisions qui sont prises ne dépendent ni des opinions qui sont exprimées, ni des personnes qui les expriment ?
Que les problèmes soient liés aux programmes éducatifs, à la gestion de l’économie ou aux politiques migratoires, la solution serait aux mains des pédagogues, des économistes ou des magistrats de la CEDH. Dans chaque cas, la politique, c’est- à-dire l’organisation de ce qui dépend de nous, est ramenée à des nécessités impersonnelles. Ce qui est nécessaire ne se discute pas, en revanche il s’explique.
Dans ces conditions, les deux seuls modes d’expression civique qui subsistent sont d’une part la pédagogie et d’autre part la revendication de nouveaux droits. En s’excusant si souvent d’en manquer — de pédagogie —, les hommes politiques trahissent une conception verticale de la parole publique, dont le seul rôle serait de mieux informer les citoyens des mesures qui s’imposent. Le cas du référendum de 2005 en France est à cet égard symptomatique.
Le vocabulaire de la revendication court-circuite quant à lui tout autant la discussion, dans la mesure où il ne vise pas à débattre des fins que nous voulons donner à notre vie collective mais exige la réparation d’une injustice considérée par la minorité qui la subit comme incontestable. Du fait de sa structure même, cette rhétorique militante n’envisage la communauté politique que comme fragment, comme minorité, et jamais comme totalité.
LA DISSOLUTION DE LA NATION
Puisque ce qui gouverne notre activité ne dépend plus de qui nous sommes (Français, Allemands, Italiens etc.), dans la mesure où les lois du marché ou les droits de l’Homme sont les mêmes partout, les classes dirigeantes occidentales ne semblent plus rien avoir d’autre à proposer que leur propre abolition dans un cadre de gouvernance élargi à l’échelle européenne et si possible globale.
Ce qui caractérisait le prolétaire du XIXe siècle pour Marx, c’était son absence d’attaches. N’ayant d’autre propriété que son propre corps rien ne s’opposait à sa mobilité. Ce qui caractérise les classes populaires du XXIe siècle c’est précisément leur éloignement des flux de circulation nationaux et internationaux et leur dépendance accrue aux solidarités locales (parents, voisins etc.) qui leur interdisent de prendre part à ce grand mouvement.
Dans de nombreux cas, cette démarche des élites est donc comprise comme une forme de désolidarisation dont ne bénéficieraient que les grandes métropoles et les classes créatives qui y circulent. Cette sensation n’est parfois pas dénuée de vérité. Quoi qu’il en soit, les capacités très inégales qu’ont les citoyens pour participer à ce nouveau projet ont beaucoup compté dans l’adhésion massive des périphéries au discours de réappropriation nationale tenu par les partis populistes.
L’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT AU REPRÉSENTÉ
Les partis politiques qui ont répondu à cette détresse des masses périphériques sont donc loin d’être la cause, ni même la cause principale, de la crise du régime représentatif. Leurs victoires récentes ne sont que la conséquence d’une dégradation beaucoup plus ancienne de notre régime d’action.
Le succès de leur démarche doit certes beaucoup au fait qu’ils se sont adressés à leurs électeurs dans un langage similaire au leur. Ces derniers paraissent désormais déterminés à ne plus se laisser convaincre par des hommes qui leur donneront le sentiment qu’ils n’ont rien à apprendre d’eux et que le monde qu’ils construisent pourra se faire sans eux.
Il est en revanche peu probable qu’ils puissent apporter des réponses durables à cette crise. Aussi longtemps qu’ils se situent dans l’opposition leur mise en accusation de l’élite a toutes les raisons de fonctionner, tout spécialement lorsqu’elle n’est pas injustifiée ; mais partout où ils accèderont aux responsabilités, les mêmes mécanismes qui les ont favorisés risquent de se retourner contre eux.
En élisant des représentants, les électeurs ne cherchent pas, ou pas uniquement, à ce que ces derniers leur ressemblent. L’objectif de la représentation c’est tout autant le bon Gouvernement. Elle n’est pas un dispositif neutre par lequel la volonté populaire serait traduite, exactement comme si le peuple s’était réuni tout entier. En passant par ses représentants, cette volonté change de qualité.
L’APTITUDE AU COMMANDEMENT
À l’état d’opinion simplement exprimée, la volonté populaire n’offre en effet pas les réponses simples qu’on attend d’elle. Il ne suffit pas de dire ce que veut le peuple, ou de vouloir ce qu’il veut, pour être apte à gouverner. Ce qui va transformer cette volonté en règle par laquelle notre action trouve sa cohérence et atteint sa fin, c’est la qualité du jugement pratique des représentants.
Dans le rejet souvent proclamé de tout critère extérieur permettant de juger la volonté populaire, les partis populistes prennent le risque de sacrifier cette aptitude au commandement qui distingue certains hommes de tous les autres au profit du seul impératif de ressemblance.
Une conception de la volonté populaire qui estime que toute opinion est bonne dès lors qu’elle est la nôtre rend impossible la distinction entre opinion et connaissance sur laquelle repose le rationalisme politique. Décider de ce qu’il faut faire ne saurait consister à céder à chacune de nos passions, pour la simple raison que ces dernières ne s’accordent pas entre elles. À mesure que les populistes ont exprimé la leur et qu’autour d’elle semblait se renforcer l’unité d’une part importante de la population, ils ont aussi suscité des passions contraires, parfois simplement la peur, et ont approfondi les fractures qui nous divisent.
En refusant toute idée d’aptitude à commander, nous devenons incapables de juger de ce qui est simplement séduisant ou véritablement bon, c’est-à-dire incapables de nous gouverner nous-mêmes. Les technocrates cultivent le triste rêve que la politique pourrait s’affranchir de la souveraineté populaire et se résumer à l’administration des droits des individus. Par défiance à l’égard de toute expertise, leurs adversaires ne devraient pas oublier que la volonté, fut-elle populaire, n’est pas une certitude intérieure qui ne demanderait qu’un agent pour s’accomplir. C’est dans la délibération où s’exposent et se confrontent ses motifs, que la volonté se détermine comme effort de connaissance de soi et du monde.
1 Par exemple : Pierre Manent, La raison des nations, Gallimard, 2006 ; Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Gallimard (Tel), 2002 ; Christopher Lasch, La révolte des élites, Flammarion (Champs Essais), 1995.
2 Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie, Éditions de l’observatoire, 2018.
3 Allan Bloom, The Closing of the American Mind, Simon and Schuster Paperbacks, p. 22 (notre traduction).