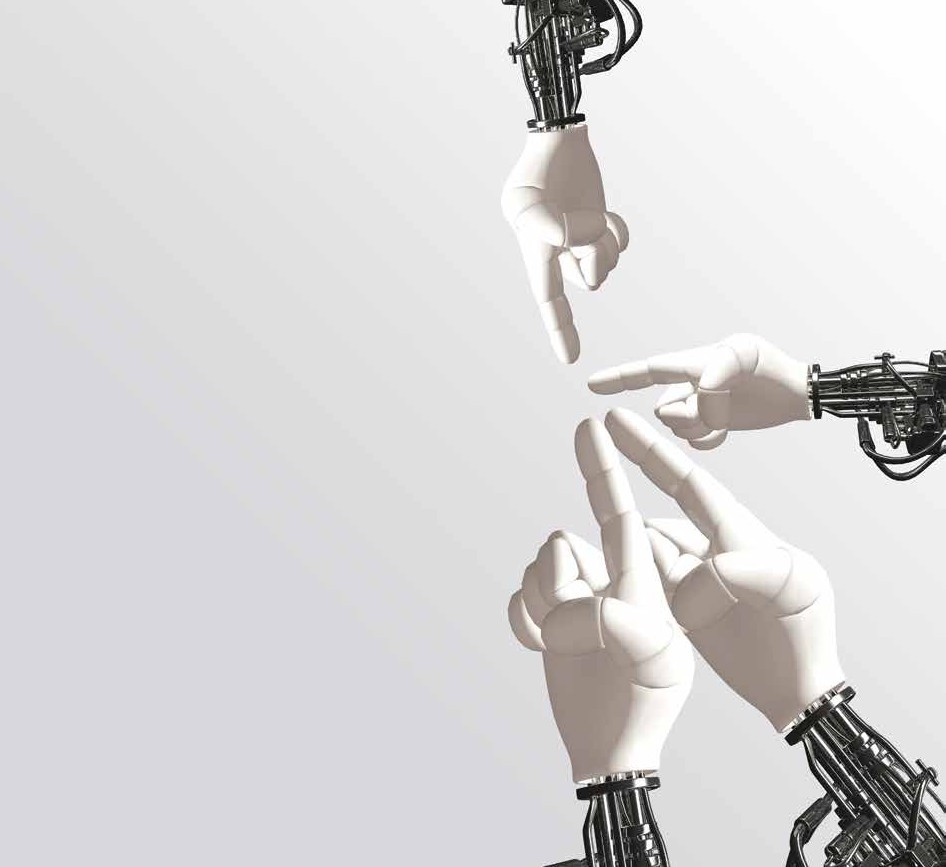Casse-tête militant
À travers de multiples voix, Bruxelles Laïque s’interroge sur le militantisme et l’engagement politique.
1 – FIRAS KONTAR ; 2 – JEAN-YVES PRANCHERE ; 3 – NINON BERMAN & JONAS PARDO ; 4 – CECILE HISTAS ; 5 – Jacques Moriau ; 6 – Philippe Corcuff (1) – (2)
Lire ou discuter avec Philippe Corcuff amène souvent la réflexion suivante : plus la période est trouble et dangereuse pour nos démocraties, plus il nous faut aiguiser nos outils de réflexions, les mettre à jour, penser contre soi-même. Son dernier ouvrage La grande confusion. Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées (2021), nous livrait une saisissante analyse théorique des glissements et chevauchements idéologiques donnant lieu à un affaiblissement des forces progressistes au profit des pensées réactionnaires, y compris à gauche. Mais Philippe Corcuff n’est pas que sociologue et philosophe politique, professeur en science politique à l’Institut d’études politiques de Lyon, membre du Cerlis (Centre de recherche sur les liens sociaux, CNRS-Université Paris Cité-Université Sorbonne Nouvelle), il est aussi un acteur de terrain, un militant politique et associatif. Tirer les leçons de plus de 40 ans de militantisme tout en ouvrant des chemins de réflexions pour construire la suite ne pouvant se raconter d’une seule traite, nous vous proposons cet entretien en 2 parties.
1ère partie
Cet entretien est l’occasion de revenir sur votre parcours militant et intellectuel, et approfondir la question de l’engagement et militantisme par le prisme des sciences sociales. Outre votre position universitaire, vous avez un riche et singulier parcours militant. Pourriez-vous le résumer ?
Je suis né en 1960 et je suis militant dans des organisations politiques depuis 1976. Dans mon lycée, à Bordeaux, en rentrant en première, j’ai rejoint le Mouvement de la jeunesse socialiste (MJS) sur une ligne de gauche, marxisante et autogestionnaire, incarnée à l’époque par le CERES (Centre d’études, de recherches et d’éducation socialiste). Et l’année suivante, j’ai adhéré au Parti socialiste lui-même. J’étais même entre 1983 et 1989 conseiller municipal de ma commune dans la banlieue populaire de Bordeaux, Floirac. Et puis j’ai eu toute une série de déplacements organisationnels, tout en gardant à travers le temps un noyau de convictions anticapitalistes proches. J’ai quitté le PS fin 1992, à cause de la première Guerre du Golfe, et j’ai suivi Jean-Pierre Chevènement, qui était à l’époque un des animateurs du CERES, dans la création du Mouvement des Citoyens en 1993, situé à la gauche antinéolibérale du PS. Puis j’ai rejoint les Verts en 1994. J’ai quitté les Verts fin 1997, à cause de leur entrée dans le gouvernement de la gauche plurielle de Lionel Jospin, pour créer avec quelques-uns le petit réseau SELS (Sensibilité écologiste, libertaire et radicalement social-démocrate) qui s’est rapproché de la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR), où j’ai adhéré en 1999. En 2009, j’étais un des cofondateurs du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA). Ensuite, j’ai rejoint la Fédération Anarchiste (FA) en 2013, que j’ai quittée en 2022. J’ai donc été membre d’organisations politiques pendant plus de quarante-cinq ans. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, où je ne vois plus du tout dans quelle organisation politique je pourrais m’engager.
Qu’est-ce qui motive un jeune garçon des années 1970 à s’engager politiquement ?
Mon entrée dans le militantisme et l’engagement radical à gauche, alors que j’étais lycéen, c’est d’abord dû au contexte post-68 qui a produit des effets jusqu’à la fin de la décennie en France. En 1976, il y a énormément de mouvements sociaux et de luttes sociales. À partir d’une grande grève lycéenne en 1973, il y a presque tous les ans des mobilisations avec des grèves jusque vers la fin des années 1970. Le film Le péril jeune (1994) de Cédric Klapisch retrace assez bien cette période ; ses enthousiasmes, ses évidences et ses illusions. Pour ma part, je choisis le PS, à la différence de mes camarades qui s’engagent à l’extrême gauche, sur une orientation à la fois marxiste, révolutionnaire et pragmatique, peut-être peu compréhensible aujourd’hui. Le groupe du MJS que nous créons en 1976 dans mon lycée de Bordeaux Bastide, alors que j’arrive juste dans la région bordelaise suite à un déménagement de mes parents, est le groupe Rosa Luxemburg, le groupe du MJS du lycée de Talence situé pas très loin était le groupe Antonio Gramsci…
Je fais ma première grève à 13 ans à Chalon-sur-Saône en Cinquième. Déjà dans mon collège, il y avait des sympathisants maoïstes, trotskystes, etc. Donc l’important, c’est une ambiance conjoncturelle peuplée d’une série d’évidences. Par exemple, des centaines de milliers de militants syndicaux, associatifs et politiques pensent que l’autogestion dans les usines et dans la société est souhaitable et possible. Ensuite, partant des évidences propres à ce contexte, ma démarche est assez intellectualiste : il faut que je lise des choses pour comprendre. Mais cet intellectualisme est adossé au contexte, qui lui-même n’est pas clairement réfléchi. Il est important de noter que le réfléchi apparaît ancré dans de l’irréfléchi, dans des rapports corporels au monde et aux évidences du moment des univers que nous fréquentons. Ce que j’ai compris plus tard en lisant la Phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty (1945). Je suis pris là-dedans, mais ce n’est pas lié principalement à des sentiments d’injustice ou d’indignation. Je viens d’une famille de couches moyennes salariées, qui a bénéficié d’une ascension sociale, mes parents étant issus de milieux populaires (grands-parents paternels agriculteurs en fermage et ouvrier et artisan pour mon grand-père maternel).
Comment jeune adolescent se construit-on une culture politique entre Chalon-sur-Saône et Bordeaux ?
Il y a quelques livres qui ont servi à me politiser, que j’ai découverts un peu par hasard : Germinal d’Emile Zola et le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels. Par ailleurs, je tombe à la maison sur deux livres appartenant à mon frère aîné : Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau et L’Armée nouvelle de Jean Jaurès, quiest en partie une introduction au marxisme et à la question des classes sociales. Ces quatre livres m’ont fourni quelques repères intellectuels et politiques au sein de l’effervescence du moment.
Ensuite, j’ai envoyé des lettres à des maisons d’édition pour leur poser des questions, comme à la collection P-Politique du Seuil et à différents groupes politiques, comme le Parti socialiste unifié (PSU), qui m’a répondu en m’envoyant des brochures et des numéros de revues, et j’avais entendu parler par mon frère du CERES, un groupe qui avait une logique marxiste révolutionnaire, mais au sein de la social-démocratie. Patrick Weil, à l’époque responsable des jeunes du CERES et qui est devenu un grand spécialiste des politiques migratoires, m’a répondu et m’a envoyé aussi pas mal des brochures, des numéros de revues, etc. et une longue lettre. Et finalement, j’ai trouvé que ce n’était pas idiot comme idée de se servir d’un parti de masse pour aller vers la Révolution sociale, plutôt que de rejoindre un groupuscule. Et très vite je me mets à lire Rosa Luxemburg qui est restée pour moi une des figures principales de mon rapport à l’engagement, dans une perspective à la fois antiléniniste et antistalinienne.
Est-ce que c’est l’attachement à des figures — Marx, Jaurès, Luxemburg… en passant par Sartre, aujourd’hui, peut-être Mélenchon ? — qui motive le militant, le militantisme ?
Dans mon parcours militant, il y a eu certes des figures médiatrices importantes d’intellectuels-militants. Cela a d’abord été le cas d’un des fondateurs du CERES, plus important pour moi que Chevènement, Didier Motchane, un énarque marxiste atypique, à la fois stratège (il a été le rédacteur de la motion du fameux congrès d’Epinay de 1971 du PS, autour de la rupture avec le capitalisme et de l’Union de la gauche) et féru de théorie, de sociologie et de philosophie. Puis quand je me suis rapproché de la LCR, cela a été le cas de son principal intellectuel, le philosophe marxiste Daniel Bensaïd. Mais ce sont des figures médiatrices familières, pas de « grands intellectuels » lointains. Motchane a été une sorte de « père politique » pour moi et Bensaïd une sorte de « grand frère politique ». Et les morts, comme Rosa Luxemburg dans mon cas, nous servaient de boussole quant à l’héroïsme militant et au souci de l’analyse.
Cependant, de telles figures, mortes ou vivantes, n’étaient à l’époque qu’une composante de quelque chose de plus large, s’inscrivaient pour nous dans quelque chose de plus vaste. Car l’engagement était conçu dans le double sillage des Lumières et du marxisme dans un rapport à la connaissance. Bref, l’engagement était fortement lié à la connaissance. On disait que Marx avait formulé une « théorie scientifique » par exemple. C’était donc un modèle issu des Lumières et du marxisme, mais qui touchait aussi l’anarchisme organisé : nécessairement, engagement et connaissance cheminaient ensemble. Le militantisme supposait une composante importante de travail intellectuel, même si on se méfiait du pouvoir des intellectuels.
Quand je parlais du rapport intellectualiste que j’avais à l’engagement, cela n’était donc pas un cas isolé, car une certaine forme d’intellectualisme – certes variable, mais chez moi elle était plus prégnante – était présente un peu partout à travers des structures de formation assez développées dans les partis, les syndicats et les associations. Et puis peu à peu je l’ai vu se rétrécir, voire disparaître. Au PS, à la LCR, à la FA, les dispositifs de formation sont devenus beaucoup plus légers, plus labiles, moins généralisés à l’ensemble des militants. Cette construction héritée des Lumières et du marxisme, mais aussi de l’anarchisme organisé en tant que composante du mouvement ouvrier, posant un lien fort entre connaissance et engagement, c’était plus important à l’époque pour les militants que la figure de l’« intellectuel engagé » à la Sartre. La plupart des militants n’étaient pas attachés au nom d’un intellectuel, sauf les morts comme Marx ou Lénine pour les marxistes et Proudhon ou Bakounine pour les anarchistes. Des figures comme Sartre ou Foucault affectaient un public plus large, davantage sympathisant que militant. Pour les militants, il y avait ce rapport fort à l’idée que pour agir, il faut comprendre, donc il faut lire, il faut connaître la théorie, se former, etc. Mais cet appétit de réflexions n’allait pas en général jusqu’à « aussi penser contre soi-même », selon la formule de Theodor Adorno dans Dialectique négative (1966). C’est-à-dire ne conduisait pas à développer une réflexivité critique sur les évidences du moment. Notre intellectualisme tournait autour de « gonds » (pour reprendre une métaphore de Ludwig Wittgenstein dans son petit livre inachevé De la certitude) composés d’évidences non interrogées, elles-mêmes liées à des affects éthico-politiques historiquement situés.
C’était une chose extrêmement partagée, dans beaucoup d’endroits, pas simplement dans les milieux de couches moyennes salariées, mais dans de nombreux secteurs du mouvement ouvrier. Dans ma section du PS à Bordeaux alors que j’étais encore lycéen, c’est un prêtre ouvrier de la CFDT qui a, par exemple, contribué à nous initier au marxisme.
Au cours de mon itinéraire militant, j’ai essayé de maintenir ce lien à travers des associations (Critiques Sociales, avec le sociologue Claude Grignon), club (Club Merleau-Ponty), revue (ContreTemps, avec Daniel Bensaïd). Et aujourd’hui, encore sur le même modèle qui combine connaissance et praxis en associant chercheurs professionnels et militants, le séminaire de recherche militante et libertaire ETAPE (Explorations Théoriques Anarchistes Pragmatistes pour l’Émancipation). D’ailleurs, dans mon élaboration intellectuelle, je reste très attaché à une insertion de la politique émancipatrice dans les Lumières. Je ne m’inscris pas dans le dénigrement des Lumières vues comme uniquement sexistes, coloniales, etc. Parce qu’il y a notamment ce mécanisme intéressant : le lien entre action et connaissance. Il faudrait toutefois assouplir notre appui sur les Lumières, car il y a bien des impensés sexistes, coloniaux, etc. dans les Lumières du XVIIIe siècle, mais aussi des outils pour mettre en cause ces impensés. Ce qui devrait nous conduire à redéfinir notre rapport à elles sans pour autant les jeter à la poubelle : ce que j’ai appelé des « Lumières tamisées » ou « Lumières mélancoliques ». Et il faut également assouplir ce rapport aux Lumières, parce qu’on avait une vision trop intellectualiste, qui postulait que la connaissance produisait l’action. Ça, c’est une connerie ! [rires] La connaissance est tout au plus une composante de l’action, en interaction avec du non-conscient, des émotions, des circonstances qui nous échappent, ou ce que Pierre Bourdieu appelait « le sens pratique » forgé à travers les expériences. Mais maintenir un lien, plus lâche, entre la connaissance et l’action constitue à mon avis un élément important. Et c’est quelque chose que je ne retrouve pas forcément dans les organisations aujourd’hui et, partant, chez les nouveaux militants.
Comment ce manque se manifeste-t-il ?
Il y a des décrochages, je le vois même dans mon milieu professionnel, l’université. Les collègues ou les étudiants ne sont pas le plus souvent militants, mais ils peuvent avoir des positions. Ils peuvent être nuancés dans leurs travaux et dans les débats académiques : sur les contradictions du réel, la complication des problèmes, etc. Et puis ils vont parler politique, ils vont défendre Mélenchon systématiquement parce qu’ils sont « pour ». Ou ils vont être « pour la Palestine » – ce qui est aussi mon cas – mais en tendant à faire silence sur la violence islamiste et sur l’antisémitisme – ce qui n’est pas mon cas. Ou, à l’inverse, ils vont dénoncer l’islamisme et l’antisémitisme, mais marquer une certaine indifférence à l’islamophobie ou à la situation des Palestiniens. Ils n’ont pas de carte, mais ils vont tendre à oublier la partie « connaissance » de leur être. Leur être politique va alors glisser vers le manichéisme. Or, il me semble qu’il faudrait maintenir une ouverture entre engagement politique et connaissance raisonnée et argumentée, avec la composante autocritique de cette connaissance. Une ouverture, ce n’est toutefois plus la prétention intellectualiste de la connaissance à surplomber l’action. Or la possibilité de cette ouverture s’est amenuisée avec la crise des partis politiques classiques.
En avançant en âge, par rapport à d’autres qui se droitisent ou qui vont plus dans le conservatisme, vous passez du PS pour arriver à la LCR, et aux anarchistes. Dans le même temps, vous avez toujours pris en compte un certain pragmatisme dans l’action. Qu’est-ce qui fait le lien entre toutes ces évolutions, ces changements ?
J’ai évolué sur une série de sujets, mais j’ai maintenu quelques fondamentaux. Il y a donc une continuité relative dans mes différents engagements. J’étais favorable à la suppression du capitalisme et donc à une révolution sociale, par exemple, et ça n’a pas beaucoup bougé. J’ai seulement un rapport plus pragmatique à ce que je perçois plus clairement aujourd’hui comme une boussole et un horizon de révolution sociale. Par ailleurs, j’avais déjà développé une sensibilité écologiste. On oublie un peu que dans ces années 1970 émergent des revues, des associations écologistes. J’étais attiré par les critiques de la croissance, alors qu’il y avait des tentations productivistes au CERES. Mais j’ai aussi peu à peu incorporé des choses qui n’étaient pas tellement présentes : le féminisme, qui tendait à être mis à la périphérie des différentes organisations, la question de l’homophobie, encore plus lente à être incorporée. Et la transphobie apparaissait complètement hors de notre champ de vision.
Par contre, ce qui a germé quand je militais à la gauche des Verts, c’est la composante libertaire, à une époque où les Verts résistaient encore à la politique traditionnelle professionnalisée avec le thème de « la politique autrement ». Or, on considérait dans les années 1970 que le problème principal, c’était le capitalisme et l’exploitation de classe, mais on se posait peu la question du rapport représentants/représentés et de la professionnalisation des représentants. Donc, on avait des représentants qui allaient nous aider à aller vers la révolution sociale, mais on ne voyait pas qu’il y avait une oligarchisation possible de la politique via les représentants ! La sociologie politique de Pierre Bourdieu m’a aidé dans les années 1980 à en prendre conscience. Et puis comme quelque chose de plus large que notre impensé quant aux mécanismes de la domination proprement politique des représentants professionnels sur les représentés, il y avait l’impensé de l’étatisme, alors que l’État était avant tout pour nous un moyen dans l’objectif stratégique de « la prise du pouvoir », même si on répétait avec Marx qu’il devait un jour « dépérir »…
Ma sensibilité libertaire s’est consolidée sur un autre plan quand je me suis mis à travailler dans une perspective sociologique sur la question de l’individualité et de l’individualisme à la fin des années 1990. Et, progressivement, je me suis aperçu qu’il y avait eu un certain refoulement de la question de l’individu dans de nombreux secteurs du mouvement ouvrier et socialiste après la guerre de 14 -18 en France, alors que c’est très présent avant, y compris dans la social-démocratie. Mais après 14-18, on a peu à peu laissé la question de l’individualité à la droite, au capitalisme, à ce qu’on a appelé « l’individualisme bourgeois » et « l’individualisme petit-bourgeois », etc. Et ça a été encore renforcé dans la phase antinéolibérale, parce que néolibéralisme et individualisme ont souvent été associés dans les discours militants critiques.
Et donc là, je me suis rendu compte que ceux qui avaient préservé une place à l’individualité, c’étaient les libertaires. C’était pourtant très fort chez Marx, mais cela a été peu vu par les marxistes, qui en ont souvent fait à tort un auteur « collectiviste ». C’était donc fort chez les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires des bourses du travail, mais également chez Jaurès. Chez les syndicalistes libertaires très présents dans la première CGT, il y avait souvent un lien entre individualité et solidarité. Et la révolution sociale s’effectuait aussi au nom de l’individualité. Cela m’a alors orienté vers un auteur comme le philosophe Emmanuel Levinas, chez qui il y a une tension entre la question de la singularité du visage d’autrui et la question des cadres communs, ce qu’il appelle la justice. Entre l’unicité de l’autrui singulier et la justice pour tous les autres, il faudrait « comparer l’incomparable », énonce-t-il de manière très suggestive.
C’est vrai que ce n’est pas ce que l’on retient habituellement de la gauche radicale, ou la dimension collective est plus souvent mise en avant…
L’individualité y est même devenue un problème, parce que c’est pris comme une menace pour le collectif. Aujourd’hui, le discours dominant dans les secteurs critiques de la gauche, c’est que l’individualité est plutôt un danger par rapport à l’action collective – c’est le souvent répété « c’est la faute à l’individualisme » ! Et même les théories de gauche sont fréquemment nostalgiques du « commun » de manière trop univoque, y compris dans des choses intéressantes, comme chez Christian Laval et Pierre Dardot. Leur livre Commun (2014) est stimulant, notamment dans la façon de concevoir le commun comme processus et activité coopérative, et pas comme quelque chose de donné, mais le point de référence principal reste la prédominance du collectif, dans une certaine continuité avec les imaginaires communistes. Alors qu’à mon avis, il faudrait s’orienter vers les tensions et les articulations entre les singularités individuelles et les espaces communs, dans le sillage de Levinas.